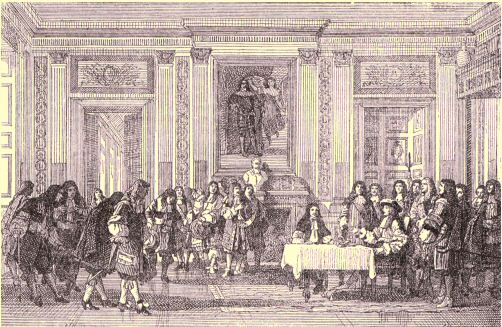| Molière est (avec Boileau et La Bruyère) un des rares auteurs du XVIIe siècle qui aient vu le jour à Paris; on sait en effet que Descartes, Corneille, Bossuet, La Fontaine et Racine naquirent en province. Il naquit même sur la paroisse Saint-Eustache , entre cette église et la Seine, entre le « ruisseau des halles » et la « place Saint-Jean », ce qui lui procura l'avantage de connaître dès le berceau la langue que voulut parler Malherbe. Fils d'un marchand tapissier qui faisait de bonnes affaires et qui avait la charge lucrative de valet de chambre du roi, c.-à-d. de fournisseur breveté de Sa Majesté, il paraît avoir reçu d'abord l'instruction rudimentaire que le clergé des paroisses donnait aux enfants du peuple. Ce serait seulement à l'âge de quatorze ans, et sans doute parce que Poquelin donnait de belles espérances, qu'il devint au collège de Clermont, où les jésuites avaient institué un externat gratuit, le condisciple des plus riches bourgeois, voire même des grands seigneurs. De ses études chez les jésuites et des dispositions dont il put faire preuve durant les cinq ou six années qu'il passa au collège, nous ne savons absolument rien. Externe non payant dans un établissement aristocratique qui comptait plus de deux mille écoliers, Jean-Baptiste Poquelin passa sans doute inaperçu; il apprit ce qu'on enseignait alors dans les collèges, c.-à-d. beaucoup de latin, peu ou pas de grec, pas de français du tout, mais de l'histoire ancienne, de la mythologie à outrance, et finalement de la philosophie aristotélicienne. Mais au sortir de là il était aussi instruit que pas un; grâce à son éducation en partie double, à ses années d'école primaire complétées par cinq ou six ans de collège, le jeune Poquelin devenu maître ès arts pourra un jour se faire le peintre de maître Sganarelle et de Nicole, ou de Dorante et de Dorimène, des gens du peuple ou des marquis; dès l'enfance il a connu les uns et les autres. , entre cette église et la Seine, entre le « ruisseau des halles » et la « place Saint-Jean », ce qui lui procura l'avantage de connaître dès le berceau la langue que voulut parler Malherbe. Fils d'un marchand tapissier qui faisait de bonnes affaires et qui avait la charge lucrative de valet de chambre du roi, c.-à-d. de fournisseur breveté de Sa Majesté, il paraît avoir reçu d'abord l'instruction rudimentaire que le clergé des paroisses donnait aux enfants du peuple. Ce serait seulement à l'âge de quatorze ans, et sans doute parce que Poquelin donnait de belles espérances, qu'il devint au collège de Clermont, où les jésuites avaient institué un externat gratuit, le condisciple des plus riches bourgeois, voire même des grands seigneurs. De ses études chez les jésuites et des dispositions dont il put faire preuve durant les cinq ou six années qu'il passa au collège, nous ne savons absolument rien. Externe non payant dans un établissement aristocratique qui comptait plus de deux mille écoliers, Jean-Baptiste Poquelin passa sans doute inaperçu; il apprit ce qu'on enseignait alors dans les collèges, c.-à-d. beaucoup de latin, peu ou pas de grec, pas de français du tout, mais de l'histoire ancienne, de la mythologie à outrance, et finalement de la philosophie aristotélicienne. Mais au sortir de là il était aussi instruit que pas un; grâce à son éducation en partie double, à ses années d'école primaire complétées par cinq ou six ans de collège, le jeune Poquelin devenu maître ès arts pourra un jour se faire le peintre de maître Sganarelle et de Nicole, ou de Dorante et de Dorimène, des gens du peuple ou des marquis; dès l'enfance il a connu les uns et les autres. Un dernier fait à noter avant de suivre Molière dans la vie d'aventures qui va commencer pour lui, c'est que dès l'adolescence il paraît avoir été initié aux choses du théâtre. Sa mère mourut en 1632, alors qu'il venait d'atteindre sa dixième année, et son père se remaria l'année suivante, pour redevenir veuf au bout de trois ans. Dans ces conditions, le jeune orphelin fut, dit-on, confié souvent à son grand-père maternel, au bonhomme Louis Cressé, qui avait la passion des spectacles, qui se faisait un plaisir d'y mener son petit-fils les jours de congé et qui souhaitait même de le voir devenir un des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne ou du théâtre du Marais, un second Bellerose peut-être! S'il en est ainsi, et rien ne nous empêche de le croire, Jean-Baptiste Poquelin ne pouvait mieux choisir son moment pour étudier sur le vif l'art dramatique et le jeu des acteurs. Ce serait à l'âge de treize ans, c.-à-d. en 1635, qu'il aurait commencé à fréquenter les théâtres de Paris; or on donna cette année-là même l'Illusion comique de Corneille, où la profession de comédien est exaltée en vers magnifiques; l'année suivante paraissait « la merveille du Cid », et Molière, âgé de dix-huit à vingt ans, put voir dans leur nouveauté Horace, Cinna, Polyeucte, peut-être même le Menteur », et Molière, âgé de dix-huit à vingt ans, put voir dans leur nouveauté Horace, Cinna, Polyeucte, peut-être même le Menteur . Il est possible que l'Illusion comique ait fait germer dans son esprit l'idée de devenir acteur et que l'édit royal du 16 avril 1641, par lequel les comédiens pouvaient « cesser d'être infâmes », ait mis fin à ses dernières hésitations. Il est possible également que le succès des premières tragédies de Corneille lui ait inspiré son goût persistant pour la tragédie, qu'il joua toujours de préférence en qualité d'acteur et qu'il côtoiera si volontiers comme auteur de pièces comiques. Dans ce cas, la postérité devrait être doublement reconnaissante à Corneille qui lui aurait donné deux fois Molière. . Il est possible que l'Illusion comique ait fait germer dans son esprit l'idée de devenir acteur et que l'édit royal du 16 avril 1641, par lequel les comédiens pouvaient « cesser d'être infâmes », ait mis fin à ses dernières hésitations. Il est possible également que le succès des premières tragédies de Corneille lui ait inspiré son goût persistant pour la tragédie, qu'il joua toujours de préférence en qualité d'acteur et qu'il côtoiera si volontiers comme auteur de pièces comiques. Dans ce cas, la postérité devrait être doublement reconnaissante à Corneille qui lui aurait donné deux fois Molière. Que devint Jean-Baptiste Poquelin au sortir du collège de Clermont ou, si l'on veut, après avoir étudié la philosophie sous Gassendi? Nul ne le sait au juste. D'après les uns, il aurait fait à Orléans des études de droit; d'autres ont dit qu'il avait suivi à la Sorbonne des cours de théologie. Ce qui est certain, c'est que le 30 juin 1643 il signait chez un notaire de Paris un contrat d'association « pour l'exercice de la comédie [...] sous le titre de l'Illustre théâtre ». Il entrait ainsi dans une carrière dont il ne devait plus sortir que par la mort, un peu moins de trente ans plus tard, et, soit pour ne pas infliger une flétrissure au nom de son père, soit pour toute autre raison, il prenait un nom de guerre et cessait de s'appeler Poquelin pour devenir le « sieur de Molière ». On s'est demandé d'où venait ce nom, et, comme il arrive toujours en pareille matière, les réponses ont varié. C'est le nom d'un comédien-poète mort au début du XVIIe siècle et surnommé le Tragique, a-t-on dit et répété à satiété; mais jamais on n'a pu faire la biographie de ce comédien ou montrer une prétendue tragédie de Polixène, qui aurait été le chef-d'oeuvre de ce Molière. Il est infiniment plus probable que J.-B. Poquelin, en quête d'un pseudonyme, a pris un nom tombé pour ainsi dire en déshérence, le nom d'un écrivain médiocre, auteur de deux romans à succès, la Semaine amoureuse et la Polixène, et qui mourut assassiné aux environs de l'année 1625. Si la chose était vraie, nous en pourrions inférer que Molière jeune était grand lecteur de romans, et ainsi s'expliquerait ce goût du romanesque dont il fera preuve partout et toujours, même dans Tartuffe sous Gassendi? Nul ne le sait au juste. D'après les uns, il aurait fait à Orléans des études de droit; d'autres ont dit qu'il avait suivi à la Sorbonne des cours de théologie. Ce qui est certain, c'est que le 30 juin 1643 il signait chez un notaire de Paris un contrat d'association « pour l'exercice de la comédie [...] sous le titre de l'Illustre théâtre ». Il entrait ainsi dans une carrière dont il ne devait plus sortir que par la mort, un peu moins de trente ans plus tard, et, soit pour ne pas infliger une flétrissure au nom de son père, soit pour toute autre raison, il prenait un nom de guerre et cessait de s'appeler Poquelin pour devenir le « sieur de Molière ». On s'est demandé d'où venait ce nom, et, comme il arrive toujours en pareille matière, les réponses ont varié. C'est le nom d'un comédien-poète mort au début du XVIIe siècle et surnommé le Tragique, a-t-on dit et répété à satiété; mais jamais on n'a pu faire la biographie de ce comédien ou montrer une prétendue tragédie de Polixène, qui aurait été le chef-d'oeuvre de ce Molière. Il est infiniment plus probable que J.-B. Poquelin, en quête d'un pseudonyme, a pris un nom tombé pour ainsi dire en déshérence, le nom d'un écrivain médiocre, auteur de deux romans à succès, la Semaine amoureuse et la Polixène, et qui mourut assassiné aux environs de l'année 1625. Si la chose était vraie, nous en pourrions inférer que Molière jeune était grand lecteur de romans, et ainsi s'expliquerait ce goût du romanesque dont il fera preuve partout et toujours, même dans Tartuffe , même dans le Malade imaginaire , même dans le Malade imaginaire . .
Les destinées de l'Illustre théâtre ne furent pas aussi brillantes que l'avaient espéré Molière et ses compagnons. On y joua d'abord avec succès quelques tragédies, dont une de Du Ryer et deux ou trois de Tristan l'Hermite; puis le temps des épreuves arriva. Les recettes ne couvrant plus les dépenses; il fallut emprunter; les créanciers se montrèrent exigeants, et Molière fut durant quelques jours emprisonné pour dettes (août 1645). L'Illustre théâtre ferma donc ses portes, et le jeune comédien, que ses mésaventures avaient pu attrister mais non décourager, entra avec plusieurs de ses camarades dans une « troupe de campagne », qui avait pour directeur un sieur Dufresne et qui exploitait surtout la Guyenne et Gascogne et Gascogne , le Languedoc , le Languedoc et les provinces voisines. et les provinces voisines. En 1650, sans cesser d'être acteur, Molière devint, on ne sait comment, chef de la troupe, et dès lors sa situation changea d'une manière complète. Il avait sans doute, comme tous ses associés, l'obligation de jouer de son mieux le rôle tragique ou comique qui lui était attribué, mais en outre il devait assumer la gestion financière de la raison sociale Molière et Cie la conduire successivement dans telle ou telle ville, se charger de son recrutement, et surtout lui procurer, d'où qu'elles vinssent d'ailleurs, les pièces les plus capables d'attirer la foule. On sait qu'au XVIIe siècle les oeuvres dramatiques tombaient dans le domaine public à dater du jour où elles étaient imprimées. La troupe qui les avait montées n'en avait plus le monopole et toutes les autres avaient le droit de les jouer moyennant une redevance assez minime. Molière, en 1650, pouvait assurément donner à ceux qui prenaient place sur les balles de son théâtre une série de spectacles variés; son répertoire se composait de tragédies, de comédies, et enfin de farces en assez grand nombre. Sans parler de Corneille, dont les oeuvres avaient partout le même succès qu'à Paris, dont la Théodore même, tombée à plat sur la scène parisienne, se soutint quelque temps dans les provinces, les pièces de Thomas Corneille, qui n'osait pas encore aborder la tragédie, celles de Rotrou, dont les Sosies et les Captifs étaient empruntés à Plaute, celtes de Scarron et en particulier son Jodelet, qui fut si bien accueilli, celles de Boisrobert enfin, pour ne pas tout citer, alimentèrent évidemment les représentations données de divers côtés par la troupe de Molière. Mais on veut du nouveau sur le théâtre plus que partout ailleurs, et les gens du XVIIe siècle en étaient si avides que Corneille dut prendre pour devise : Non tam meliora quam nova. Quand une pièce avait atteint le chiffre de trente représentations consécutives, c'était pour son auteur un succès éclatant. On connaît l'histoire du Timocrate de Thomas Corneille, qui fut joué quatre-vingts fois de suite; le public ne se lassait pas de le redemander, mais les acteurs fatigués refusèrent de le donner plus longtemps, et depuis lors il ne reparut jamais sur la scène. Pour répondre à ces exigences d'un public capricieux et frivole, Molière crut devoir employer les courts loisirs dont il disposait à composer des pièces de son cru. C'est parce qu'il était chef de troupe que cet acteur de trente ans devint poète comique, auteur de grosses farces à l'italienne d'abord, et bientôt, sans doute aux environs de 1653 et pour charmer les Lyonnais, de grandes pièces en vers, telles que l'Etourdi et le Dépit amoureux et le Dépit amoureux . Dans ces conditions, il continua durant sept ou huit ans à parcourir la province, et l'érudition moderne signale sa présence en cent endroits divers. La troupe de Molière était d'une rare distinction : le jeu excellent de ses acteurs, la beauté des actrices, le luxe des décors et des costumes, tout enfin contribuait à lui assurer la vogue. Mais les plus belles médailles ont un revers, et Molière l'éprouva durant son séjour en province d'une manière fâcheuse. Après s'être vu au comble de la prospérité, il connut la disgrâce, sinon la misère, et son caractère, naturellement sérieux et même triste, en prit une teinte de mélancolie et même d'hypocondrie incurable. . Dans ces conditions, il continua durant sept ou huit ans à parcourir la province, et l'érudition moderne signale sa présence en cent endroits divers. La troupe de Molière était d'une rare distinction : le jeu excellent de ses acteurs, la beauté des actrices, le luxe des décors et des costumes, tout enfin contribuait à lui assurer la vogue. Mais les plus belles médailles ont un revers, et Molière l'éprouva durant son séjour en province d'une manière fâcheuse. Après s'être vu au comble de la prospérité, il connut la disgrâce, sinon la misère, et son caractère, naturellement sérieux et même triste, en prit une teinte de mélancolie et même d'hypocondrie incurable. L'histoire est fort peu connue et vaut la peine d'être contée avec quelque détail. En septembre 1653, Molière eut la bonne fortune de se voir présenter au prince de Conti, ancien élève du collège de Clermont comme lui, mais trop jeune pour avoir jamais pu être son camarade de classe. Le comédien plut infiniment au prince, qui songea, dit-on, à le choisir pour secrétaire, qui en tout cas pensionna sa troupe, lui permit de s'intituler «-troupe de Mgr le prince de Conti » et se donna enfin le plaisir princier de lire avec Molière ou de se faire lire et expliquer par lui les plus beaux chefs-d'oeuvre de l'art dramatique ancien et moderne. C'est par le prince de Conti qu'il fut amené à jouer, pour le plus grand profit de la troupe, en présence des Etats du Languedoc , et la protection déclarée de ce prince du sang, devenu le neveu de Mazarin, contribua fort à mettre en belle posture Molière et ses camarades. Mais en décembre 1655, les choses prirent une tout autre tournure. Conti, qui jusqu'alors avait été un fanfaron de vice, un véritable don Juan, l'homme le plus dépravé peut-être de son siècle, fut converti soudain par le saint évêque d'Aleth, Nicolas Pavillon, et le premier effet de cette conversion fut d'inspirer au prince la haine de ce théâtre qu'il avait tant aimé. Conti refusa de subventionner plus longtemps Molière, qui dut se faire payer, en février 1656, par les Etats eux-mêmes et qui ne tarda pas à quitter la région. En 1657, à Lyon, il reçut l'ordre formel de ne plus se donner comme appartenant au prince, et l'on sait que, dix ans plus tard, Conti mourant écrivit un traité spécial contre la comédie et contre celle de Molière en particulier. Molière fut très affecté de ce changement dont il ne comprenait pas l'absolue sincérité, et le souvenir de ce qu'il considérait comme une cruelle injure ne cessa pas d'être présent à son esprit, même au temps de sa plus grande prospérité. , et la protection déclarée de ce prince du sang, devenu le neveu de Mazarin, contribua fort à mettre en belle posture Molière et ses camarades. Mais en décembre 1655, les choses prirent une tout autre tournure. Conti, qui jusqu'alors avait été un fanfaron de vice, un véritable don Juan, l'homme le plus dépravé peut-être de son siècle, fut converti soudain par le saint évêque d'Aleth, Nicolas Pavillon, et le premier effet de cette conversion fut d'inspirer au prince la haine de ce théâtre qu'il avait tant aimé. Conti refusa de subventionner plus longtemps Molière, qui dut se faire payer, en février 1656, par les Etats eux-mêmes et qui ne tarda pas à quitter la région. En 1657, à Lyon, il reçut l'ordre formel de ne plus se donner comme appartenant au prince, et l'on sait que, dix ans plus tard, Conti mourant écrivit un traité spécial contre la comédie et contre celle de Molière en particulier. Molière fut très affecté de ce changement dont il ne comprenait pas l'absolue sincérité, et le souvenir de ce qu'il considérait comme une cruelle injure ne cessa pas d'être présent à son esprit, même au temps de sa plus grande prospérité. Après bien des pérégrinations qui conduisirent sa troupe de Lyon à Rouen, mais en passant par Dijon, Pézenas, Avignon et Grenoble, Molière revint à Paris en août 1658. Il était déjà riche et comptait avec raison sur la continuation de ses succès; aussi alla-t-il s'établir au coeur même de la ville, à quelques pas du Louvre, et il s'entendit avec l'Italien Scaramouche pour occuper, concurremment avec ce comédien célèbre, le théâtre du Petit-Bourbon. Les circonstances étaient on ne peut plus favorables, et jamais peut-être poète comique ne vint mieux à son heure que Molière à cette date de 1658. Vingt ans plus tôt, il aurait trouvé devant lui un public de grossiers bourgeois et de rudes courtisans semblables au duc de Montausier; Richelieu l'eût absorbé ou brisé; il aurait été ou l'un des cinq auteurs de Son Eminence ou rien. Vingt ans plus tard, sous un roi devenu dévot qui s'éloignait peu à peu du théâtre, il eût été bien embarrassé, car il se serait trouvé sans protecteur. En 1658, au contraire, la Fronde était finie et le Parlement réduit au silence; la paix des Pyrénées allait assurer au roi de longues années ou de paix ou de guerres heureuses terminées par de glorieux traités. Le maître absolu de la France était un jeune prince de vingt ans, très ardent au plaisir, passionné pour la comédie et pour la danse. Auprès de lui, des ministres comme Mazarin, dont l'avarice n'épargnait aucune dépense quand il s'agissait d'opéra; comme Fouquet, le protecteur déclaré des gens de lettres. La cour était à l'image du roi, cela va sans dire; la société parisienne, où les femmes trônaient et donnaient le ton, était d'une politesse exquise, et les auteurs de ce temps-là se nommaient Corneille, Pascal, Bossuet, Quinault, La Fontaine, en attendant les jeunes qui avaient nom Boileau et Racine. Ainsi Molière chef de troupe rencontrait à Paris, en 1658, tout ce qu'il pouvait souhaiter de plus avantageux : un public pour l'admirer des protecteurs pour le soutenir, des rivaux pour stimuler son ardeur, et jusqu'à des critiques pour le guider et au besoin l'empêcher de broncher. Protégé par le jeune duc d'Orléans et bientôt par le roi lui-même, il obtint dès le premier jour des succès éclatants. Aux représentations de pièces sérieuses, telles que Cinna, Nicomède, Zénobie même, il joignit, pour égayer le spectacle, les farces et les comédies qu'il avait composées en province; puis il eut l'audace d'attaquer sur son théâtre un des travers les plus à la mode dans la haute société d'alors, la préciosité, l'exagération ridicule des qualités heureuses que l'hôtel de Rambouillet était un jeune prince de vingt ans, très ardent au plaisir, passionné pour la comédie et pour la danse. Auprès de lui, des ministres comme Mazarin, dont l'avarice n'épargnait aucune dépense quand il s'agissait d'opéra; comme Fouquet, le protecteur déclaré des gens de lettres. La cour était à l'image du roi, cela va sans dire; la société parisienne, où les femmes trônaient et donnaient le ton, était d'une politesse exquise, et les auteurs de ce temps-là se nommaient Corneille, Pascal, Bossuet, Quinault, La Fontaine, en attendant les jeunes qui avaient nom Boileau et Racine. Ainsi Molière chef de troupe rencontrait à Paris, en 1658, tout ce qu'il pouvait souhaiter de plus avantageux : un public pour l'admirer des protecteurs pour le soutenir, des rivaux pour stimuler son ardeur, et jusqu'à des critiques pour le guider et au besoin l'empêcher de broncher. Protégé par le jeune duc d'Orléans et bientôt par le roi lui-même, il obtint dès le premier jour des succès éclatants. Aux représentations de pièces sérieuses, telles que Cinna, Nicomède, Zénobie même, il joignit, pour égayer le spectacle, les farces et les comédies qu'il avait composées en province; puis il eut l'audace d'attaquer sur son théâtre un des travers les plus à la mode dans la haute société d'alors, la préciosité, l'exagération ridicule des qualités heureuses que l'hôtel de Rambouillet avait su donner à la ville et à la cour. L'effet produit par la représentation des Précieuses ridicules avait su donner à la ville et à la cour. L'effet produit par la représentation des Précieuses ridicules (1659) fut considérable; et Molière admiré connut durant trois ou quatre ans les seules joies pures qu'il lui ait été donné de goûter. Obligé de quitter le Petit-Bourbon que l'on démolissait pour agrandir le palais du Louvre, il se vit donner par Louis XIV la belle salle que Richelieu s'était fait construire au Palais-Cardinal, et où il put offrir aux applaudissements du public des comédies en vers qu'il composait à mesure : Sganarelle (1659) fut considérable; et Molière admiré connut durant trois ou quatre ans les seules joies pures qu'il lui ait été donné de goûter. Obligé de quitter le Petit-Bourbon que l'on démolissait pour agrandir le palais du Louvre, il se vit donner par Louis XIV la belle salle que Richelieu s'était fait construire au Palais-Cardinal, et où il put offrir aux applaudissements du public des comédies en vers qu'il composait à mesure : Sganarelle , don Garcie de Navarre , don Garcie de Navarre , la seule erreur de son talent d'exception, les Fâcheux , la seule erreur de son talent d'exception, les Fâcheux , l'Ecole des maris , l'Ecole des maris , et, à la fin de 1662, l'Ecole des femmes , et, à la fin de 1662, l'Ecole des femmes dont la brillante fortune marque le terme de la vie heureuse de Molière. Il y gagna l'opulence pour lui et pour ses camarades, mais à dater de ce jour il cessa de connaître la paix véritable : les dix années qu'il avait encore à vivre ne furent guère pour lui qu'une longue suite de chagrins, et ces chagrins, les plus beaux triomphes eux-mêmes ne parvinrent pas à les dissiper. dont la brillante fortune marque le terme de la vie heureuse de Molière. Il y gagna l'opulence pour lui et pour ses camarades, mais à dater de ce jour il cessa de connaître la paix véritable : les dix années qu'il avait encore à vivre ne furent guère pour lui qu'une longue suite de chagrins, et ces chagrins, les plus beaux triomphes eux-mêmes ne parvinrent pas à les dissiper.
- 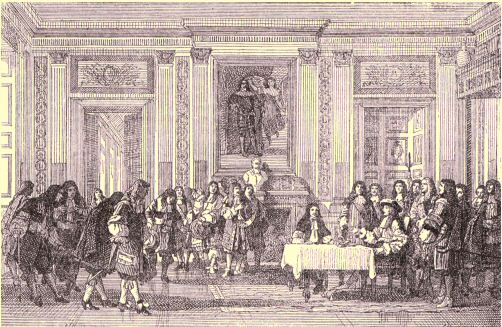
Molière et Louis XIV, d'après Vetter. Emporté par sa verve comique et comptant sur la connivence d'un roi dont les amours adultères venaient d'éclater au grand jour, Molière avait risqué dans l'Ecole des femmes des plaisanteries que réprouvait la morale même la plus accommodante, et le fameux sermon d'Arnolphe, avec ses chaudières bouillantes, où l'on plonge aux enfers « les femmes mal vivantes », pouvait choquer à bon droit les dévots. D'autre part, l'éclatant succès de sa nouvelle pièce portait ombrage aux comédiens des troupes rivales et aux auteurs de comédies moins bien accueillies. De là des inimitiés sans nombre et des attaques multipliées auxquelles Molière crut pouvoir répondre parce que la protection du roi mettait sa troupe à l'abri de tout danger. Quoique ancien élève des jésuites, il paraît avoir été toujours indifférent en matière religieuse, et l'opposition systématique des âmes pieuses qui condamnent les spectacles comme une des pompes de Satan lui paraissait attentatoire à sa liberté. Il avait dû courber la tête en 1656, lorsque le prince de Conti lui avait signifié son congé; cette fois, il entendait soutenir ses droits et au besoin porter la guerre dans le camp de ses ennemis. Quelques semaines après la dernière représentation de l'Ecole des femmes, il inaugura la série de ses vengeances : il s'attaqua d'abord aux prudes qui avaient jugé sa pièce immorale et, par la même occasion, il dit assez durement leur fait aux gens du bel air, aux pédants qui ne l'avaient pas trouvée conforme aux théories d'Aristote, C'est pour cette raison qu'il écrivit en 1663 ce petit chef-d'oeuvre qu'on nomme la Critique de l'Ecole des femmes des plaisanteries que réprouvait la morale même la plus accommodante, et le fameux sermon d'Arnolphe, avec ses chaudières bouillantes, où l'on plonge aux enfers « les femmes mal vivantes », pouvait choquer à bon droit les dévots. D'autre part, l'éclatant succès de sa nouvelle pièce portait ombrage aux comédiens des troupes rivales et aux auteurs de comédies moins bien accueillies. De là des inimitiés sans nombre et des attaques multipliées auxquelles Molière crut pouvoir répondre parce que la protection du roi mettait sa troupe à l'abri de tout danger. Quoique ancien élève des jésuites, il paraît avoir été toujours indifférent en matière religieuse, et l'opposition systématique des âmes pieuses qui condamnent les spectacles comme une des pompes de Satan lui paraissait attentatoire à sa liberté. Il avait dû courber la tête en 1656, lorsque le prince de Conti lui avait signifié son congé; cette fois, il entendait soutenir ses droits et au besoin porter la guerre dans le camp de ses ennemis. Quelques semaines après la dernière représentation de l'Ecole des femmes, il inaugura la série de ses vengeances : il s'attaqua d'abord aux prudes qui avaient jugé sa pièce immorale et, par la même occasion, il dit assez durement leur fait aux gens du bel air, aux pédants qui ne l'avaient pas trouvée conforme aux théories d'Aristote, C'est pour cette raison qu'il écrivit en 1663 ce petit chef-d'oeuvre qu'on nomme la Critique de l'Ecole des femmes . Bientôt ce fut le tour des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne . Bientôt ce fut le tour des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne et des poètes envieux, de Montfleury, de Boursault, de Donneau de Visé; l'Impromptu de Versailles et des poètes envieux, de Montfleury, de Boursault, de Donneau de Visé; l'Impromptu de Versailles , un tout petit acte en prose, suffit pour les écraser tous. Les dévots enfin, qui n'allaient pas au théâtre, purent entendre dire, en mai 1664, que Molière venait de faire jouer devant le roi les trois premiers actes de Tartuffe , un tout petit acte en prose, suffit pour les écraser tous. Les dévots enfin, qui n'allaient pas au théâtre, purent entendre dire, en mai 1664, que Molière venait de faire jouer devant le roi les trois premiers actes de Tartuffe . Le poète avait touché juste, mais il avait frappé trop fort ; le clergé, la magistrature même intervinrent, et Louis XIV, malgré son despotisme, dut attendre cinq ans avant de donner libre cours aux représentations de Tartuffe. Molière exaspéré se consola du moins en mettant sur la scène un Don Juan . Le poète avait touché juste, mais il avait frappé trop fort ; le clergé, la magistrature même intervinrent, et Louis XIV, malgré son despotisme, dut attendre cinq ans avant de donner libre cours aux représentations de Tartuffe. Molière exaspéré se consola du moins en mettant sur la scène un Don Juan scélérat et finalement hypocrite, dont le prince de Conti pourrait bien avoir été le modèle, dans une certaine mesure au moins. scélérat et finalement hypocrite, dont le prince de Conti pourrait bien avoir été le modèle, dans une certaine mesure au moins. Ainsi Molière était en guerre ouverte avec un grand nombre de ses contemporains : mais il avait beau savourer le plaisir de la vengeance, il souffrait cruellement d'un semblable état de choses. Il devenait taciturne et, un moment même, en 1666, quand il composa le Misanthrope , il faillit succomber à l'abattement. S'il n'avait pas eu l'appui de Louis XIV, il aurait certainement perdu courage. Mais cette protection royale, le poète comédien la payait bien cher, et l'on ne comprendrait rien à la vie de Molière si l'on ne songeait aux fatigues, aux dégoûts de toute nature que lui apporta le titre si envié d'amuseur officiel du roi. Il fallait donner satisfaction, et sur-le-champ, aux moindres caprices du maître, passer des jours et des nuits à improviser, à apprendre, à répéter des pièces, imaginer des divertissements qui fussent de nature à lui plaire, se mettre l'esprit à la torture pour composer des comédies mythologiques, des pastorales comiques ou de grosses bouffonneries à la Pourceaugnac , il faillit succomber à l'abattement. S'il n'avait pas eu l'appui de Louis XIV, il aurait certainement perdu courage. Mais cette protection royale, le poète comédien la payait bien cher, et l'on ne comprendrait rien à la vie de Molière si l'on ne songeait aux fatigues, aux dégoûts de toute nature que lui apporta le titre si envié d'amuseur officiel du roi. Il fallait donner satisfaction, et sur-le-champ, aux moindres caprices du maître, passer des jours et des nuits à improviser, à apprendre, à répéter des pièces, imaginer des divertissements qui fussent de nature à lui plaire, se mettre l'esprit à la torture pour composer des comédies mythologiques, des pastorales comiques ou de grosses bouffonneries à la Pourceaugnac , introduire des intermèdes ou des ballets dans les pièces mêmes qui comportaient le moins ce genre d'ornements, semer peut-être dans ses comédies des allusions plus ou moins transparentes aux passions, aux fantaisies et aux rancunes du monarque, flatter enfin de toutes les manières le plus orgueilleux des rois. On ne saura jamais sans doute ce que Molière a souffert ainsi durant les treize dernières années de sa vie, et la postérité a le droit de juger sévèrement un prince qui comprenait si mal son rôle de protecteur des lettres. Au lieu de lui faire jouer à satiété des pièces anciennes ou nouvelles et de lui commander des bluettes indignes d'un si puissant talent, Louis XIV aurait dû exiger de Molière qu'il renonçât le plus tôt possible à son métier de comédien. II aurait dû lui assigner une pension de 30.000 livres le faire entrer à l'Académie française et lui demander, en retour de tant de bienfaits, de composer à loisir les oeuvres que lui inspirerait sa muse. Que de chefs-d'oeuvre la littérature française aurait ajoutés à ceux qu'elle possède si Louis XIV avait agi de la sorte avec Molière, Corneille, Bossuet, La Fontaine, Racine et Boileau! Mais quoi! il choisit Bossuet, le plus grand orateur des temps modernes, pour enseigner à son fils la grammaire et l'histoire; il tira Boileau et Racine du « métier de la poésie » pour les transformer l'un et l'autre en historiographes; et quant à Molière, on peut dire sans exagération qu'il l'a fait mourir à la peine. , introduire des intermèdes ou des ballets dans les pièces mêmes qui comportaient le moins ce genre d'ornements, semer peut-être dans ses comédies des allusions plus ou moins transparentes aux passions, aux fantaisies et aux rancunes du monarque, flatter enfin de toutes les manières le plus orgueilleux des rois. On ne saura jamais sans doute ce que Molière a souffert ainsi durant les treize dernières années de sa vie, et la postérité a le droit de juger sévèrement un prince qui comprenait si mal son rôle de protecteur des lettres. Au lieu de lui faire jouer à satiété des pièces anciennes ou nouvelles et de lui commander des bluettes indignes d'un si puissant talent, Louis XIV aurait dû exiger de Molière qu'il renonçât le plus tôt possible à son métier de comédien. II aurait dû lui assigner une pension de 30.000 livres le faire entrer à l'Académie française et lui demander, en retour de tant de bienfaits, de composer à loisir les oeuvres que lui inspirerait sa muse. Que de chefs-d'oeuvre la littérature française aurait ajoutés à ceux qu'elle possède si Louis XIV avait agi de la sorte avec Molière, Corneille, Bossuet, La Fontaine, Racine et Boileau! Mais quoi! il choisit Bossuet, le plus grand orateur des temps modernes, pour enseigner à son fils la grammaire et l'histoire; il tira Boileau et Racine du « métier de la poésie » pour les transformer l'un et l'autre en historiographes; et quant à Molière, on peut dire sans exagération qu'il l'a fait mourir à la peine.
A ces nombreuses causes de chagrin s'en joignaient d'autres d'une nature toute particulière : pour appeler les choses par leur nom, Molière n'était pas heureux en ménage. Après avoir mené ,jusqu'à l'âge de quarante ans la vie fort libre des comédiens d'alors, il épousa en 1662, c.-à-d. au moment de ses plus beaux triomphes, une séduisante enfant de vingt ans, Armande Béjart, fille de l'une de ses anciennes maîtresses. Il entrait ainsi dans une famille peu honorable et s'exposait en raison de sa conduite antérieure aux médisances les plus fâcheuses, aux calomnies les plus atroces. Il ne tarda pas à en être cruellement puni. Ses ennemis propagèrent au sujet de cette union des bruits infâmes, et le vers de Polyeucte La prostitution, l'adultère et l'inceste, dut retentir maintes fois à ses oreilles. En vain le roi et la duchesse d'Orléans lui donnèrent des témoignages d'estime publics et acceptèrent, par exemple, de tenir sur les fonts baptismaux l'aîné de ses enfants ; les insinuations perfides allaient toujours leur train, et Molière en souffrait beaucoup. Ce n'est pas tout encore : Mlle Molière devenue comédienne au lendemain de son mariage, et en cela son mari commit une grave imprudence, ne sut pas comprendre qu'elle était la compagne d'un homme que Boileau déclarait le plus grand de son siècle. Elle avait toute la coquetterie de Célimène, elle voulut plaire, elle s'en laissa conter par les jeunes seigneurs de la cour, et de légèretés en légèretés elle en vint au scandale. Molière, qui l'aimait passionnément, fut donc en proie aux tortures de la jalousie. Sganarelle nullement imaginaire, il exhala ses plaintes, il pria, menaça, mais en vain; il dut exiger une séparation, et les deux époux cessèrent quelque temps de vivre ensemble, mais ils ne cessèrent pas de se rencontrer sur les planches du théâtre, aux répétitions intimes et aux représentations publiques; c'était pour le mari jaloux un supplice de tous les instants. N'y pouvant plus tenir, il accepta de se réconcilier avec sa femme et de reprendre la vie commune; mais Armande ne tint pas les promesses qu'elle avait dû faire, et la situation ne fit que s'aggraver, d'autant plus qu'une nouvelle rupture devenait impossible. Le grand homme et son indigne compagne continuèrent donc jusqu'à la fin de vivre ensemble et de se quereller : en février 1673, lorsque Molière mourant parut sur la scène dans la robe de chambre du Malade imaginaire , c'était sa femme qui jouait le rôle de la charmante Angélique. , c'était sa femme qui jouait le rôle de la charmante Angélique.
- 
Molière, d'après un tableau du foyer
des artistes de la Comédie Française.
(Dessin d'Eustache Lersay). Une dernière cause de chagrin pour Molière durant les sept ou huit dernières années de sa vie, ce fut l'état précaire de sa santé. Il ne parlait guère de la médecine et des médecins dans ses premières comédies, et cela sans doute parce que, peignant toujours d'après nature, il n'aimait pas parler de ce qu'il ne connaissait pas. C'est ainsi, par exemple, que, n'ayant jamais eu de procès, il n'a pas mis de plaideurs, de procureurs ou de juges sur la scène. Mais à dater de 1665 on voit qu'il avait fait connaissance avec la Faculté et qu'il n'était pas content d'elle. Atteint d'une maladie grave sur la nature de laquelle on n'est pas bien renseigné et qu'il appelait lui-même sa « fluxion », il lutta de toutes ses forces, se mit au régime lacté et loua une maison de campagne aux portes de Paris, à Auteuil. Son médecin, car il en avait un, lui faisait faire quelques remèdes et lui prescrivait sans doute le seul efficace, c'est-à-dire le repos absolu et la tranquillité d'esprit. Molière se serait peut-être guéri, du moins il aurait probablement prolongé ses jours, s'il avait écouté les médecins au lieu de les tourner en ridicule. Mais il se faisait un point d'honneur de ne pas abandonner ses camarades, et ne comprenait pas qu'en agissant de la sorte il s'exposait au contraire à les abandonner plus tôt et d'une manière plus fâcheuse. Il tenait surtout à rester jusqu'au dernier jour le chef de la « troupe du roi », titre qui lui avait été octroyé en 1665, au lendemain de Don Juan . Il était fort riche, car il jouissait d'un revenu d'environ 30.000 F; ses associés l'étaient donc à proportion et l'on ne voit pas que sa mort subite ait réduit à la mendicité, comme il l'appréhendait, les cinquante ouvriers qu'il employait journellement sur son théâtre. Mais la force de l'habitude et, plus que tout le reste, la peur du qu'en dira-t-on l'empêchaient de se retirer, de déserter ce qu'il appelait son poste. . Il était fort riche, car il jouissait d'un revenu d'environ 30.000 F; ses associés l'étaient donc à proportion et l'on ne voit pas que sa mort subite ait réduit à la mendicité, comme il l'appréhendait, les cinquante ouvriers qu'il employait journellement sur son théâtre. Mais la force de l'habitude et, plus que tout le reste, la peur du qu'en dira-t-on l'empêchaient de se retirer, de déserter ce qu'il appelait son poste. En vain ses meilleurs amis, Boileau en tête, le conjuraient de songer un peu à lui après avoir tant fait pour les autres; en vain ils faisaient briller à ses yeux les douceurs de la vie d'homme de lettres, et ils lui remontraient que, n'ayant plus à compter avec les exigences d'un métier si peu digne de lui, il pourrait renoncer enfin aux scapinades et faire exclusivement des pièces plus conformes à ses goûts d'artiste épris de l'idéal, des pièces comme le Misanthrope et les Femmes savantes et les Femmes savantes ; tous perdirent leur temps; Molière ne voulut jamais quitter la scène du Palais-Royal ; tous perdirent leur temps; Molière ne voulut jamais quitter la scène du Palais-Royal et il y périt comme le soldat sur le champ de bataille, le vendredi 17 février 1673. Pris de convulsion au cours de la quatrième représentation du Malade imaginaire et il y périt comme le soldat sur le champ de bataille, le vendredi 17 février 1673. Pris de convulsion au cours de la quatrième représentation du Malade imaginaire , il fut transporté en toute hâte dans son appartement de la rue Richelieu et quelques heures plus tard il mourait entre les bras de sa vieille servante La Forest, assisté par deux soeurs quêteuses de province que son bon coeur lui avait fait recueillir et demandant avec instance, dit-on, les secours de la religion. On sait le reste, le refus de sépulture ecclésiastique opposé par le curé de Saint-Eustache , il fut transporté en toute hâte dans son appartement de la rue Richelieu et quelques heures plus tard il mourait entre les bras de sa vieille servante La Forest, assisté par deux soeurs quêteuses de province que son bon coeur lui avait fait recueillir et demandant avec instance, dit-on, les secours de la religion. On sait le reste, le refus de sépulture ecclésiastique opposé par le curé de Saint-Eustache et ensuite par l'archevêque Harlay de Chanvalon, un comédien mitré; l'intervention du roi, et finalement l'inhumation clandestine, le 21 à huit heures du soir, au coeur de l'hiver, dans le cimetière de Saint-Joseph, rue Montmartre, où rien n'a signalé à la postérité la tombe du grand homme. Le monument qui lui est élevé au Père-Lachaise est un simple cénotaphe : on ne sait pas où sont ses restes. Des trois enfants qu'il eut d'Armande Béjart, une fille seule lui survécut Esprit-Madeleine Poquelin, qui épousa un de Montalant et mourut à Argenteuil, en 1723, sans postérité. Sa veuve épousa un comédien médiocre, Guérin d'Estriché, avec lequel elle vécut plus de vingt ans en parfaite intelligence. et ensuite par l'archevêque Harlay de Chanvalon, un comédien mitré; l'intervention du roi, et finalement l'inhumation clandestine, le 21 à huit heures du soir, au coeur de l'hiver, dans le cimetière de Saint-Joseph, rue Montmartre, où rien n'a signalé à la postérité la tombe du grand homme. Le monument qui lui est élevé au Père-Lachaise est un simple cénotaphe : on ne sait pas où sont ses restes. Des trois enfants qu'il eut d'Armande Béjart, une fille seule lui survécut Esprit-Madeleine Poquelin, qui épousa un de Montalant et mourut à Argenteuil, en 1723, sans postérité. Sa veuve épousa un comédien médiocre, Guérin d'Estriché, avec lequel elle vécut plus de vingt ans en parfaite intelligence. Ainsi la vie de Molière se trouve expliquée par ce seul fait qu'il a été comédien et directeur de théâtre; on peut expliquer de même ce que son caractère a de profondément original. Naturellement simple et bon, il accueillait volontiers les jeunes gens de talent, Racine, par exemple, et il les mettait à même de se faire valoir en leur donnant les conseils de son expérience et en représentant leurs oeuvres. Il rendait pleine justice à ceux que l'on n'admirait pas assez et déclarait aux beaux esprits de ce temps qu'ils n'effaceraient pas le bonhomme La Fontaine. Il tendait la main à Corneille en détresse, lui payait fort cher son Attila et le faisait collaborer à la composition de Psyché . Il était enfin d'un dévouement à toute épreuve quand il s'agissait de ses camarades, une troupe « d'animaux » pourtant bien difficiles à conduire. Mais par contre les difficultés de la vie matérielle et la situation très équivoque dans laquelle se trouvaient alors les comédiens ne tardèrent pas à l'aigrir, à le rendre susceptible et même vindicatif à l'excès. C'est ainsi qu'en 1666 il se brouilla pour toujours avec Racine sans que l'on puisse bien savoir auquel des deux reviennent les premiers torts; un tel malheur ne serait pas arrivé sans doute si Molière n'avait pas été chef de troupe. S'il n'avait pas été directeur de théâtre, il ne se serait pas engagé, tout porte à le croire, dans cette longue suite de querelles littéraires, morales et religieuses qui lui ont fait composer ce qu'on peut appeler ses pièces de colère. S'il n'avait pas mis sa jeune femme au nombre des actrices de sa troupe, il n'aurait pas connu, à ce degré du moins, les tortures de la jalousie. Enfin il n'aurait pas lutté en désespéré contre la mauvaise santé, et sa mélancolie naturelle n'aurait pas dégénéré en misanthropie véritable. Molière comédien a donc, en définitive, connu les amertumes de la vie plutôt que ses joies, et à l'admiration sans réserve que la postérité professe pour lui se mêle nécessairement un sentiment de pitié pour cet honnête homme qu'une situation indigne de lui a tant fait souffrir. Mais c'est précisément à ce prix que Molière a acheté sa gloire, et s'il n'avait été qu'un poète comique faisant jouer ses pièces par d'autres, nous ne posséderions pas tel ou tel chef-d'oeuvre que seul un poète-comédien pouvait faire. Molière paraît avoir pris de bonne heure l'habitude de mêler son moi aux oeuvres qu'il composait, et comme il estimait que le ridicule peut guérir les humains de leurs manies, de leurs travers et de leurs vices, il s'est moqué souvent de ses propres défauts. Jaloux à l'excès, il a raillé constamment la jalousie et les jaloux; enclin à la misanthropie, il a fait rire aux dépens d'Alceste, et il était malade à mourir quand il immolait à la risée publique les malades imaginaires. Aussi la postérité, nécessairement égoïste, pourra plaindre Molière, mais elle se félicitera toujours en songeant que les tribulations mêmes d'un si grand auteur ont produit une si grande quantité de chefs-d'oeuvre. (A. Gazier). . Il était enfin d'un dévouement à toute épreuve quand il s'agissait de ses camarades, une troupe « d'animaux » pourtant bien difficiles à conduire. Mais par contre les difficultés de la vie matérielle et la situation très équivoque dans laquelle se trouvaient alors les comédiens ne tardèrent pas à l'aigrir, à le rendre susceptible et même vindicatif à l'excès. C'est ainsi qu'en 1666 il se brouilla pour toujours avec Racine sans que l'on puisse bien savoir auquel des deux reviennent les premiers torts; un tel malheur ne serait pas arrivé sans doute si Molière n'avait pas été chef de troupe. S'il n'avait pas été directeur de théâtre, il ne se serait pas engagé, tout porte à le croire, dans cette longue suite de querelles littéraires, morales et religieuses qui lui ont fait composer ce qu'on peut appeler ses pièces de colère. S'il n'avait pas mis sa jeune femme au nombre des actrices de sa troupe, il n'aurait pas connu, à ce degré du moins, les tortures de la jalousie. Enfin il n'aurait pas lutté en désespéré contre la mauvaise santé, et sa mélancolie naturelle n'aurait pas dégénéré en misanthropie véritable. Molière comédien a donc, en définitive, connu les amertumes de la vie plutôt que ses joies, et à l'admiration sans réserve que la postérité professe pour lui se mêle nécessairement un sentiment de pitié pour cet honnête homme qu'une situation indigne de lui a tant fait souffrir. Mais c'est précisément à ce prix que Molière a acheté sa gloire, et s'il n'avait été qu'un poète comique faisant jouer ses pièces par d'autres, nous ne posséderions pas tel ou tel chef-d'oeuvre que seul un poète-comédien pouvait faire. Molière paraît avoir pris de bonne heure l'habitude de mêler son moi aux oeuvres qu'il composait, et comme il estimait que le ridicule peut guérir les humains de leurs manies, de leurs travers et de leurs vices, il s'est moqué souvent de ses propres défauts. Jaloux à l'excès, il a raillé constamment la jalousie et les jaloux; enclin à la misanthropie, il a fait rire aux dépens d'Alceste, et il était malade à mourir quand il immolait à la risée publique les malades imaginaires. Aussi la postérité, nécessairement égoïste, pourra plaindre Molière, mais elle se félicitera toujours en songeant que les tribulations mêmes d'un si grand auteur ont produit une si grande quantité de chefs-d'oeuvre. (A. Gazier). | |