| . |
| ||||||
| |
| . |
| ||||||
| | |||
| Aperçu | La jeunesse | Les premières oeuvres | Don Carlos |
| Histoire et philosophie | La maturité | Dernières poésies lyriques | Derniers drames |
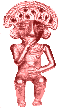 H. Lichtenberger ca.1900 | Les derniers drames Ce n'est pas la poésie lyrique, toutefois, mais bien le drame qui absorbe la meilleure partie de l'activité poétique de Schiller pendant ses dernières années. Il compose et fait jouer la trilogie de Wallenstein (première idée, 1791, composition, 1796-99) qui comprend Wallensteins Lager (première représentation à Weimar le 12 octobre 1798), Die Piccolomini (première représentation à Weimar, 30 janvier 1799) et Wallensteins Tod (première représentation à Weimar le 20 mars 1799); puis Maria Stuart (composition 1799 à 1800; première représentation à Weimar 14 juin 1800; Die Jungfrau von Orleans (composition, 1800-4; première représentation, à Leipzig, 18 septembre 1801); Die Braut von Messina (composition, 1801-2 ; première représentation à Weimar, 19 mars 1802); enfin Guillaume Tell (composition, 1801-4; première représentation, à Weimar, 17 mars 1804). A côté de ces grandes oeuvres originales qui ont fondé la réputation de Schiller comme dramaturge il faut citer une série de traductions d'oeuvres étrangères ou d'adaptations à la scène d'oeuvres allemandes. C'est ainsi qu'il arrange Macbeth Les drames de la période de maturité diffèrent de ceux de la jeunesse de Schiller par quelques traits essentiels. Dans ses drames de jeunesse, Schiller, nous l'avons vu, est essentiellement subjectif : il se soucie moins de peindre des caractères d'une parfaite vérité humaine, de reconstituer avec une entière exactitude un milieu historique donné que d'exprimer par la bouche de tel ou tel de ses personnages ses propres sentiments et ses aspirations personnelles. Or l'étude approfondie et scientifique de l'histoire, la fréquentation journalière du grand réaliste Goethe, et aussi le commerce plus assidu avec les écrivains de l'Antiquité classique changent ces dispositions. Et le premier drame dans lequel il met en oeuvre ses travaux historiques, Wallenstein, nous montre Schiller animé d'un esprit de parfaite objectivité. Il s'efforce très consciemment de toujours dominer son sujet, de ne jamais s'identifier avec ses personnages. « Je serais presque tenté de dire, écrit-il à Goethe (28 novembre 1796), que mon sujet ne m'intéresse pas. » La figure de son héros principal, Wallenstein, il la traite sans sympathie sentimentale d'aucune sorte, « avec le pur amour de l'artiste pour son oeuvre-». Wallenstein n'est pas un idéal moral comme le marquis de Posa; il n'a « rien de noble »; bien plus « il n'apparaît grand dans aucun de ses actes particuliers »; il manque de dignité morale et, de plus, il a le succès contre lui, il échoue dans sa tentative de trahison. Pourtant Schiller espère faire de lui « un caractère dramatiquement grand et doué d'un principe interne de vie authentique ». « Jadis, écrit-il encore, j'ai cherché, dans Posa et don CarlosCet effort vers le réalisme a été des plus heureux et a fait de Schiller l'un des maîtres du drame historique. Il possède désormais à un degré éminent le don de faire surgir devant le spectateur la vision précise d'un coin du passé, de lui donner la sensation nette des forces historiques dont il montre la conflit. Dans Wallenstein, c'est l'époque de la guerre de Trente ans qu'il évoque avec une extraordinaire puissance; le Camp de Wallenstein tout entier n'est qu'une admirable peinture de milieu d'un relief admirable et nous fait connaîre, non point des caractères individuels, mais l'âme même de cette armée qui suit la fortune du duc de Friedland, de cette foule anonyme avec ses passions et ses enthousiasmes, ses misères, sa grandeur et sa force. Marie Stuart et la Pucelle d'Orléans sont des oeuvres de bien moindre envergure; dans la peinture des caractères, l'auteur ne s'est plus imposé le même effort d'impartialité que dans Wallenstein et a franchement pris parti pour ses héroïnes, Marie Stuart et Jeanne d'Arc, contre leurs adversaires Elisabeth et Talbot. Ces deux drames n'en ont pas moins l'un et l'autre une vaste toile de fond historique l'une nous montre, derrière le conflit des deux reines, la lutte du Protestantisme Dans Guillaume Tell « Les actions des humains, dit-il, sont des semences qu'ils jettent dans la terre obscure de l'avenir et confient, pleins d'espoir, à la puissance du Destin. Il faut donc s'enquérir du temps des semailles, choisir avec soin l'heure favorable indiquée par les étoiles ».Cette foi dans sa destinée supérieure fait en même temps sa force et sa faiblesse : elle l'élève à cent coudées au-dessus des ambitieux terre à terre qui l'entourent, mais elle le leurre aussi par de trop vastes espoirs, par des mirages décevants; elle le frappe d'aveuglement comme les héros Une implacable fatalité met en oeuvre les fautes commises par les divers acteurs du drame - dissimulation d'Isabelle, dissensions des deux frères ennemis, allures mystérieuses de don Manuel, violence irréfléchie de don César, imprudence de Béatrice - pour les précipiter dans un effroyable abîme de calamités. Ils périssent ainsi non pas innocents - Oedipe Il nous reste enfin à signaler, comme trait caractéristique des drames de la maturité de Schiller, le soin avec lequel le poète, tout en cherchant à donner autant de réalisme que possible à ses oeuvres, fuit en même temps le naturalisme. Dans ses premiers drames, le souci de la belle forme est encore à peu près absent, et dans Intrigue et Amour où il décrit avec une frappante vérité des scènes de vie contemporaine, il arrive assez près du pur naturalisme. Mais dans Don Carlos déjà, il s'éloigne, par l'emploi du vers, de l'imitation pure et simple de la réalité. Et l'étude approfondie des Grecs le confirme dans cette tendance idéaliste. De même que Goethe avait rapporté d'Italie le culte de la belle forme et prescrivait à l'artiste de s'élever de la simple imitation de la nature jusqu'au « style », ainsi Schiller proclame lui aussi que « reproduire exactement la réalité n'est pas décrire la nature », que « la nature n'est qu'une idée de l'esprit qui ne tombe jamais sous les sens », et que par suite, « l'art ne devient vrai qu'en abandonnant entièrement la réalité pour devenir purement idéal ».Rien n'est donc plus funeste, au point de vue artistique, que d'exiger du poète dramatique qu'il donne un calque exact de la nature, qu'il procure l'illusion de la réalité: quand même il y parviendrait, ce ne serait là « qu'un misérable tour de passe-passe ». Ce à quoi il doit viser, c'est à donner à ses oeuvres du style, une vérité idéale. A ce point de vue, le drame grec avec ses choeurs lyriques, avec la haute généralité de ses caractères, avec la beauté en quelque sorte plastique de son action simplifiée et condensée, est un modèle incomparable pour le poète moderne. La tragédie française classique elle-même, si décriée jadis par Lessing, peut de même exercer un effet salutaire sur le goût du public. Schiller condamne toujours, il est vrai, « les gestes pompeux de sa fausse dignité » et la tient, lui aussi, pour « une fausse muse que l'on a cessé d'honorer »; mais du moins il reconnaît qu'elle est une école d'idéalisme : « Pour le Français, la scène est une enceinte sacrée; les accents négligés et rudes de la nature sont bannis de son domaine solennel; là, chez lui, la parole même s'élève jusqu'au chant: c'est l'empire de l'harmonie et de la beauté ».A cet égard, la tragédie française mérite le respect de ceux qui ont le souci de l'art véritable et savent que, sur les planches de la scène, surgit un monde idéal où «-l'apparence ne doit jamais atteindre la réalité », où « l'émotion n'est pas fondée sur une excitation des sens ». Conformément à cette poétique, Schiller s'efforce toujours de « faire beau». Wallenstein, qui avait été commencé en prose, est ensuite mis en vers ïambiques « afin qu'il remplisse jusqu'à la dernière toutes les conditions qu'on peut exiger d'une tragédie parfaite ».
« comme une muraille vivante dont s'entoure la tragédie pour s'isoler rigoureusement du monde réel et s'assurer le terrain idéal, la liberté poétique dont elle a besoin ».Et il s'efforce de donner à la Fiancée toute la beauté de forme de la tragédie grecque. Par le choix des métaphores et alliances de mots, par l'usage fréquent de mots composés parfois nouvellement créés, il imite les procédés de style de la tragédie grecque; de plus, il interrompt l'action par des intermèdes d'une admirable envolée lyrique qu'il confie au choeur et qu'il écrit dans les mètres les plus variés; dans les parties plus proprement dramatiques, il donne souvent à son vers une couleur lyrique par l'usage assez fréquent de la rime, et souvent aussi il fait usage de l'artifice fréquemment employé par les tragiques grecs de la stichomythie ou du parallélisme des répliques. Par cette recherche de la beauté formelle et par l'importance accordée à l'élément lyrique dans le drame, il semble que Schiller tende à rapprocher le drame littéraire de l'opéra |
| . |
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|