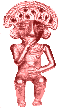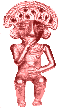
H. Lichtenberger
ca.1900 | Les années de maturité En 1794 se produit un événenement qui donne à la vie de Schiller une orientation nouvelle : il entre en relations intimes avec Goethe. En 1788, déjà, il lui avait été présenté à Rudolstadt par les dames de Lengefeld qui désiraient rapprocher les deux poètes. Mais cette première entrevue n'avait pas eu de résultats. Goethe revenait d'Italie épris de la sereine tranquillité et du grand style des oeuvres de l'Antiquité classique, amoureux de beauté, de mesure. Comment eût-il apprécié l'auteur des Brigands et de Don Carlos , dont l'idéalisme révolutionnaire lui paraissait l'antipode de son propre génie si foncièrement réaliste et objectif, et en qui il voyait le représentant d'une jeune génération dont il ne partageait pas les tendances. Il tint donc Schiller à l'écart et celui-ci fut si blessé de cette réserve qu'il se sentit pendant quelque temps partagé, à l'égard de Goethe, entre l'amour et la haine : il alla même jusqu'à écrire à Koerner que Goethe lui semblait un égoïste de grande marque, doué du redoutable pouvoir de s'attacher les autres sans jamais se donner lui-même. Pendant cinq ans, les deux poètes vécurent tout proches voisins, l'un à Weimar, l'autre à léna , dont l'idéalisme révolutionnaire lui paraissait l'antipode de son propre génie si foncièrement réaliste et objectif, et en qui il voyait le représentant d'une jeune génération dont il ne partageait pas les tendances. Il tint donc Schiller à l'écart et celui-ci fut si blessé de cette réserve qu'il se sentit pendant quelque temps partagé, à l'égard de Goethe, entre l'amour et la haine : il alla même jusqu'à écrire à Koerner que Goethe lui semblait un égoïste de grande marque, doué du redoutable pouvoir de s'attacher les autres sans jamais se donner lui-même. Pendant cinq ans, les deux poètes vécurent tout proches voisins, l'un à Weimar, l'autre à léna sans se connaître, sans soupçonner que, par des voies différentes et avec des natures foncièrement opposées ils étaient arrivés à peu près à la même conception de l'art. sans se connaître, sans soupçonner que, par des voies différentes et avec des natures foncièrement opposées ils étaient arrivés à peu près à la même conception de l'art. Vers le milieu de 1794, le rapprochement se fit par une circonstance fortuite. Schiller demanda à Goethe sa collaboration à une Revue, Die Horen, pour laquelle il sollicitait le concours des plus grands écrivains de l'Allemagne. Goethe accepta. Quelques semaines après, les deux poètes se rencontrèrent au sortir d'une séance de la Société d'histoire naturelle d'léna; cette fois ils se comprirent. Tardivement nouée, leur amitié n'en fut que plus solide, car le hasard les avait réunis au moment où ils pouvaient utilement se rencontrer. « Désormais, écrivait Schiller à Goethe, je puis espérer que nous ferons de compagnie le reste du chemin, quelque long qu'il soit encore, et cela avec d'autant plus de profit que, dans un long voyage, ce sont toujours les derniers compagnons qui ont le plus à se dire.-» Leur amitié fut sans nuages. Entretenue par de fréquentes visites et par une volumineuse correspondance sur les sujets les plus variés, elle subsista jusqu'à la mort de Schiller sans qu'aucun dissentiment pût jamais se glisser entre eux. Cette intimité fut, pour Schiller surtout, un bienfait inestimable. Aussi clairvoyant que modeste, il avait fort bien conscience des défauts inhérents à la nature même de son art : il savait qu'il avait une connaissance trop restreinte du monde extérieur, une expérience insuffisante des gens et des choses; il sentait parfaitement que, à moitié philosophe et à moitié poète, il courait à tout instant le risque, soit de se laisser entraîner par son imagination dans ses spéculations philosophiques, soit surtout de rester trop philosophe et trop abstrait dans ses oeuvres poétiques. Or en Goethe il trouvait tout juste, à un degré éminent, les dons qui lui faisaient défaut : la faculté d'intuition qui fait le vrai poète, le don d'observation objective et scientifique, l'intelligence profonde de la vie si riche et si complexe de l'univers. Il trouva aussi en lui un ami complaisant toujours prêt à discuter avec lui ses oeuvres nouvelles, à le fournir d'idées, à lui donner des renseignements, un sage conseiller qui lui donnait des notions d'hygiène, lui apprenait à mieux organiser ses journées, à répartir plus régulièrement son temps entre la veille et le sommeil, un directeur de théâtre toujours empressé à jouer ses pièces, à les monter avec un soin minutieux, un critique d'une merveilleuse sûreté pour guider son goût et pour apprendre au public ce qu'il devait penser de ses oeuvres nouvelles.
Stimulé par les conseils et l'exemple de Goethe, Schiller revient maintenant à la poésie qu'il avait quittée jadis pour se livrer à l'étude de l'histoire et de la philosophie. Las des théories et des abstractions, il se décide à fermer pour un temps au moins l'échoppe philosophique et à reprendre, mûri par six années de labeur opiniâtre, son ancien métier de poète. Il se met au travail avec une énergie admirable. Miné par une maladie qui ne pardonne pas et qui, au début de 1791 déjà, avait failli l'enlever, Schiller se sait perdu. Mais il veut du moins « sauver de la catastrophe ce qui mérite d'être sauvé » : avec une activité fébrile, il cherche à tirer le meilleur parti possible des quelques années de répit que lui laisse la mort; et il réussit effectivement à fournir, pendant les dix années de son intimité avec Goethe, une somme de travail prodigieuse. Dans ce court laps de temps, il produit cinq grands drames dont la trilogie de Wallenstein, il compose une série d'adaptations ou de traductions de pièces étrangères, il écrit une quantité de poésies lyriques dont quelques-unes, comme Die Glocke, fort étendues. En même temps, il s'occupe activement du théâtre de Weimar, il dirige d'importantes publications comme Die Horen (1794-98) et le Musenalmanach (1796-1800). Enfin il entretient une volumineuse correspondance avec ses amis, avec Goethe, Koerner et Guillaume de Humboldt en particulier. C'était un besoin pour lui de mener de front de nombreux travaux; il mettait une oeuvre nouvelle en train avant d'avoir terminé celle dont il s'occupait. Travailleur infatigable, il se soutenait dans les derniers temps de sa vie par des moyens violents quand son corps épuisé refusait le service. Ce régime de surmenage hâta l'oeuvre de la maladie. Le 10 mai 1805, un accès de fièvre catarrhale l'emportait à quarante-cinq ans, en pleine maturité, tandis qu'il préparait un nouveau drame, Demetrius. (Henri Lichtenberger). dont quelques-unes, comme Die Glocke, fort étendues. En même temps, il s'occupe activement du théâtre de Weimar, il dirige d'importantes publications comme Die Horen (1794-98) et le Musenalmanach (1796-1800). Enfin il entretient une volumineuse correspondance avec ses amis, avec Goethe, Koerner et Guillaume de Humboldt en particulier. C'était un besoin pour lui de mener de front de nombreux travaux; il mettait une oeuvre nouvelle en train avant d'avoir terminé celle dont il s'occupait. Travailleur infatigable, il se soutenait dans les derniers temps de sa vie par des moyens violents quand son corps épuisé refusait le service. Ce régime de surmenage hâta l'oeuvre de la maladie. Le 10 mai 1805, un accès de fièvre catarrhale l'emportait à quarante-cinq ans, en pleine maturité, tandis qu'il préparait un nouveau drame, Demetrius. (Henri Lichtenberger). | |