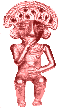 La Harpe
1820. | En 1738, [La Condamine] employa les premiers jours de septembre à faire un voyage au-delà de la cordillère orientale, à Tagualo, district peu connu, dont il leva la carte. Le marquis de Maënza, seigneur de tout ce canton, avait fait construire sur le sommet de la montagne de Gnougnouourcou un logement pour lui, et un abri pour ses instruments; mais, par un contretemps qui n'était que trop ordinaire, le brouillard rendit ses peines et tous ses préparatifs inutiles; en revenant, il se détourna un peu du chemin pour voir le lac de Quilotoa, situé sur le haut d'une montagne dont on lui avait raconté des choses merveilleuses. Ce lac est renfermé dans une enceinte de rochers escarpés, qui ne lui parut pas avoir beaucoup plus de deux cents toises de diamètre. quoiqu'on lui suppose une lieue de tour. Il n'eut ni le temps ni la commodité de le sonder; il s'en fallait alors environ vingt toises que l'eau n'atteignît les bords. On lui assura qu'elle, était montée depuis un an à cette hauteur, qu'elle avait près des bords plus de quarante toises de profondeur, et qu'il était longtemps resté dans son milieu une île et une bergerie que les eaux, en s'élevant peu à peu, avaient enfin tout à fait couvertes. La Condamine ne garantit point la vérité de ces faits, et quoiqu'ils n'aient rien, d'impossible, il avoue qu'il avait regardé comme une fable ce qu'on lui avait dit sur la foi des traditions péruviennes, que, peu après la formation du lac, il était sorti du milieu de ses eaux des tourbillons de flamme, et qu'elles avaient bouilli plus d'un mois; mais, depuis son retour en France , il a su de M. Maënza, qui était à Paris en 1751, et qui avait douté aussi de tous les faits précédents, qu'au mois de décembre 1740, il s'éleva pendant une nuit, de la surface du même lac, une flamme qui consuma tous les arbustes de ses bords, et fit périr les troupeaux qui se trouvèrent aux environs. Depuis ce temps tout a conservé sa situation ordinaire : la couleur de l'eau est verdâtre; on lui attribue un mauvais goût; et quoique les troupeaux voisins en boivent, on ne voit sur ses bords ni même dans le voisinage, aucune sorte d'oiseaux et d'animaux aquatiques. Celle qui coule du côté de la montagne est salée : les vaches, les moutons, les chevaux et les mulets en paraissent fort avides. Du côté opposé, les sources donnent une eau sans goût, qui passe pour une eau des meilleures du pays. Il y a beaucoup d'apparence que le bassin de ce lac est l'entonnoir de la mine d'un volcan qui, après avoir joué dans les siècles passés, se renflamme encore quelquefois. Le bassin a pu se remplir d'eau, par quelque communication souterraine avec des montagnes plus élevées, , il a su de M. Maënza, qui était à Paris en 1751, et qui avait douté aussi de tous les faits précédents, qu'au mois de décembre 1740, il s'éleva pendant une nuit, de la surface du même lac, une flamme qui consuma tous les arbustes de ses bords, et fit périr les troupeaux qui se trouvèrent aux environs. Depuis ce temps tout a conservé sa situation ordinaire : la couleur de l'eau est verdâtre; on lui attribue un mauvais goût; et quoique les troupeaux voisins en boivent, on ne voit sur ses bords ni même dans le voisinage, aucune sorte d'oiseaux et d'animaux aquatiques. Celle qui coule du côté de la montagne est salée : les vaches, les moutons, les chevaux et les mulets en paraissent fort avides. Du côté opposé, les sources donnent une eau sans goût, qui passe pour une eau des meilleures du pays. Il y a beaucoup d'apparence que le bassin de ce lac est l'entonnoir de la mine d'un volcan qui, après avoir joué dans les siècles passés, se renflamme encore quelquefois. Le bassin a pu se remplir d'eau, par quelque communication souterraine avec des montagnes plus élevées, Un des points que Bouguer et La Condamine reconnurent ensemble, était une petite montagne nommée Nabouco, voisine des villages de Pénipé et de Guanando, où l'on recueille de fort belle cochenille, sur une espèce particulière d'opuntia ou raquette. La base de la montagne de Nabouco est de marbre; dans les ravines des environs, La Condamine en découvrit de très beaux et de richement veinés de plusieurs couleurs: Il y vit aussi des rochers d'une pierre blanche, aussi transparente que l'albâtre, et plus dure que le marbre; elle se casse par éclats, et rend beaucoup d'étincelles : on assure qu'un feu violent la liquéfie. L'académicien, soupçonnant qu'elle pouvait être employée à la porcelaine, en recueillit des fragments qui faisaient partie de l'envoi qu'il fit en 1740, pour le cabinet au Jardin du roi. Il trouva aussi, en descendant plus bas, une carrière d'ardoise, pierre dont on ne fait aucun usage dans le pays, et qui n'y est pas même connue. Sur la fin du mois d'août 1739, La Condamine n'ayant pu se défendre d'assister à une course de taureaux qui se faisait à Cuenca, il fut témoin d'un triste spectacle. Seniergues, chirurgien de la compagnie française, honoré par conséquent de la protection de deux souverains, fut assassiné en plein jour, à l'occasion d'une querelle particulière. Ce meurtre fut suivi d'un soulèvement général contre les mathématiciens, sans en excepter les deux officiers espagnols, et la plupart virent leur vie menacée. La Condamine, que Seniergues avait nommé, en mourant, son exécuteur testamentaire, se trouva forcé d'intenter, et de soutenir pour l'honneur du mort, un procès criminel qui dura près de trois ans. Les coupables en furent quittes pour quelques années d'un bannissement qu'ils n'observèrent point, et pour une amende qui ne fut pas payée; ils furent même absous après le départ des académiciens; mais le plus criminel ne laissant pas de craindre la justice, quelquefois sévère quoique toujours lente, du conseil d'Espagne , prit le parti de se faire prêtre. , prit le parti de se faire prêtre. Les embarras de cet événement, qui donnèrent un nouveau lustre au caractère noble et généreux de La Condamine, ne furent pas adoucis par les divertissements qu'on lui procurait quelquefois. Les Indiens de la terre de Tarqui, où il se trouvait à la fin de décembre, sont dans l'habitude de célébrer tous les ans une fête qui n'a rien de barbare ni de sauvage; et qu'ils ont imitée de leurs conquérants espagnols, comme ceux-ci l'ont autrefois empruntée des Maures. Ce sont des courses de chevaux qui forment des ballets figurés. Les Indiens louent des parures destinées à cet usage, et semblables à des habits de théâtre; ils se fournissent de lances et de harnais éclatants pour leurs chevaux, qu'ils manient avec peu d'adresse et peu de grâce. Leurs femmes leur servent d'écuyers dans cette occasion, et c'est le jour de l'année où la misère de leur condition se fait le moins sentir. Les maris dépensent en un jour plus qu'ils ne gagnent dans l'espace d'un an; car le maitre ne contribue guère au spectacle qu'en l'honorant de son assistance.
Cette espèce de carrousel eut pour intermède des scènes pantomimes de quelques jeunes métis, qui ont le talent de contrefaire parfaitement tout ce qu'ils voient, et même ce qu'ils ne comprennent point. Les académiciens en firent alors une fort agréable expérience. "Je les avais vus plusieurs fois, raconte La Condamine, nous regarder attentivement tandis que nous prenions des hauteurs  du Soleil du Soleil pour régler nos pendules. Ce devait être pour eux un mystère impénétrable qu'un observateur à genoux au pied d'un quart de cercle, la tête renversée dans une attitude gênante, tenant d'une main un verre enfumé à maniant de l'autre les vis du pied de l'instrument, portant alternativement son oeil à la lunette et à la division pour examiner le fil à plomb, courant de temps en temps regarder la minute et la seconde à une, pendule, écrivant quelques chiffres sur un papier, et reprenant sa première situation : aucun de nos mouvements n'avait échappé aux regards curieux de nos spectateurs. Au moment que nous nous y attendions le moins, parurent sur l'arène de grands quarts de cercles de bois et de papier peint, assez heureusement imités, et nous vîmes ces bouffons nous contrefaire tous avec tant de vérité, que chacun de nous, et moi le premier, ne put s'empêcher de se reconnaître. Tout cela fut exécuté d'une manière si comique, que, n'ayant rien vu de plus plaisant pendant les dix ans du voyage, il me prit une forte envie de rire qui me fit oublier pour quelques moments mes affaires les plus sérieuses." pour régler nos pendules. Ce devait être pour eux un mystère impénétrable qu'un observateur à genoux au pied d'un quart de cercle, la tête renversée dans une attitude gênante, tenant d'une main un verre enfumé à maniant de l'autre les vis du pied de l'instrument, portant alternativement son oeil à la lunette et à la division pour examiner le fil à plomb, courant de temps en temps regarder la minute et la seconde à une, pendule, écrivant quelques chiffres sur un papier, et reprenant sa première situation : aucun de nos mouvements n'avait échappé aux regards curieux de nos spectateurs. Au moment que nous nous y attendions le moins, parurent sur l'arène de grands quarts de cercles de bois et de papier peint, assez heureusement imités, et nous vîmes ces bouffons nous contrefaire tous avec tant de vérité, que chacun de nous, et moi le premier, ne put s'empêcher de se reconnaître. Tout cela fut exécuté d'une manière si comique, que, n'ayant rien vu de plus plaisant pendant les dix ans du voyage, il me prit une forte envie de rire qui me fit oublier pour quelques moments mes affaires les plus sérieuses." Depuis l'année 1735, La Condamine avait envoyé à l'Académie différentes raretés, dont il donne une liste curieuse. On voit, au cabinet du Jardin du roi, les premiers envois faits de nos îles et de Porto-Bello en 1735, et un autre de Quito en 1735, et un autre de Quito en 1737. Une caisse embarquée à Lima, en 1737, pour Panama, contenait, outre un vase d'argent du temps des Incas, plusieurs petites idoles d'argent des anciens Péruviens, un grand nombre de vases antiques d'argile de diverses couleurs, ornés d'animaux; quelques-uns avec un tel artifice, que l'eau formait un sifflement lorsqu'on la versait; un beau morceau de cristal de roche; plusieurs pétrifications et coquilles fossiles du Chili; une belle plante marine, adhérente à un caillou lisse; dix-huit coquilles rares; un aimant de Guancavelica; une dent molaire pétrifiée en agate, du poids de deux livres; plusieurs baumes secs et liquides; un dictionnaire et une grammaire de la langue des Incas. Une caisse, perdue à Carthagène en 1737. Une caisse embarquée à Lima, en 1737, pour Panama, contenait, outre un vase d'argent du temps des Incas, plusieurs petites idoles d'argent des anciens Péruviens, un grand nombre de vases antiques d'argile de diverses couleurs, ornés d'animaux; quelques-uns avec un tel artifice, que l'eau formait un sifflement lorsqu'on la versait; un beau morceau de cristal de roche; plusieurs pétrifications et coquilles fossiles du Chili; une belle plante marine, adhérente à un caillou lisse; dix-huit coquilles rares; un aimant de Guancavelica; une dent molaire pétrifiée en agate, du poids de deux livres; plusieurs baumes secs et liquides; un dictionnaire et une grammaire de la langue des Incas. Une caisse, perdue à Carthagène , contenait quelques vases d'argile, semblables aux précédents; plusieurs, autres vases, des calebasses de différentes formes ornés de dessins faits à la main avec un charbon brûlant, et quelques-unes montées en argent avec leurs pieds; des incrustations pierreuses du ruisseau de Tanlagoa, entre autres sur une planche qui y avait été plongée trois ans, et où les caractères que La Condamine y avait tracés paraissaient en relief; plusieurs marcassites taillées; de la pierre appelée miroir de l'Inca; un grand nombre de fragments de cristal noirâtre nommé, dans le pays, pierre de Gallinazo; deux pièces de bois pétrifié; plusieurs pierres de différentes formes, qui ont servi de haches aux anciens Américains; divers mortiers et vases d'une espèce d'albâtre; un. petit crocodile de la rivière de Guayaquil; la tête et la peau empaillées d'une belle couleuvre nommée coral, dont les anneaux sont couleur de feu et noirs; etc. , contenait quelques vases d'argile, semblables aux précédents; plusieurs, autres vases, des calebasses de différentes formes ornés de dessins faits à la main avec un charbon brûlant, et quelques-unes montées en argent avec leurs pieds; des incrustations pierreuses du ruisseau de Tanlagoa, entre autres sur une planche qui y avait été plongée trois ans, et où les caractères que La Condamine y avait tracés paraissaient en relief; plusieurs marcassites taillées; de la pierre appelée miroir de l'Inca; un grand nombre de fragments de cristal noirâtre nommé, dans le pays, pierre de Gallinazo; deux pièces de bois pétrifié; plusieurs pierres de différentes formes, qui ont servi de haches aux anciens Américains; divers mortiers et vases d'une espèce d'albâtre; un. petit crocodile de la rivière de Guayaquil; la tête et la peau empaillées d'une belle couleuvre nommée coral, dont les anneaux sont couleur de feu et noirs; etc. Ainsi l'attention et les soins de l'académicien s'étendaient à tout. II marque l'époque du fâcheux accident qui le priva de l'ouie. Ce fut en 1741, au retour d'une course qu'il fit derrière les montagnes, à l'Ouest de Quito, en allant reconnaître le nouveau chemin que don Pedro Maldonado venait d'ouvrir de Quito à la rivière des Émeraudes. Une fluxion violente dans la tête, fruit des alternatives de froid et de chaud auxquels il s'exposait en observant jour et nuit, et souvent sur un terrain froid et humide, lui causa cette cruelle infirmité, qui dura le reste de sa vie. A l'assaut du Pichincha.
Un voyage remarquable que La Condamine fit au commencement de juin avec Bouguer, fut celui du volcan de Pichincha, le Vésuve de Quito, au pied duquel cette ville est située. Ils en étaient voisins depuis sept ans, sans l'avoir vu d'aussi près qu'il était naturel de le désirer, et le beau temps les y invitait. Mais on conçoit qu'un sujet de cette nature demande la narration du voyageur même. La partie supérieure du Pichincha se divise en trois sommets, éloignés l'un de l'autre de douze ou quinze cents toises, et presque également hauts. Le plus oriental est un rocher escarpé, sur lequel les deux académiciens avaient campé en 1737. Le sommet occidental, par où les flammes se firent jour en 1538, 1577 et 1660, est celui qu'ils n'avaient encore vu que de loin, et que La Condamine se proposait de reconnaître plus particulièrement. "Je fis chercher, dit-il, à Quito et aux environs, tous les gens qui prétendaient avoir vu de près cette bouche du volcan, surtout ceux qui se vantaient d'y être descendus. J'engageai celui qui me parut le mieux instruit à nous accompagner. Deux jours avant notre départ, nous envoyâmes monter une tente à l'endroit le plus commode, et le plus à portée de l'objet de notre curiosité. Des mules devaient porter notre bagage, un quart de cercle et nos provisions. Le 12 juin, jour marqué, les muletiers ne parurent point; il en fallut aller chercher d'autres. L'impatience fit prendre les devants à M. Bouguer, qui arriva, sur les trois heures après midi, à la tente. A force d'argent et d'ordres des alcades, je trouvai deux muletiers, dont l'un s'enfuit le moment d'après. Je ne laissai point de partir avec l'autre, que je gardais à vue. II n'y avait qu'environ trois lieues à faire. Je connaissais le chemin jusqu'à l'endroit d'où l'on devait voir là tente déjà posée, et j'étais accompagné d'un jeune garçon qui avait aidé à la dresser. Je sortis de Quito sur les deux heures après midi, avec le jeune homme et un valet du pays, tous deux montés, le muletier américain, et deux mules chargées de mes instruments, de mon lit et de nos vivres. Pour plus de sûreté, je ne refusai point un métis, qui, de son propre mouvement, s'offrit à me guider. Il me fit faire halte dans une ferme, où je congédiai mon Américain venu de force, après en avoir engagé un autre à me suivre de bon gré. On verra si j'avais poussé trop loin les précautions. et aux environs, tous les gens qui prétendaient avoir vu de près cette bouche du volcan, surtout ceux qui se vantaient d'y être descendus. J'engageai celui qui me parut le mieux instruit à nous accompagner. Deux jours avant notre départ, nous envoyâmes monter une tente à l'endroit le plus commode, et le plus à portée de l'objet de notre curiosité. Des mules devaient porter notre bagage, un quart de cercle et nos provisions. Le 12 juin, jour marqué, les muletiers ne parurent point; il en fallut aller chercher d'autres. L'impatience fit prendre les devants à M. Bouguer, qui arriva, sur les trois heures après midi, à la tente. A force d'argent et d'ordres des alcades, je trouvai deux muletiers, dont l'un s'enfuit le moment d'après. Je ne laissai point de partir avec l'autre, que je gardais à vue. II n'y avait qu'environ trois lieues à faire. Je connaissais le chemin jusqu'à l'endroit d'où l'on devait voir là tente déjà posée, et j'étais accompagné d'un jeune garçon qui avait aidé à la dresser. Je sortis de Quito sur les deux heures après midi, avec le jeune homme et un valet du pays, tous deux montés, le muletier américain, et deux mules chargées de mes instruments, de mon lit et de nos vivres. Pour plus de sûreté, je ne refusai point un métis, qui, de son propre mouvement, s'offrit à me guider. Il me fit faire halte dans une ferme, où je congédiai mon Américain venu de force, après en avoir engagé un autre à me suivre de bon gré. On verra si j'avais poussé trop loin les précautions. A mi-côte, nous rencontrâmes un cheval à la pâture; mon Américain lui jeta un lac, et sauta dessus. Quoique les chevaux, à Quito , ne soient pas au premier qui s'en saisit, comme dans les plaines de Buenos Aires , ne soient pas au premier qui s'en saisit, comme dans les plaines de Buenos Aires , je ne m'opposai point à l'heureux hasard qui mettait mon muletier, en état d'avancer plus vite. Il paraissait plein de bonne volonté, lui et ses camarades. , je ne m'opposai point à l'heureux hasard qui mettait mon muletier, en état d'avancer plus vite. Il paraissait plein de bonne volonté, lui et ses camarades. Nous arrivâmes un peu avant le coucher du soleil , au plus haut de la.partie de la montagne où l'on peut atteindre à cheval. Il était tombé les nuits précédentes une si grande quantité de neige, qu'on ne voyait plus aucune trace de chemin : mes guides me parurent incertains. Cependant il ne nous restait qu'un ravin à passer, mais profond de quatre-vingts toises et plus. Nous voyions la tente au-delà. Je mis pied à terre avec celui qui avait aidé à la poser, pour m'assurer si les mules pouvaient descendre avec leur charge. Quand j'eus reconnu que la descente était praticable, j'appelai d'en-bas; on ne me répondit point. Je remontai, et je trouvai mon valet seul, avec les mulets. L'Américain et le métis, qui s'étaient offerts de bonne grâce, avaient disparu. Je ne crus pas devoir passer outre sans guides, surtout avec des mules fort mal équipées. Celui qui avait monté la tente ne connaissait pas le gué de la ravine, ni le chemin pour remonter à l'autre bord. Nous étions loin de toute habitation : une cabane que M. Godin avait commandée depuis un an, pour y faire quelques expériences, n'était qu'à un quart de lieue de nous; mais j'avais reconnu en passant qu'elle n'était pas encore couverte, et qu'elle ne pouvait me servir d'abri. Je n'eus d'autre parti à prendre que de revenir sur mes pas pour regagner la ferme où j'avais pris le Péruvien qui m'avait quitté. A chaque instant il me fallait descendre de cheval pour raccommoder les charges qui tournaient sans cesse. L'une n'était pas plus tôt rajustée que l'autre se dérangeait: mon valet et le jeune métis n'étaient guère plus habiles muletiers que moi. Il était déjà huit heures, et depuis la fuite de mes guides, nous n'avions pas fait l'espace d'une lieue; il nous en restait au moins autant. Je pris les devants pour aller chercher du secours. , au plus haut de la.partie de la montagne où l'on peut atteindre à cheval. Il était tombé les nuits précédentes une si grande quantité de neige, qu'on ne voyait plus aucune trace de chemin : mes guides me parurent incertains. Cependant il ne nous restait qu'un ravin à passer, mais profond de quatre-vingts toises et plus. Nous voyions la tente au-delà. Je mis pied à terre avec celui qui avait aidé à la poser, pour m'assurer si les mules pouvaient descendre avec leur charge. Quand j'eus reconnu que la descente était praticable, j'appelai d'en-bas; on ne me répondit point. Je remontai, et je trouvai mon valet seul, avec les mulets. L'Américain et le métis, qui s'étaient offerts de bonne grâce, avaient disparu. Je ne crus pas devoir passer outre sans guides, surtout avec des mules fort mal équipées. Celui qui avait monté la tente ne connaissait pas le gué de la ravine, ni le chemin pour remonter à l'autre bord. Nous étions loin de toute habitation : une cabane que M. Godin avait commandée depuis un an, pour y faire quelques expériences, n'était qu'à un quart de lieue de nous; mais j'avais reconnu en passant qu'elle n'était pas encore couverte, et qu'elle ne pouvait me servir d'abri. Je n'eus d'autre parti à prendre que de revenir sur mes pas pour regagner la ferme où j'avais pris le Péruvien qui m'avait quitté. A chaque instant il me fallait descendre de cheval pour raccommoder les charges qui tournaient sans cesse. L'une n'était pas plus tôt rajustée que l'autre se dérangeait: mon valet et le jeune métis n'étaient guère plus habiles muletiers que moi. Il était déjà huit heures, et depuis la fuite de mes guides, nous n'avions pas fait l'espace d'une lieue; il nous en restait au moins autant. Je pris les devants pour aller chercher du secours. II faisait un fort beau clair de lune  , et je reconnaissais le terrain; mais à peine étais-je à moitié chemin de la ferme ; que je me vis tout d'un coup enveloppé d'un brouillard si épais, que je me perdis absolument. Je me trouvai engagé dans un bois taillis, bordé d'un fossé profond, et j'errais dans ce labyrinthe, sans en retrouver l'issue. J'étais descendu de ma mule pour tâcher de voir où je posais le pied. Mes souliers et mes bottines furent bientôt pénétrés d'eau, aussi bien qu'une longue cape espagnole d'un drap du pays, dont le poids était accablant. Je glissais et je tombais à chaque pas. Mon impatience était égale à ma lassitude. Je jugeais que le jour ne pouvait être éloigné; lorsque ma montre m'apprit qu'il n'était que minuit, et qu'il n'y avait que trois heures que ma situation durait; il en restait six jusqu'au jour. Une clarté qui ne dura qu'un moment me rendit l'espérance: je me tirai du bois, et j'entrevis le sommet d'une croupe avancée de. la montagne, sur lequel est une croix qui se voit de toutes les parties de Quito , et je reconnaissais le terrain; mais à peine étais-je à moitié chemin de la ferme ; que je me vis tout d'un coup enveloppé d'un brouillard si épais, que je me perdis absolument. Je me trouvai engagé dans un bois taillis, bordé d'un fossé profond, et j'errais dans ce labyrinthe, sans en retrouver l'issue. J'étais descendu de ma mule pour tâcher de voir où je posais le pied. Mes souliers et mes bottines furent bientôt pénétrés d'eau, aussi bien qu'une longue cape espagnole d'un drap du pays, dont le poids était accablant. Je glissais et je tombais à chaque pas. Mon impatience était égale à ma lassitude. Je jugeais que le jour ne pouvait être éloigné; lorsque ma montre m'apprit qu'il n'était que minuit, et qu'il n'y avait que trois heures que ma situation durait; il en restait six jusqu'au jour. Une clarté qui ne dura qu'un moment me rendit l'espérance: je me tirai du bois, et j'entrevis le sommet d'une croupe avancée de. la montagne, sur lequel est une croix qui se voit de toutes les parties de Quito . Je jugeai que de là il me serait facile de m'orienter, et j'y dirigeai ma route. . Je jugeai que de là il me serait facile de m'orienter, et j'y dirigeai ma route. Malgré le brouillard qui redoublait, j'étais guidé par la pente du terrain. Le sol était couvert de hautes herbes : elles m'atteignaient presque à la ceinture; et mouillaient la seule partie de mes habits qui eût échappé à la pluie. Je me trouvais à peu près à cette hauteur où il cesse de neiger et où il commence à pleuvoir; ce qui tombait, sans être ni pluie ni neige, était aussi pénétrant que l'une , et aussi froid que l'autre. Enfin j'arrivai à la croix, dont je connaissais les environs. Je cherchai inutilement une grotte voisine, où j'aurais pu trouver un asile; le brouillard et les ténèbres avaient augmenté depuis le coucher de la Lune: Je craignais de me perdre encore, et je m'arrêtai au milieu d'un tas d'herbes foulées, qui semblaient avoir servi de gîte à quelque bête féroce. Je m'accroupis enveloppé dans mon manteau, le bras passé dans la bride de ma mule; pour là laisser paître plus librement, je lui ôtai son mors, et je fis de ses rênes une espèce de licou, que j'allongeai avec mon mouchoir. C'est ainsi que je passai la nuit, tout le corps mouillé, et les pieds dans la neige fondue; en vain je les agitai pour leur procurer quelque chaleur par le mouvement; vers les quatre heures du matin, je ne les sentis absolument plus; je crus les avoir gelés, et je suis encore persuadé que je n'aurais pas échappé à ce danger, difficile à prévoir sur un volcan, si je ne m'étais avisé d'un expédient qui me réussit; je les réchauffai par un bain naturel, que je laisse à deviner. Le froid augmenta vers la pointe du jour; à la première lueur du crépuscule, je crus ma mule pétrifiée; elle était immobile. Un caparaçon de neige, frangé de verglas, couvrait la selle et le harnais. Mon chapeau et mon manteau étaient enduits du même vernis, et raides de glace. Je me mis en mouvement, mais je ne pouvais qu'aller et revenir sur mes pas, en attendant le grand jour, que le brouillard retardait. Enfin, sur les sept heures, je descendis à la ferme, hérissé de frimas. L'économe était absent. Sa femme, effrayée à ma vue, prit la fuite : je ne pus atteindre que deux vieilles Américaines, qui n'avaient pas eu la force de courir assez vite pour m'échapper. Je leur faisais allumer du feu, lorsque je vis entrer un de mes gens, aussi sec que j'étais mouillé. Son camarade et lui, voyant croître le brouillard, lorsque je les eus quittés, avaient fait halte et s'étaient mis à couvert, avec mes provisions, sous des cuirs passés à l'huile qui servaient de couvertures à mes mules. Ils avaient soupé à discrétion de mes vivres sous ce pavillon, et dormi tranquillement sur mon matelas. Au point du jour, un grand nombre d'Américains de Quito , qui vont tous les matins prendre de la neige pour la porter à la ville, avaient passé fort près d'eux, sans qu'aucun eût voulu les aider à recharger. Le maître valet de la ferme se trouva de meilleure volonté; une petite gratification le fit partir avec le mien, et peu après je les vis revenir avec les mules et le bagage. , qui vont tous les matins prendre de la neige pour la porter à la ville, avaient passé fort près d'eux, sans qu'aucun eût voulu les aider à recharger. Le maître valet de la ferme se trouva de meilleure volonté; une petite gratification le fit partir avec le mien, et peu après je les vis revenir avec les mules et le bagage. Je descendis aussitôt à Quito , où je réparai la mauvaise nuit précédente. Le lendemain 14, à sept heures du matin, je me remis en chemin avec de nouveaux guides, qui ne le savaient pas mieux que les premiers: ils me firent faire le tour de la montagne. Après de nouvelles aventures, j'arrivai enfin à la tente où M. Bouguer était depuis deux jours. Faute des provisions que je portais, il avait été obligé de vivre frugalement; du reste, il n'était pas plus avancé que moi, si ce n'est qu'il avait passé de meilleures nuits. J'appris de lui qu'il s'était lassé la veille, et ce jour même, à chercher avec son guide un chemin qui pût le conduire à la bouche du volcan, du côté où elle paraît accessible. Nous employâmes le jour suivant à la même recherche, avec presque aussi peu de succès. Autant les pluies avaient été excessives cette année à Quito, autant la neige était tombée abondamment sur les montagnes. Le haut du Pichincha, qui, dans la belle saison, est souvent presque sans neige, en était entièrement couvert, plus de cent toises au-dessous de sa cime, à l'exception des pointes de rochers qui débordaient en quelques endroits. Tous les jours nous faisions à pied des marches de six à sept heures, tournant autour de cette masse sans pouvoir atteindre au sommet. Le terrain, du côté de l'orient, était coupé de ravins formés dans les sables par la chute des eaux : nous ne pouvions les franchir que difficilement, en nous aidant des pieds et des mains. A l'entrée de la nuit, nous regagnions notre tente, bien fatigués et fort mal instruits. , où je réparai la mauvaise nuit précédente. Le lendemain 14, à sept heures du matin, je me remis en chemin avec de nouveaux guides, qui ne le savaient pas mieux que les premiers: ils me firent faire le tour de la montagne. Après de nouvelles aventures, j'arrivai enfin à la tente où M. Bouguer était depuis deux jours. Faute des provisions que je portais, il avait été obligé de vivre frugalement; du reste, il n'était pas plus avancé que moi, si ce n'est qu'il avait passé de meilleures nuits. J'appris de lui qu'il s'était lassé la veille, et ce jour même, à chercher avec son guide un chemin qui pût le conduire à la bouche du volcan, du côté où elle paraît accessible. Nous employâmes le jour suivant à la même recherche, avec presque aussi peu de succès. Autant les pluies avaient été excessives cette année à Quito, autant la neige était tombée abondamment sur les montagnes. Le haut du Pichincha, qui, dans la belle saison, est souvent presque sans neige, en était entièrement couvert, plus de cent toises au-dessous de sa cime, à l'exception des pointes de rochers qui débordaient en quelques endroits. Tous les jours nous faisions à pied des marches de six à sept heures, tournant autour de cette masse sans pouvoir atteindre au sommet. Le terrain, du côté de l'orient, était coupé de ravins formés dans les sables par la chute des eaux : nous ne pouvions les franchir que difficilement, en nous aidant des pieds et des mains. A l'entrée de la nuit, nous regagnions notre tente, bien fatigués et fort mal instruits. Le 16, j'escaladai, avec beaucoup de peine, un des rochers saillants, dont le talus me parut très raide. Au-delà, le terrain était couvert d'une neige où j'enfonçai jusqu'au genou. Je ne laissai pas d'y monter environ dix toises. Ensuite je trouvai le rocher nu; puis alternativement d'autre neige, et d'autres pointes saillantes. Un épais brouillard, qui s'exhalait de la bouche du volcan, et qui se répandait aux environs, m'empêcha de rien distinguer. Je revins à la voix de M. Bouguer qui était resté en bas, et dont je ne voulais pas trop m'écarter. Nous abrégeâmes beaucoup le chemin au retour, en marchant à mi-côte, sur le bord inférieur de la neige; et un peu au-dessus de l'origine de ces cavées profondes, qu'il nous avait fallu monter et descendre l'une après l'autre, en allant d'abord à la découverte. Nous remarquâmes sur cette neige la, piste de certains animaux qu'on nomme lions à Quito , quoiqu'ils ressemblent fort peu aux vrais lions, et qu'ils soient beaucoup plus petits. En revenant, je reconnus un endroit où la pente était beaucoup plus douce et facilitait l'accès du sommet de la montagne. Je tentai de m'en approcher. Les pierres ponces que je rencontrais sous mes pas, et dont le nombre croissait à mesure que j'avançais du même côté, semblaient m'assurer que j'approchais de la bouche du volcan; mais la brume qui s'épaississait me fit reprendre le chemin de la tente. En descendant, j'essayai de glisser sur la neige, vers son bord inférieur, dans les endroits où elle était unie et la pente peu rapide. L'expérience me réussit; d'un élan, j'avançais quelquefois dix à douze toises, sans perdre l'équilibre; mais, lorsque, après cet exercice, je me retrouvai sur le sable, je m'aperçus au premier pas que mes souliers étaient sans semelles. , quoiqu'ils ressemblent fort peu aux vrais lions, et qu'ils soient beaucoup plus petits. En revenant, je reconnus un endroit où la pente était beaucoup plus douce et facilitait l'accès du sommet de la montagne. Je tentai de m'en approcher. Les pierres ponces que je rencontrais sous mes pas, et dont le nombre croissait à mesure que j'avançais du même côté, semblaient m'assurer que j'approchais de la bouche du volcan; mais la brume qui s'épaississait me fit reprendre le chemin de la tente. En descendant, j'essayai de glisser sur la neige, vers son bord inférieur, dans les endroits où elle était unie et la pente peu rapide. L'expérience me réussit; d'un élan, j'avançais quelquefois dix à douze toises, sans perdre l'équilibre; mais, lorsque, après cet exercice, je me retrouvai sur le sable, je m'aperçus au premier pas que mes souliers étaient sans semelles.
Le lendemain 17, au matin, M. Bouguer proposa de prendre du côté de l'ouest, où était la grande brèche du volcan : c'était par là qu'il avait fait sa première tentative, la veille de mon arrivée; mais la neige qui était tombée la nuit précédente rendait les approches plus difficiles que jamais, et s'étendait fort loin au-dessous de notre tente. Enhardi par mes expériences de la veille, je dis à M. Bouguer que je savais un chemin encore plus court; c'était de monter droit par-dessus la neige, à l'enceinte de la bouche du volcan, et j'offris de lui servir de guide. Je me mis en marche un long bâton à la main, avec lequel je sondais la profondeur de la neige : je la trouvai en quelques endroits plus haute que mon bâton, mais assez dure néanmoins pour me porter. J'enfonçai tantôt plus, tantôt moins, presque jamais au-dessus du genou. C'est ainsi que j'ébauchai, dans la partie de la montagne que la neige couvrait, les marches fort inégales d'un escalier d'environ cent toises de haut. En approchant de la cime, j'aperçus entre deux rochers l'ouverture de la grande bouche, dont les bords intérieurs me parurent coupés à pic, et je reconnus que la neige qui les couvrait du côté où je m'étais avancé la veille était minée en-dessous. Je m'approchai avec précaution d'un rocher nu, qui dominait tous ceux de l'enceinte. Je tournai par-dehors, où il se terminait en plan incliné, d'un accès assez difficile : pour peu que j'eusse glissé, je roulais sur la neige, cinq à six cents toises, jusqu'à des rochers où j'aurais été fort mal reçu. M. Bouguer me suivait de près, et m'avertit du danger qu'il partageait avec moi. Nous étions seuls; ceux qui nous avaient d'abord suivis étaient retournés sur leurs pas et sur les nôtres. Enfin nous atteignîmes le haut du rocher, d'où nous vîmes à notre aise la bouche du volcan. C'est une ouverture qui s'arrondit en demi-cercle du côté de l'orient: j'estimai son diamètre de huit à neuf cents toises. Elle est bordée de roches escarpées, dont la partie extérieure est couverte de neige; l'intérieure est noirâtre et calcinée. Ce vaste gouffre est séparé en deux comme par une muraille de même matière qui s'étend de l'est à l'ouest. Je ne jugeai pas la profondeur de la cavité, du côté où nous étions, de plus de cent toises; mais je ne pouvais pas en apercevoir le centre, qui vraisemblablement était plus profond. Tout ce que je voyais ne me parut être que les débris éboulés de la cime de la montagne. Un amas confus de rochers énormes, brisés et entassés irrégulièrement les uns sur les antres, présentait à mes yeux une vive image du chaos des poètes. La neige n'était pas fondue partout: elle subsistait en quelques endroits; mais les matières calcinées qui s'y mêlaient, et peut-être les exhalaisons du volcan, lui donnaient une couleur jaunâtre; du reste, nous ne vîmes aucune fumée. Un pan de l'enceinte entièrement éboulé du côté de l'ouest empêche qu'elle ne soit tout à fait circulaire, et c'est le seul côté par lequel il semble possible de pénétrer' au-dedans. J'avais porté une boussole, à dessein de prendre quelques relèvements, et je m'y préparais malgré un vent glacial qui nous gelait les pieds et les mains, et nous coupait le visage, lorsque M. Bouguer me proposa de nous en retourner. Le conseil fut donné si à propos, que je ne pus résister à la force de la persuasion. Nous reprîmes le chemin de la tente, et nous descendîmes en un quart d'heure ce que nous avions mis plus d'une heure à monter. L'après-midi et les jours suivants, nous mesurâmes une base de cent trente toises, et nous relevâmes divers points avec la boussole, pour faire un plan du volcan et des environs. Il fit le lendemain un brouillard qui dura tout le jour. L'horizon étant fort net le 19 au matin, j'aperçus et je fis remarquer à M. Bouguer un tourbillon de fumée qui s'élevait de la montagne de Cotopaxi, sur laquelle nous avions campé plusieurs fois en 1738. Notre guide et nos gens prétendirent que ce n'était qu'un nuage, et parvinrent même à me le persuader; cependant nous apprimes à Quito que cette montagne, qui avait jeté des flammes plus de deux siècles auparavant, s'était nouvellement enflammée le 15 au soir, et que la fonte d'une partie de ses neiges avait causé de grands ravages. que cette montagne, qui avait jeté des flammes plus de deux siècles auparavant, s'était nouvellement enflammée le 15 au soir, et que la fonte d'une partie de ses neiges avait causé de grands ravages. Nous passâmes encore deux jours à Pichincha et nous y fîmes une dernière tentative avec un nouveau guide, pour tourner la montagne par l'ouest, et pour entrer dans son intérieur; mais le brouillard et un ravin impraticable ne nous permirent pas d'aborder même la petite bouche, qui fume encore, dit-on, et qui répand du moins une odeur de soufre. " Les colères du Cotopaxi.
Les deux académiciens, étant revenus à Quito le 22, n'y entendirent parler que de l'éruption de Cotopaxi, et des suites funestes de l'inondation causée par la fonte subite des neiges, La Condamine fait observer ici que depuis son retour en France le 22, n'y entendirent parler que de l'éruption de Cotopaxi, et des suites funestes de l'inondation causée par la fonte subite des neiges, La Condamine fait observer ici que depuis son retour en France le même volcan s'est embrasé plusieurs autres fois avec des effets encore plus terribles; et quoique Juan et Ulloa aient traité cette matière, il raconte, sur la foi d'un témoin oculaire, divers faits d'une singularité surprenante, qui ne se trouvent pas dans leur relation historique. le même volcan s'est embrasé plusieurs autres fois avec des effets encore plus terribles; et quoique Juan et Ulloa aient traité cette matière, il raconte, sur la foi d'un témoin oculaire, divers faits d'une singularité surprenante, qui ne se trouvent pas dans leur relation historique. " En 1742, dit-il, on avait entendu très distinctement à Quito le bruit du volcan de Cotopaxi, et plusieurs fois en plein jour, sans y faire une extrême attention." le bruit du volcan de Cotopaxi, et plusieurs fois en plein jour, sans y faire une extrême attention." C'est ce qu'il peut confirmer par son témoignage, auquel sa surdité donne un nouveau poids; cependant on n'y entendit point la grande explosion le soir du 30 novembre 1744. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que ce même bruit, qui ne fut pas sensible à Quito , c'est-à-dire à douze lieues au nord du volcan, fut entendu très distinctement à la même heure et du même côté, dans des lieux beaucoup plus éloignés, tels que la ville d'Ibara, Pasto, Popayan, et même à La Plata, à plus de cent lieues mesurées en l'air. On assure aussi qu''il fut entendu vers le sud jusqu'à Guayaquil, et au-delà de Piura, c'est-à-dire à plus de cent vingt lieues de vingt-cinq au degré. A la vérité, le vent, qui soufflait alors du nord-est, y aidait un peu. , c'est-à-dire à douze lieues au nord du volcan, fut entendu très distinctement à la même heure et du même côté, dans des lieux beaucoup plus éloignés, tels que la ville d'Ibara, Pasto, Popayan, et même à La Plata, à plus de cent lieues mesurées en l'air. On assure aussi qu''il fut entendu vers le sud jusqu'à Guayaquil, et au-delà de Piura, c'est-à-dire à plus de cent vingt lieues de vingt-cinq au degré. A la vérité, le vent, qui soufflait alors du nord-est, y aidait un peu. Les eaux, en se précipitant du sommet de la montagne, firent plusieurs bonds dans la plaine avant de s'y répandre uniformément; ce qui sauva la vie à plusieurs personnes, par dessus lesquelles le torrent passa sans les toucher. Le terrain, cavé en quelques endroits par la chute des eaux, s'est exhaussé en d'autres par le limon qu'elles ont déposé en se retirant. On peut juger quels changements la surface de la terre a dû recevoir par des événements de cette nature, dans un pays ou presque toutes les montagnes sont des volcans, ou l'ont été. Il n'est pas rare d'y voir des ravines se former à vue d'oeil, et d'autres qui se sont creusé en peu d'années un lit profond dans un terrain qu'on se souvient d'avoir vu parfaitement uni. Il est possible, il est même vraisemblable que toute la superficie de la province de Quito , jusqu'à une assez grande profondeur, soit formée de nouvelles terres éboulées et de débris de volcans : c'est peut-être par cette raison que dans les plus profondes quebradas on ne trouve aucune coquille fossile. , jusqu'à une assez grande profondeur, soit formée de nouvelles terres éboulées et de débris de volcans : c'est peut-être par cette raison que dans les plus profondes quebradas on ne trouve aucune coquille fossile. En 1738, le sommet de Cotopaxi, par mesure géométrique, était de 500 toises au moins plus haut que le pied de la neige permanente. La flamme du volcan s'élevait autant au-dessus de la cime de la montagne que son sommet excédait la hauteur du pied de la neige. Cette mesure comparative a été confirmée par M. de Maenza, qui, étant alors à quatre lieues de distance, et spectateur tranquille du phénomène, put en juger avec plus de sang-froid que ceux dont la vie était exposée, au danger de l'inondation. Quand on rabattrait un tiers, il resterait encore plus de trois cents toises ou dix-huit cents pieds pour la hauteur de la flamme. Cependant la surface supérieure du cône tronqué, dont la pointe a été emportée par les anciennes explosions, avait, en 1738, sept à huit cents toises de diamètre. Cette vaste bouche du volcan s'est visiblement étendue par les irruptions postérieures de 1743 et 1744, sans parler de nouvelles bouches qui se sont ouvertes en forme de soupiraux dans les flancs de la montagne. Il paraît donc très probable à La Condamine qu'avant que cet immense foyer se soit si fort accru et multiplié, dans le temps; par exemple, de la première mine qui fit sauter un quart de la hauteur de Cotopaxi, la flamme, réunie en un seul jet, dut être dardée avec plus d'impétuosité, et par conséquent put s'élever encore plus haut que dans le dernier embrasement. Quelle doit avoir été la force qui fut alors capable de lancer à plus de trois lieues de gros quartiers de rocher, témoins irréprochables d'un fait qui semble passer les bornes de la vraisemblance, parce que nous connaissons peu la nature! L'académicien vit un de ces éclats de rocher plus gros qu'une chaumière d'Américain, au milieu de la plaine, sur le bord du grand chemin, proche de Malahalo, et le jugea de douze on quinze toises cubes, sans pouvoir douter qu'il ne fût sorti de ce gouffre comme les autres, parce que les traînées de roches de même espèce forment en tout sens des rayons qui partent de ce centre commun. Dans l'incendie de 1744, les cendres furent portées jusqu'à la mer à plus de quatre-vingts lieues. Ce fait n'est plus étonnant, s'il est vrai, comme on l'a publié, que les cendres du mont Etna volent quelquefois jusqu'à Constantinople. Mais un fait plus nouveau, c'est que celles de Cotopaxi, dans la même occasion, couvrirent les terres au point de ne plus laisser, voir la moindre trace de verdure dans les campagnes à douze et quinze lieues de distance du côté de Riobamba, et qui dura un mois et plus en quelques endroits, et fit périr un nombre prodigieux de bestiaux. Quatre lieues à l'ouest de la bouche du volcan, la cendre avait trois ou quatre pouces d'épaisseur. Cette pluie de cendre avait été immédiatement précédée d'une pluie de terre fine d'odeur désagréable, et de couleur blanche; rouge et verte, qui elle-même avait été devancée par une autre de même gravier. Celle-ci fut accompagnée, en divers endroits, d'une nuée immense de gros hannetons blancs, de l'espèce qu'on nomme ravets dans nos îles : la terre en fut couverte en un instant, et ils disparurent tous avant le jour. | |