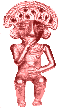 La Harpe
1820. | Il nous reste à rendre compte du travail qui était l'objet particulier du voyage des mathématiciens français et espagnols. Pour commencer leur grande entreprise, il fallait mesurer réellement un terrain qui pût leur servir de base, afin de pouvoir conclure toutes les autres distances par des opérations géométriques : le seul choix de ce terrain leur coûta des peines infinies. Après bien des courses et du travail, exposés sans cesse au vent, à la pluie ou aux ardeurs du soleil , ils se déterminèrent pour un terrain uni, situé dans un vallon beaucoup plus bas que le sol de Quito , ils se déterminèrent pour un terrain uni, situé dans un vallon beaucoup plus bas que le sol de Quito , à quatre lieues au nord-est de cette ville. Ce fut la plaine d'Yaruqui, qui tire son nom d'un village au-dessous duquel elle est située : elle a près de 6300 toises de long. Il eût été difficile d'en trouver une plus longue dans un pays de montagnes, à moins de s'éloigner trop du terrain traversé par la méridienne , à quatre lieues au nord-est de cette ville. Ce fut la plaine d'Yaruqui, qui tire son nom d'un village au-dessous duquel elle est située : elle a près de 6300 toises de long. Il eût été difficile d'en trouver une plus longue dans un pays de montagnes, à moins de s'éloigner trop du terrain traversé par la méridienne . Cette plaine est bornée à l'orient par la haute cordillère de Guamani et de Pambamarca, comme elle l'est à l'ouest par celle de Pichincha. Les rayons du soleil y étant réfléchis par le sol, qui est fort sablonneux, et par les deux cordillères voisines, elle est sujette à de fréquents orages; et comme elle est tout à fait ouverte au Nord et au Sud, il s'y forme de si grands et de si fréquents tourbillons, que cet espace se trouve quelquefois rempli de colonnes de sable élevées par le tournoiement rapide des rafales de vent qui se heurtent. Les passants en sont quelquefois étouffés; et pendant leurs opérations nos illustres voyageurs en eurent un triste exemple dans un de leurs Américains. . Cette plaine est bornée à l'orient par la haute cordillère de Guamani et de Pambamarca, comme elle l'est à l'ouest par celle de Pichincha. Les rayons du soleil y étant réfléchis par le sol, qui est fort sablonneux, et par les deux cordillères voisines, elle est sujette à de fréquents orages; et comme elle est tout à fait ouverte au Nord et au Sud, il s'y forme de si grands et de si fréquents tourbillons, que cet espace se trouve quelquefois rempli de colonnes de sable élevées par le tournoiement rapide des rafales de vent qui se heurtent. Les passants en sont quelquefois étouffés; et pendant leurs opérations nos illustres voyageurs en eurent un triste exemple dans un de leurs Américains. Ils avaient à mesurer un terrain incliné de 125 toises, sur une longueur de 6272, et à niveler du soir au matin pour réduire cette pente à la ligne horizontale : ce travail seul les occupa plus de quinze jours. Ils le commençaient avec le jour; ils ne l'interrompaient qu'à l'approche de la nuit, à moins qu'un orage subit ne les forçât de le suspendre pendant sa durée : ils se faisaient suivre par une petite tente de campagne, qui leur servait de retraite au besoin. Les académiciens, s'étant partagés en deux bandes pour avoir une double mesure de la base, chacun des deux officiers s'était joint à un des deux quadrilles : l'un mesurait la plaine, du Sud au nord, en descendant; l'autre en remontant du sens opposé. Avant de se déterminer pour cette plaine, ils avaient eu dessein de mesurer la base dans le terrain de Cayambé, qui n'est pas moins uni, à douze lieues au nord-est de Quito : ils s'y étaient transportés d'abord pour l'examiner, mais ils l'avaient trouvé trop coupé de ravins. Ce fut là qu'ils eurent le chagrin de perdre Couplet, le 17 septembre, d'une fièvre maligne qui ne le retint au lit que deux jours. Il était parti de Quito avec une légère indisposition. que la vigueur de son tempérament lui avait fait mépriser. Cette mort presque subite d'un homme à la fleur de son âge jeta la compagnie dans une profonde consternation. : ils s'y étaient transportés d'abord pour l'examiner, mais ils l'avaient trouvé trop coupé de ravins. Ce fut là qu'ils eurent le chagrin de perdre Couplet, le 17 septembre, d'une fièvre maligne qui ne le retint au lit que deux jours. Il était parti de Quito avec une légère indisposition. que la vigueur de son tempérament lui avait fait mépriser. Cette mort presque subite d'un homme à la fleur de son âge jeta la compagnie dans une profonde consternation. La mesure de la base, au mois d'octobre, fut suivie de l'observation de plusieurs angles, tant horizontaux que verticaux, sur les montagnes voisines; mais une partie de ce travail devint inutile, parce que dans la suite on donna une meilleure disposition aux premiers triangles.
De retour à Quito , l'observation du solstice , l'observation du solstice avec un instrument de douze pieds, et la vérification de cet instrument, occupèrent nos mathématiciens le reste de l'année 1736, et le commencement de la suivante. Verguin fut chargé, dans cette vue, d'aller reconnaître le terrain au sud de Quito, et d'en lever le plan pendant que Bouguer s'offrit à rendre le même service du côté du nord; précaution nécessaire pour choisir les points les plus avantageux, et former une suite plus régulière de triangles. Dans l'intervalle, La Condamine et George Juan firent le voyage de Lima : ils revinrent à Quito vers le milieu de juin 1737. Bouguer et Verguin avaient rapporté la carte des terrains qu'ils avaient examinés; et, sur la résolution qu'on prit de continuer les triangles du côté du sud, les mathématiciens se partagèrent en deux compagnies. George Juan et Godin passèrent à la montagne, de Pambamarca, et les trois autres montèrent au sommet de celle de Pichincha. De part et d'autre on eut beaucoup à souffrir de la rigoureuse température de ces lieux, de la grêle et de la neige, et surtout de la violence des vents. Dans la zone torride et sous l'équateur, des Européens devaient s'attendre à des excès de chaleur, et le plus souvent ils étaient transis de froid. avec un instrument de douze pieds, et la vérification de cet instrument, occupèrent nos mathématiciens le reste de l'année 1736, et le commencement de la suivante. Verguin fut chargé, dans cette vue, d'aller reconnaître le terrain au sud de Quito, et d'en lever le plan pendant que Bouguer s'offrit à rendre le même service du côté du nord; précaution nécessaire pour choisir les points les plus avantageux, et former une suite plus régulière de triangles. Dans l'intervalle, La Condamine et George Juan firent le voyage de Lima : ils revinrent à Quito vers le milieu de juin 1737. Bouguer et Verguin avaient rapporté la carte des terrains qu'ils avaient examinés; et, sur la résolution qu'on prit de continuer les triangles du côté du sud, les mathématiciens se partagèrent en deux compagnies. George Juan et Godin passèrent à la montagne, de Pambamarca, et les trois autres montèrent au sommet de celle de Pichincha. De part et d'autre on eut beaucoup à souffrir de la rigoureuse température de ces lieux, de la grêle et de la neige, et surtout de la violence des vents. Dans la zone torride et sous l'équateur, des Européens devaient s'attendre à des excès de chaleur, et le plus souvent ils étaient transis de froid. Ils avaient eu la précaution de se munir encore d'une tente de campagne pour chaque compagnie; mais Bouguer, La Condamine et Ulloa n'en purent faire usage sur le Pichincha, parce qu'elle était d'un trop grand volume. II fallut construire une cabane proportionnée au terrain, c'est-à-dire si petite, qu'à peine était-elle capable de les contenir. On n'en sera point surpris en apprenant qu'ils étaient au sommet d'un rocher pointu qui s'élève d'environ 200 toises au-dessus du terrain de la montagne, où il ne croît plus que des bruyères. Ce sommet est partagé en diverses pointes, dont ils avaient choisi la plus haute. Toutes ses faces étaient couvertes de neige et de glace; ainsi leur cabane se trouva bientôt chargée de l'une et de l'autre. "Les mules, dit Ulloa, peuvent à peine monter jusqu'au pied de cet formidable roche; mais de là jusqu'au sommet, les hommes sont forcés d'aller à pied, en montant, on plutôt gravissant pendant quatre heures entières. Une agitation si violente, jointe à la trop grande subtilité de l'air, nous ôtait les forces et la respiration. J'avais déjà franchi plus de la moitié du chemin, lorsque, accablé de fatigue, et perdant la respiration, je tombai sans connaissance. Cet accident m'obligea, lorsque je me trouvai un peu mieux, de descendre, au pied de la roche où nous avions laissé nos instruments et nos domestiques, et de remonter le jour suivant, à quoi je n'aurais pas mieux réussi, sans le secours de quelques Américains qui me soutenaient dans les endroits les plus difficiles." La vie étrange à laquelle nos savants furent réduits, pendant le temps qu'ils employèrent à mesurer la méridienne mérite d'être racontée, successivement dans les termes d'Ulloa et de La Condamine. On peut observer la différence des caractères dans celle des relations, et l'on verra dans celle de La Condamine, un fonds de gaieté qui ne s'altère jamais et qui n'était pas le don le moins précieux qu'il eût reçu de la nature. mérite d'être racontée, successivement dans les termes d'Ulloa et de La Condamine. On peut observer la différence des caractères dans celle des relations, et l'on verra dans celle de La Condamine, un fonds de gaieté qui ne s'altère jamais et qui n'était pas le don le moins précieux qu'il eût reçu de la nature. "Je n'offre, dit Ulloa, qu'un récit abrégé de ce que nous eûmes à souffrir sur le Pichincha; car, toutes les autres montagnes et roches étant presque également sujettes aux injures du froid et des vents, il sera aisé de juger du courage et de la constance dont il fallut nous armer pour soutenir un travail qui nous exposait à des incommodités insupportables, et souvent au danger de périr. Toute la différence consistait dans le plus ou le moins d'éloignement des vivres, et dans le degré d'intempérie, qui devenait plus ou moins sensible suivant la hauteur des lieux et la nature du temps. Nous nous tenions ordinairement dans la cabane, non seulement à cause de la rigueur du froid et de la violence des vents, mais encore parce que nous étions le plus souvent enveloppés d'un nuage si épais, qu'il ne nous permettait pas de voir distinctement à la distance de sept ou huit pas. Quelquefois ces ténèbres cessaient, et le ciel devenait plus clair lorsque les nuages, affaissés par leur propre poids, descendaient au col de la montagne, et l'environnaient souvent de fort près, quelquefois d'assez loin. Alors ils paraissaient comme une vaste mer, au milieu de laquelle notre rocher s'élevait comme une île. Nous entendions le bruit des orages qui crevaient sur la ville de Quito , ou sur les lieux voisins; nous voyions partir la foudre et les éclairs au-dessous de nous; et pendant que des torrents inondaient tout le pays d'alentour, nous jouissions d'une paisible sérénité. Alors le vent ne se faisait presque point sentir; le ciel était clair, et le soleil, dont les rayons n'étaient plus interceptés, tempérait la froideur de l'air. Mais aussi nous éprouvions le contraire lorsque les nuages étaient élevés : leur épaisseur nous rendait la respiration difficile; la neige et la grêle tombaient à flocons; la violence des vents nous faisait appréhender à chaque moment de nous voir enlevés avec notre habitation et jetés dans quelque abîme, ou de nous trouver bientôt ensevelis sous les glaces et les neiges qui s'accumulant sur le toit, pouvaient crouler avec lui sur nos têtes. La force des vents était telle, que la vitesse avec laquelle ils faisaient courir les nuées éblouissait les yeux. le craquement des, rochers qui si détachaient et qui ébranlaient, en tombant, la pointe où nous étions, augmentait encore nos craintes. Il était d'autant plus effrayant, que jamais on n'entendait d'autre bruit dans ce désert; aussi n'y avait-il point de sommeil qui put y résister pendant les nuits. , ou sur les lieux voisins; nous voyions partir la foudre et les éclairs au-dessous de nous; et pendant que des torrents inondaient tout le pays d'alentour, nous jouissions d'une paisible sérénité. Alors le vent ne se faisait presque point sentir; le ciel était clair, et le soleil, dont les rayons n'étaient plus interceptés, tempérait la froideur de l'air. Mais aussi nous éprouvions le contraire lorsque les nuages étaient élevés : leur épaisseur nous rendait la respiration difficile; la neige et la grêle tombaient à flocons; la violence des vents nous faisait appréhender à chaque moment de nous voir enlevés avec notre habitation et jetés dans quelque abîme, ou de nous trouver bientôt ensevelis sous les glaces et les neiges qui s'accumulant sur le toit, pouvaient crouler avec lui sur nos têtes. La force des vents était telle, que la vitesse avec laquelle ils faisaient courir les nuées éblouissait les yeux. le craquement des, rochers qui si détachaient et qui ébranlaient, en tombant, la pointe où nous étions, augmentait encore nos craintes. Il était d'autant plus effrayant, que jamais on n'entendait d'autre bruit dans ce désert; aussi n'y avait-il point de sommeil qui put y résister pendant les nuits. Lorsque le temps était plus tranquille, et que les nuages, s'étant portés sur d'autres montagnes où nous avions des signaux posés, nous en dérobaient la vue, nous sortions de notre cabane pour nous échauffer un peu par l'exercice. Tantôt nous descendions un petit espace et nous le remontions aussitôt; tantôt notre amusement était de faire rouler de gros quartiers de roche du haut en bas, et nous éprouvions avec étonnement que nos forces réunies égalaient à peine celle du vent pour les remuer. Au reste, nous n'osions nous écarter beaucoup de la pointe de notre rocher, dans la crainte de n'y pouvoir revenir assez promptement lorsque les nuages commençaient à s'en emparer, comme il arrivait souvent et toujours fort vite. La porte de notre cabane était fermée de cuirs de boeuf, et nous avions grand soin de boucher les moindres trous pour empêcher le vent d'y pénétrer; quoiqu'elle fût bien couverte de paille, il ne laissait pas de s'y introduire par le toit. Obligés de nous renfermer dans cette chaumière, où la lumière ne pénétrait pas bien, les jours, par leur entière obscurité, se distinguaient à peine des nuits : nous tenions toujours quelques chandelles allumées; tant pour nous reconnaître les uns les autres que pour pouvoir lire ou travailler dans un si petit espace. La chaleur des lumières et celle de nos haleines ne nous dispensaient pas d'avoir chacun notre brasier pour tempérer la rigueur du froid. Cette précaution nous aurait suffi, si, lorsqu'il il avait neigé le plus abondamment, nous n'eussions été obligés de sortir munis de pelles, pour décharger notre toit de la neige qui s'y entassait. Ce n'est pas que nous n'eussions des valets et des Américains qui auraient pu nous rendre ce service; mais, n'étant pas aisé de les faire sortir de leur canonnière, espèce de petite tente, où le froid les retenait blottis pour se chauffer continuellement au feu qu'ils ne manquaient pas d'y entretenir, il fallait partager avec eux une corvée qui les contrariait. On peut juger quel devait être l'état de nos corps dans cette situation. Nos pieds étaient enflés et si sensibles, qu'ils ne pouvaient ni supporter la chaleur du feu, ni presque agir sans une vive douleur. Nos mains étaient chargées d'engelures et nos lèvres si gercées, qu'elles saignaient du seul mouvement que nous leur faisions faire pour parler ou pour manger. Si l'envie de rire nous prenait un peu, nous ne pouvions leur donner l'extension nécessaire à cet effet sans qu'elles se fendissent encore plus, et qu'elles nous causassent un surcroît de douleur, qui durait un jour ou deux. Notre nourriture, la plus ordinaire était un peu de riz, avec lequel nous faisions cuire un morceau de viande ou de la volaille qui nous venait de Quito . Au lieu d'eau nous nous servions de neige, ou d'un morceau de glace que nous jetions dans la marmite; car nous n'avions aucune sorte d'eau qui ne fût gelée. Pour boire, nous faisions fondre de la neige. Pendant que nous étions à manger, il fallait tenir l'assiette sur le charbon, sans quoi les aliments étaient gelés aussitôt. D'abord nous avions bu des liqueurs fortes, dans l'idée qu'elles pourraient un peu nous réchauffer; mais elles devenaient si faibles, qu'en les buvant nous ne leur trouvions pas plus de force qu'à l'eau commune; et, craignant d'ailleurs que leur fréquent usage ne nuisît à notre santé, nous primes le parti d'en boire fort peu: elles furent employées à régaler nos Américains, pour les encourager au travail. Ils étaient cinq : outre leur salaire journalier, qui était quatre fois plus fort que celui qu'ils gagnaient ordinairement, nous leur abandonnions la plupart des vivres qui nous venaient de Quito; mais cette augmentation de paie et de nourriture n'était pas capable de les retenir longtemps près de nous. Lorsqu'ils avaient commencé à sentir la rigueur du climat, ils ne pensaient plus qu'à déserter. . Au lieu d'eau nous nous servions de neige, ou d'un morceau de glace que nous jetions dans la marmite; car nous n'avions aucune sorte d'eau qui ne fût gelée. Pour boire, nous faisions fondre de la neige. Pendant que nous étions à manger, il fallait tenir l'assiette sur le charbon, sans quoi les aliments étaient gelés aussitôt. D'abord nous avions bu des liqueurs fortes, dans l'idée qu'elles pourraient un peu nous réchauffer; mais elles devenaient si faibles, qu'en les buvant nous ne leur trouvions pas plus de force qu'à l'eau commune; et, craignant d'ailleurs que leur fréquent usage ne nuisît à notre santé, nous primes le parti d'en boire fort peu: elles furent employées à régaler nos Américains, pour les encourager au travail. Ils étaient cinq : outre leur salaire journalier, qui était quatre fois plus fort que celui qu'ils gagnaient ordinairement, nous leur abandonnions la plupart des vivres qui nous venaient de Quito; mais cette augmentation de paie et de nourriture n'était pas capable de les retenir longtemps près de nous. Lorsqu'ils avaient commencé à sentir la rigueur du climat, ils ne pensaient plus qu'à déserter.
Il nous arriva dès les premiers jours une aventure de cette espèce, qui aurait eu des suites fâcheuses, si nous n'eussions été avertis de leur évasion. Comme ils ne pouvaient être baraqués dans un lieu d'aussi peu d'étendue que la pointe de notre rocher, et qu'ils n'y avaient d'autre abri pendant le jour qu'une canonnière, ils descendaient le soir, à quelque distance au-dessous, dans une sorte de caverne où le froid était beaucoup moins vif; sans compter qu'ils avaient la liberté d'y faire grand feu. Avant de se retirer, ils fermaient en dehors la porte de notre cabane, qui était si basse, qu'on ne pouvait y passer qu'en se courbant. La neige qui tombait pendant la nuit, ne manquant point de la boucher presque entièrementi ils venaient tous les matins nous délivrer de cette espèce de prison; car nos nègres ordinaires, qui passaient la nuit dans la canonnière, étaient alors si transis de froid, qu'ils se seraient plutôt laissé tuer que d'en sortir. Les cinq Américains venaient donc régulièrement déboucher notre porte à neuf ou dix heures du matin; mais le quatrième ou le cinquième jour de notre arrivée, il était, midi qu'ils n'avaient point encore paru. Notre inquiétude commençait à devenir fort vive, lorsqu'un des cinq, plus fidèle que les autres, vint nous informer de la fuite de ses compagnons, et nous entr'ouvrir assez la porte pour nous donner le pouvoir de la rendre entièrement libre. Nous le dépéchâmes au corrégidor de Quito , qui nous envoya sur le champ d'autres Américains, après leur avoir ordonné, sous de rigoureuses peines, de nous servir plus fidèlement; mais cette menace ne fut pas capable de les retenir; ils désertèrent bientôt comme les premiers. Le corrégidor ne vit pas d'autre moyen, pour arrêter ceux qui leur succédèrent, que d'envoyer avec eux un alcade, et de les faire relever de quatre en quatre jours. , qui nous envoya sur le champ d'autres Américains, après leur avoir ordonné, sous de rigoureuses peines, de nous servir plus fidèlement; mais cette menace ne fut pas capable de les retenir; ils désertèrent bientôt comme les premiers. Le corrégidor ne vit pas d'autre moyen, pour arrêter ceux qui leur succédèrent, que d'envoyer avec eux un alcade, et de les faire relever de quatre en quatre jours. Nous passâmes vingt-trois jours entiers sur notre roche, c'est-à-dire jusqu'au 6 de septembre, sans avoir pu finir les observations des angles, parce qu'au moment où nous commencions à jouir d'un peu de clarté sur la hauteur où nous étions, les autres, sur le sommet desquelles étaient les signaux qui formaient les triangles pour la mesure géométrique de notre méridien; étaient enveloppés de nuages et de neiges. Dans les moments où ces objets paraissaient distinctement, le sommet où nous étions campés se trouvait plongé dans les brouillards. Enfin nous nous vîmes obligés de placer à l'avenir, les signaux dans un lieu plus bas, où la température devait être aussi moins rigoureuse. Nous commençâmes par transporter celui de Pichincha sur une croupe inférieure de la même montagne, et nous terminâmes au commencement de décembre 1737 l'observation qui le regardait particulièrement. Dans toutes les autres stations, notre compagnie logea sous une tente de campagne, qui, malgré sa petitesse, était un peu plus commode que la première cabane, excepté qu'il fallait encore plus de précautions pour en ôter la neige, dont le poids l'aurait bientôt déchirée. Nous la faisions d'abord dresser à l'abri, quand c'était possible; mais ensuite il fut décidé que nos tentes mêmes serviraient de signaux, pour éviter les inconvénients auxquels ceux de bois étaient sujets. Les vents soufflaient avec tant de violence, que souvent la nôtre était abattue. Nous nous applaudîmes, dans le désert d'Assouay, d'en avoir fait apporter de réserve. Trois des nôtres furent successivement renversés : et les chevrons ayant été brisés, comme les piquets, nous n'eûmes pas d'autre ressource que de quitter ce poste et de nous retirer à l'abri d'une ravine. Les deux compagnies, se trouvant alors dans le même désert, eurent également à souffrir; elles furent abandonnées toutes deux par leurs Américains , qui ne purent résister au froid ni au travail, et par conséquent obligées de faire elles-mêmes les corvées jusqu'à l'arrivée d'un autre secours. Notre vie sur les sommets glacés de Pambamarca et de Pichincha fut comme le noviciat de celle que nous menâmes depuis le commencement d'août 1737 jusqu'à la fin de juillet 1739. Pendant ces deux ans, ma compagnie habita sur trente-cinq sommets différents, et l'autre sur trente-deux, sans autre soulagement que celui de l'habitude; car nos corps s'endurcirent enfin, ou se familiarisèrent avec ces climats comme avec la grossièreté des aliments. Nous nous fîmes aussi à cette profonde solitude, aussi bien qu'à la diversité de température que nous éprouvions en passant d'une montagne à l'autre. Autant le froid était vif sur les hauteurs, autant la chaleur nous semblait excessive dans les vallons qu'il fallait traverser; enfin l'habitude nous rendit insensibles au péril où nous nous exposions en grimpant dans des lieux fort escarpés. Cependant il y eut des occasions où nous aurions perdu toute patience et renoncé à l'entreprise, si l'honneur n'avait soutenu notre courage." | |