| . |
| ||||||
| |
| . |
| ||||||
| Valmy est un village de l'arrondissement de Sainte-Ménehould (Marne), à 10 kilomètres de cette ville, Les généraux Dumouriez et Kellermann y battirent les Prussiens et arrêtèrent ainsi le progrès de l'invasion étrangère, le 20 septembre 1792. En 1821, un obélisque a été élevé sur le champ de bataille, en l'honneur de Kellermann, qui avait reçu de Napoléon Ier le titre de duc de Valmy. -  La Bataille de Valmy (20 septembre 1792), par J.-B. Mauzaisse (1835). Ci-dessous : détail.  La bataille de Valmy. Le combat ne fut d'abord de part et d'autre qu'une affaire d'artillerie. Des obus ayant jeté un certain désordre dans les lignes françaises, Kellermann forma son corps d'armée en colonnes, et les lança à la baïonnette sur les lignes prussiennes. Cet engagement eut pour résultat d'arrêter la marche des Prussiens, et l'effet moral fut d'autant plus grand qu'on en augura le triomphe prochain de la République sur l'étranger. Louis-Philippe, alors duc de Chartres, assistait à cette bataille. |
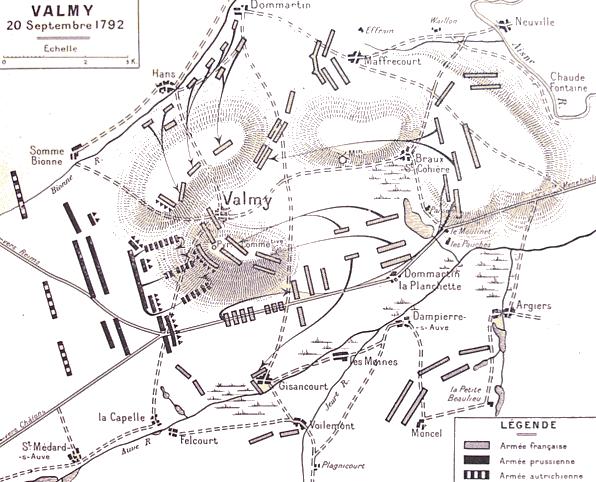
| « Les Prussiens couronnaient les crêtes des hauteurs de la Lune et commençaient à en descendre en ordre de bataille. Les vieux soldats du grand Frédéric, lents et mesurés dans leurs mouvements, ne montraient aucune impétuosité et ne donnaient rien au hasard. Leurs bataillons marchaient d'une seule pièce et se profilaient en lignes géométriques et à angles droits comme des bastions. Ils semblaient hésiter à aborder de près un ennemi qu'ils dépassaient deux fois en nombre et en tactique, mais dont ils redoutaient la témérité ou le désespoir. De leur côté, les Français ne contemplaient pas sans un certain ébranlement d'imagination cette armée immense, jusque-là invincible, avançant silencieusement sa première ligne ca colonnes et déployant ses deux ailes pour foudroyer leur centre et leur couper toute retraite soit sur Châlons, soit sur A ce feu, l'artillerie de Kellermann s'ébranle et s'établit en avant de l'infanterie. Plus de vingt mille boulets, échangés pendant deux heures par cent vingt pièces de canon, labourent le sol des deux collines opposées, comme si les deux artilleries eussent voulu faire brèche aux deux montagnes. L'épaisse fumée de la poudre, la poussière élevée par le choc des boulets qui émiettaient la terre, rampant sur le flanc des deux coteaux et rabattues par le vent dans la gorge, empê chaient les artilleurs de viser juste et trompaient souvent les coups. On se combattait du fond de deux nuages, et l'on tirait au bruit plus qu'à la vue. Les Prussiens, plus découverts que les Français, tombaient en plus grand nombre autour des pièces. Leur feu se ralentissait. Kellermann, qui épiait le moindre symptôme d'ébranlement de l'ennemi, croit reconnaître quelque confusion dans ses mouvements. Il s'élance à cheval à la tête d'une colonne pour s'emparer de ces pièces. Une nouvelle batterie, masquée par un pli du terrain, éclate sur le front de sa colonne. Son cheval, le poitrail ouvert par un éclat d'obus, se renverse sur lui et expire. Le lieutenant-colonel Lormier, son aide de camp, est frappé à mort. La tête de la colonne, foudroyée de trois côtés à la fois, tombe, hésite recule en désordre. Kellermann, dégagé et emporté pair ses soldats, revient chercher un autre cheval. Les Prussiens, qui ont vu la chute d'un général et la retraite de sa troupe, redoublent leur feu. Une pluie d'obus mieux dirigés écrase, le parc d'artillerie des Français. Deux caissons éclatent au milieu des rangs. Les projectiles, les essieux, les membres de chevaux, lancés en tous sens, emportent des files entières de nos soldats; les conducteurs de chariots, en s'écartant au galop du foyer de l'explosion, avec leurs caissons, jettent la confusion et communiquent leur instinct de fuite aux bataillons de la première ligne. L'artillerie, privée ainsi de ses munitions ralentit et éteint son feu. Le duc de Chartres, qui supporte lui-même depuis près de trois heures, l'arme au bras, la grêle de boulets et de mitraille de l'artillerie prussienne, au poste décisif du moulin de Valmy, s'aperçoit du danger de son général. Il court à toute bride à la seconde ligne, entraîne la réserve d'artillerie à cheval, la porte au galop sur le plateau du moulin, couvre le désordre du centre, rallie les caissons, les ramène aux canonniers, nourrit le feu, étonne et suspend l'élan de l'ennemi. Le duc de Brunswick ne veut pas donner aux Français le temps de se raffermir. Il forme trois colonnes d'attaque soutenues par deux ailes de cavalerie. Ces colonnes s'avancent malgré le feu des batteries françaises et vont engloutir sous leur masse le moulin de Valmy, où le duc de Chartres les attend sans s'ébranler. Kellermann, qui vient de rétablir sa ligne, forme son armée en colonnes par bataillons, descend de son cheval, en jette la bride à une ordonnance, fait conduire l'animal derrière les rangs, indiquant par cet acte désespéré qu'il ne se réserve que la victoire ou la mort. L'armée le comprend. « Camarades, s'écrie Kellermann d'une voix palpitante d'enthousiasme et dont il prolonge les syllabes pour qu'elles frappent plus loin l'oreille de ses soldats, voici le moment de la victoire. Laissons avancer l'ennemi sans tirer un seul coup, et chargeons à la baïonnette! » En disant ces mots, il élève et agite son chapeau, orné du panache tricolore sur la pointe de son épée. « Vive la nation! s'écrie-t-il d'une voix plus tonnante encore, allons vaincre pour elle ! » Ce cri du général, porté de bouche en bouche par les bataillons les plus rapprochés, court sur toute la ligne; répété par ceux qui l'avaient proféré les premiers, grossi par ceux qui le répètent pour la première fois, il forme une clameur immense, semblable à la voix de la patrie animant elle-même ses premiers défenseurs. Ce cri de toute une armée, prolongé pendant plus d'un quart d'heure et roulant d'une colline à l'autre, dans les intervalles du bruit du canon, rassure l'armée avec sa propre voix et fait réfléchir le duc de Brunswick. De pareils coeurs promettent des bras terribles. Les soldats français, imitant spontanément le geste sublime de leur général, élèvent leurs chapeaux et leurs casques au bout de leurs baïonnettes et les agitent en l'air comme pour saluer la victoire. « Elle est à nous! » dit Kellermann, et il s'élance au pas de course au-devant des colonnes prussiennes, en faisant redoubler les décharges de son artillerie. A l'aspect de cette armée qui s'ébranle comme d'elle-même en avant, sous la mitraille de quatre-vingts pièces de canon, les colonnes prussiennes hésitent, s'arrêtent, flottent un moment en désordre. Kellermann avance toujours. Le duc de, Chartres, un drapeau tricolore à la main, lance sa cavalerie à la suite de l'artillerie à cheval. Le duc de Brunswick, avec le coup d'oeil d'un vieux soldat et cette économie de sang qui caractérise les généraux consommés, juge à l'instant que son attaque s'amortira contre un pareil enthousiasme. Il réforme avec sang-froid ses têtes de colonnes, fait sonner la retraite et reprend lentement, et sans être poursuivi, ses positions. Les batteries se turent des deux côtés. Le vide se rétablit entre les deux armées. La bataille resta comme tacitement suspendue jusqu'à quatre heures du soir. A cette heure, le roi de Prusse, indigné de l'hésitation et de l'impuissance de son armée, reforma lui-même avec l'élite de son infanterie et de sa cavalerie, trois formidables colonnes d'attaque, et, parcourant à cheval le front de ses lignes, leur reprocha amèrement d'humilier le drapeau de la monarchie. Les colonnes s'ébranlent à la voix de leur souverain. Le roi, entouré du duc de Brunswick et de ses principaux généraux, marche aux premiers rangs et à découvert sous le feu des Français qui décimait autour de lui son état-major. Intrépide comme le sang de Frédéric, il commanda en roi jaloux de l'honneur de sa nation, et s'exposa en soldat qui compte sa vie pour rien devant la victoire. Tout fut inutile. Les colonnes prussiennes, écrasées avant de pouvoir aborder les hauteurs de Valmy par vingt-quatre pièces de canon en batterie au pic du mou lin, se replièrent, à la nuit tombante, ne laissant sur leur route que des sillons de nos boulets, une traînée de sang et huit cents cadavres. Kellermann coucha sur le plateau de Valmy, au milieu des blessés et des morts, mais compant avec raison cette canonnade de dix heures pour une victoire. Il avait fait entendre pour la première fois à l'armée le bruit de la guerre et éprouvé le patriotisme français au feu de cent vingt pièces de canon. Le nombre et la situation des troupes ne permettaient pas davantage. Ne pas être vaincu, pour l'armée française, c'était vaincre. Kellermann le sentit une telle ivresse qu'il voulut confondre plus tard son nom dans le nom de Valmy, et qu'après une longue vie et d'éclatantes victoires il légua, dans son testament, son coeur au village de ce nom, pour que la plus noble part de lui-même reposât sur le théâtre de sa plus chère gloire, à côté des compagnons de son premier combat. » (Lamartine, Histoire des Girondins, XXVII, §14,15). |
| . |
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|