| . |
|
||||||
|
|
| . |
|
||||||
|
|
||
| Charles Le Goffic | ||
|
Danses et musiques populaires |
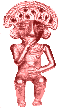
Le Goffic 1911- |
On
avait cru longtemps, sur la foi des dictionnaires, que la danse avait disparu
dans la tourmente des invasions barbares pour renaître seulement
auXVe siècle dans la Florence des Médicis. Grave erreur!
M. Alfred Jeanroy a retrouvé nombre de chansons remontant au XIIIe
siècle et M. Joseph Bédier vient de proposer de ces chansons
une interprétation aussi ingénieuse que nouvelle.
Oui, l'on dansait au moyen âge; mais l'on y dansait aux chansons, comme on fait encore dans le peuple et chez les enfants. Nous n'irons plus au bois; Giroflé, Girofla; Il pleut, il pleut bergère; Compère Guilleri; le Chevalier du guet, etc., etc., autant de chansons populaires qui sont en même temps des airs de rondes enfantines... Il eût été bien extraordinaire aussi qu'une race comme la nôtre se fût privée de « baller » et de « sauter » pendant huit ou neuf cents ans. Nos pères de ces temps reculés avaient surtout une danse qu'ils aimaient et qu'on appelait la carole. Cette carole était une chaîne, ouverte ou fermée, de danseurs et de danseuses, qui se mouvaient au son des voix, plus rarement au son des instruments. La danse consistait, à l'ordinaire, en une alternance de trois pas faits en mesure vers la gauche et de mouvements balancés sur place; un vers ou deux remplissait le temps pendant lequel on faisait les trois pas et un refrain occupait les temps consacrés aux mouvements balancés. Un coryphée conduisait le branle et chantait les airs à danser, que le chœur reprenait au refrain. Cela n'était pas très compliqué, sans doute, mais cela ne manquait point d'une certaine grâce rustique, comme on peut s'en convaincre en visitant les pays où nos anciennes danses populaires se sont conservées. Car nos anciennes danses populaires vivent encore. Je ne suis pas sûr que la morisque, malgré son nom étrange et les grelots qu'on s'y attache aux genoux, remonte directement à la conquête sarrasine et je laisse à de plus savants de décider si le siège de Marseille par Jules César est pour quelque chose dans les Olivettes, ce joli pourchas mystérieux où les danseurs, couronnes de feuillage, se relancent d'arbre en arbre en chantant : Allons!
allons, Annette!
Mais je verrais volontiers dans la farandole provençale une réminiscence de la carole. La farandole aussi est une chaîne que mène un coryphée. Et tantôt la chaîne se noue, tantôt elle s'allonge en spirales, tantôt elle glisse sous l'arc des bras levés pour lui donner passage... Ah! la jolie danse, si vive, si gaillarde, si franchement, si sainement populaire! Mais, pour la conduire, il faut un tambourin. Or il paraît que le tambourin se meurt; et, si je n'ajoute pas : le tambourin est mort, c'est qu'afin de lui rendre quelque vie, nos bons félibres, sur l'initiative d'un des leurs, M. Claude Brun, pétitionnent et s'agitent pour obtenir l'ouverture d'une classe de tambourinaires au Conservatoire de Marseille. Vous me direz qu'il y avait déjà des « écoles » de tambourinaires à Aubagne, à Cannes, à Aix, etc. Pauvres écoles sans doute! Et vous m'objecterez le Valmajour d'Alphonse Daudet, qui n'avait pas eu besoin de professeur et s'était découvert une âme de tambourinaire « en entendant chanter le rossignol ». Peut-être n'y a-t-il plus de rossignols en Provence. De toute manière M. Brun a raison, et il ne faut point attendre, si l'on veut sauver du trépas le peu qui subsiste chez nous de l'antique « ménestrandie » populaire. Ce n'est pas le tambourin seulement qui est menacé, c'est la cabrette auvergnate, la vielle et la musette berrichonnes, la bombarde et le biniou bas-bretons. Que viennent à disparaître ces instruments vénérables, et les airs qu'ils sonnaient, les danses qu'ils accompagnaient, disparaîtront avec eux. Notre patrimoine artistique en serait singulièrement diminué. Et la couleur locale n'en souffrirait pas moins. Vous imaginez-vous la Provence sans ses tambourinaires? « Le tambourinaire, dit Daudet, mais c'est la Provence faite homme! » Tout le corps de l'instrumentiste vibre à la fois : une des mains bat la caisse, l'autre se promène agilement sur les trous d'une petite flûte. Pan-pan, dit le tambourin; tu-tu, réplique le galoubet. Et en avant pour la farandole, la morisque ou les olivettes! Mais il n'est pas de tambourin qu'en Provence, et le Béarn aussi a le sien, moins étroit, sinon moins léger, sorte de bedon à six ou sept cordes accordées en quintes. Comme en Provence, l'instrumentiste n'en joue que d'une main; l'autre tient un flûtet à cinq trous. Et les Béarnais, svelte race, jarrets d'acier, s'entendent à suivre le mouvement : ces « petits hommes noirs et brûlés », comme les appelle Michelet, ne craignent personne au déduit non plus qu'au feu. Un peu plus bas, vers le sud-ouest, chez les Basques, qui ont donné leur nom au petit tambour à grelots en usage dans toute l'Espagne et l'Afrique mauritane, une vieille danse, le monchico ou danse des mouchoirs, rapide, violente, toute en bonds, très chaste pourtant (les danseurs, sans se toucher, se tenant par le mouchoir), n'a pas cessé de garder la vogue. Elle se danse sur les places publiques, les jours de fête, aux sons du bedon et de la chirula, « fluteau de bois percé de trois trous, qui rend, dit M. Louis Labat, des sons vifs et grêles ». Un certain abbé Poussatin, sous Louis XIV, excellait au monchico, et Hamilton, dans ses Mémoires, l'appelle « le premier prêtre du monde pour la danse basque ». Les savants, qui discernent facilement l'ascendance latine de la chirula et du galoubet, nés tous deux de la tibia, sont plus divisés sur les origines du tambourin. Il est certain que cet instrument fut en usage dans nos armées à partir du XIVe siècle. Du moins le tambourin des Suisses ressemble-t-il singulièrement au tambourin provençal, caisse étroite et légère que l'exécutant porte suspendue à son bras, gauche, tandis qu'il la frappe de la droite avec une petite baguette. Il est possible, malgré tout, que
le tambourin, tant béarnais que provençal, ne soit pas d'origine
militaire. On m'affirme que, bien avant que nos armées connussent
cet instrument, donc avant le XIVe siècle, les jongleurs méridionaux
en faisaient usage; tambourin et galoubet auraient accompagné les
« canzones » des troubadours populaires qui couraient les châteaux
et les cités du Midi. Je ne demande qu'à le croire. Il faudrait
donc que les tambourins fussent venus d'Orient à nos Méridionaux
par l'intermédiaire des Sarrasins. Car, pour ceux-ci, il ne fait
point de doute qu'ils se servaient de cet instrument, aux lieu et place
de trompette, pour cadencer la marche de leurs fantassins. On sait, d'autre
part, combien fut profonde l'empreinte sarrasinoise sur les populations
de la vallée du Rhône et de la Garonne.
Détail curieux, relevé par Narcisse Quellien : ces deux instruments, qui sont faits pour jouer et forcés de vivre ensemble, ne sont pas d'accord du tout; ils vont à l'unisson, mais à la distance d'un demi-ton ou quasi, l'un donnant l'ut, l'autre le si. Nos Bretons, par bonheur, ne sont pas à un demi-ton près! Grands amateurs de danses, ils font fête à leurs ménétriers, experts en l'art de mener les jabadao, les passe-pieds et les dérobées. Marches et balancés se retrouvent dans ces danses comme dans la carole et ils se retrouvent également dans la fameuse bourrée auvergnate. « La bourrée est une danse et un chant, dit M. Jean Ajalbert; ce sont des airs de bourrée que joue la cabrette, et souvent le cabretaire chante les paroles en même temps. » Cabrette vient évidemment de chèvre (cabre ou chavre en patois). Le gracieux nom, et si expressif! Vous l'avez peut-être entendue quelquefois, dans l'arrière-boutique d'un marchand de vins des environs de la Roquette ou de la Bastille, cette cabrette auvergnate, dont l'outre de peau est habillée de velours rouge et qui n'a pas sa pareille pour entraîner les danseurs de bourrées. Mme de Sévigné, qui s'y connaissait, trouvait ces bourrées d'Auvergne « la plus surprenante chose du monde »; elle ne tarissait point d'éloges sur la justesse d'oreille et la légèreté de jarret des danseurs. Les Auvergnats d'aujourd'hui — et youp là, la catarina! — sont les dignes héritiers des paysans et des paysannes dont s'enchantait la marquise. Jean Ajalbert nous décrit joliment ces cabretaires de Paris, juchés dans une logette, à laquelle ils accèdent par une échelle mobile qu'on retire dès qu'ils sont installés. Les danseurs sont en place aussitôt que la cabrette se gonfle. Et, dès la première note, ils partent, courent, glissent, martèlent le plancher à grands coups de talon, poussent par intervalle des cris aigus : You! You! en faisant claquer leurs doigts. Chaque bourrée coûte deux sous, que l'associé du cabretaire recueille au milieu de la danse; mais on en a pour son argent, comme on dit, et il est sans exemple qu'un cabretaire ne soit pas allé jusqu'au bout de la dernière mesure... Il y eut une province, longtemps, qui,
sur la foi de George Sand, passa pour le pays par excellence des maîtres-sonneurs
: le Berry. Au soir tombant, les notes suraiguës de la cornemuse montaient,
concert agreste, des traînes et des charrières. Et, les jours
de rapports (foires), dans les vigeons (cabarets) et sur les places publiques,
il faisait beau voir les robustes gars berriots « en habits tout
flambants neufs, rubans au chapeau et à la boutonnière, les
gentes filles réjouies sous leurs fins coffions brodés »,
danser la sauteuse et la montagnarde autour de l'estrade en planches où
trônaient les cornemuseux. Hugues Lapaire a écrit tout un
livre délicieux sur les instruments populaires du Berry, la musette
et la vielle. Ce n'est point sa faute sans doute si son livre ressemble
par endroits à un nécrologe. Mais il n'est que trop vrai
que les Gadat, les Gadet-Trichot, les Balonjat, les Rivalet, les Grisol,
dit Compagnon de Nevers, dont l'enseigne, sur la route de Fourchambault,
portait cette mention étrange : « Compagnon, maître-musitien
(sic) et marchand de sangsues Qu'on
m'apporte du houx
Ainsi chantait Pierre Dupont, à peu près au même temps où « la bonne dame de Nohant » écrivait ses Maîtres-Sonneurs. Ironie des choses! C'est dans le pays même de Joset, de la Fadette et du Champi, que la musette berrichonne compte le moins de dévots. « Il y a encore dans la Vallée-Noire quelques mauvais sonneurs, confiait mélancoliquement à Lapaire Maurice Rollinat. Quant aux maîtres, comme le Joset de George Sand, ils ont complètement disparu. Les abominables crins-crins et clarinettes sont en train de supplanter les si poétiques vielles et cornemuses. L'âme des solitudes n'aura bientôt plus pour pleurer que le chant perdu des crapauds. » Eh quoi! dira-t-on, la vielle aussi? De tous les instruments dont se servaient les ménétriers d'autrefois, flûtes, violes, rebecs, théorbes, micamons, tambourins, c'était la vielle qui gardait leur préférence, comme ayant « plus clere vois et doux sons ». Et l'on sait quel renouveau inattendu, à la fin duXVIIIe siècle, lui ouvrit toutes grandes les portes de Trianon, fit d'elle et du clavecin les délices d'une société qui préludait par des bergeries à la tragédie de 93. De la cour et des salons, la vielle descendit dans la rue avec Fanchon la Vielleuse; nos campagnes lui furent un dernier asile. J'ai connu des joueurs de vielle en Bretagne, entre autres Pierre Rondet, dont le souvenir est toujours vivant à Mégrit; et le père « Zim-Zim » qui se tenait en permanence au coin de la rue Saint-Léonard, à Nantes, et que la malignité publique accusait de « coucher sur une paillasse bourrée de billets de banque ». Il y a peu de temps encore, au bois de Clamart, je rencontrai un vielleux auvergnat, Marion Bournazot, né natif de Saint-Laurent-des-Églises par Ambarzac (Haute-Vienne), qui, seul à l'écart, « tournait la manivelle », les yeux perdus dans son rêve. Si grêle, comme fêlé, l'antique instrument devait receler dans ses flancs un peu de l'âme du pays où il était né. Il était à sa manière un évocateur. Ne dit-on point qu'à Nantes, entre deux noyades, Carrier aimait jouer de la vielle? Si le farouche proconsul s'est quelquefois humanisé, ce n'a pu être qu'à ces heures-là, tandis que s'éveillaient au creux de l'instrument les vieux airs entendus dans son pays d'Aurillac. Cette même vielle, chez les Savoyards, s'appelait fanfoni. C'était au temps, déjà lointain, où, costumés en ramoneurs, les enfants de la rude province battaient l'estrade en compagnie de leur inévitable marmotte. Il n'y a plus de ramoneurs ambulants : il n'y a que des fumistes sédentaires, et Mme Récamier, qui commença de concevoir des doutes sur sa beauté le jour où les petits Savoyards ne se détournèrent plus sur son passage, devrait recourir maintenant à un critérium moins infaillible. Mais combien d'autres provinces qui ne se sont pas montrées plus respectueuses à l'égard de leurs musiques et de leurs danses traditionnelles! Où sont les galants joueurs de fifres qui précédaient, à la grande dukasse de Dunkerque, les mannequins du bonhomme Reuss et de sa femme Gentille? Où la zuarne enrubannée des fluteux morvandiaux? On dit que les fanfares militaires jouent encore, à Douai, l'air de danse de Gayant, arrangé en pas redoublé; mais, à Metz et dans toute la Lorraine, on ne danse plus les antiques trimazos : C'est
maye, la mi-maye,
Vernon ne connaît plus les entrechats de la Tête-de-Veau; Gap le belliqueux bachuber; Cancale et Vitré, la piquante gigoyette; Riez, la bravade sarrasine; Bourg-en-Bresse, le chibreli, le rigodon et le branle-carré, évincés les uns et les autres par l'insipide quadrille et la fastidieuse polka. Évanouies encore, sombrées dans l'oubli, ces danses si pittoresques, tantôt profanes, comme la poitevine, dont Louis XI, à Plessis-les-Tours, régalait sa morose vieillesse, la périgourdine, la tresche, la villanelle; tantôt d'origine religieuse et qui nous reportaient en plein paganisme, comme le pas des Brandons et l'étrange sarabande de Saint-Lyphard, avec son simulacre de sacrifice humain sur les rochers du Crugo. Aussi bien les caroles du XIIe siècle, pour si anciennes soient-elles, ne seraient, d'après certains médiévistes, que « le reflet de plus anciennes danses paysannes ». Et qui sait, au bout du compte, si celles-ci ne viennent pas elles-mêmes des branles sacrés qu'exécutaient, sous la lune, nos aïeux celtes et qu'ils avaient apportés peut-être des plateaux de la Haute-Asie? « La danse est une prière », dit, chez M. Anatole France, le mage Sembobitis. Ce mage parlait d'or; mais il ne parlait que de la danse populaire. C'est la seule qui ait gardé de son origine liturgique je ne sais quoi de grave et de frémissant, comme la musique populaire est la seule capable d'éveiller en nous certains sentiments très simples et très primitifs : l'amour du pays natal, l'attachement à la tradition, etc. En 1870, le préfet du Finistère mobilisa tous les sonneurs de biniou de son département et les envoya au camp de Conlie. Sans le savoir, il reprenait une disposition du commissaire Dalbarade, lequel, à la date du 11 juillet 1794, au plein de la Terreur, écrivait à l'amiral Villaret-Joyeuse : « Il convient de donner aux équipages des « bignoux » et des tambourins pour entretenir la joie parmi eux... » Villaret-Joyeuse s'exécuta-t-il? On le croit. Toujours est-il qu'à partir de ce moment les désertions s'arrêtèrent; la nostalgie dont souffraient nos équipages disparut comme par enchantement... Et voilà de ces miracles tels qu'on n'en connaît point à l'actif des instruments de musique savante, — ces aristocrates! |
| . |
|
|
|
||||||||
|