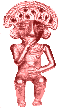|
Dieu
peut être considéré à deux points de vue, celui de la philosophie
et celui de la religion ,
ou plus exactement des religions monothéistes : la foi ,
ou plus exactement des religions monothéistes : la foi religieuse suppose qu'il se révèle lui-même à l'humain, par un effet
de sa bonté; et, sans cette révélation surnaturelle, l'humain ne pourrait
avoir de Dieu
religieuse suppose qu'il se révèle lui-même à l'humain, par un effet
de sa bonté; et, sans cette révélation surnaturelle, l'humain ne pourrait
avoir de Dieu la connaissance requise pour son salut.
Selon les philosophes, au contraire, l'humain, ne s'aidant que de sa propre
raison, fait effort pour dégager l'idée de Dieu,
ou du moins d'en élaborer le concept.
la connaissance requise pour son salut.
Selon les philosophes, au contraire, l'humain, ne s'aidant que de sa propre
raison, fait effort pour dégager l'idée de Dieu,
ou du moins d'en élaborer le concept.
Sous la variété
des formes qu'une même pensée peut emprunter
à la diversité des points de vue et aux habitudes
du langage, le concept philosophique de Dieu,
souvent obscurci par son affinité avec l'idée religieuse, souvent confus,
s'offre lui-même de plusieurs façons : il sera défini soit à
la manière des anciens Grecs comme l'explication ou la cause ultime du
monde (supposée unique), soit de manière encore plus ambitieuse comme
le concept d'un Être réunissant en lui toutes
les perfections que notre raison peut concevoir.
Dieu est l'Être parfait ou infini.
Cette définition comprend et résume tout
(y compris la première définition). Et peut-être trop. Car elle étend
le concept depuis, d'un c√īt√©, l'intelligence, cause
de l'arrangement et de l'ordre universels, qu'Anaxagore,
entre les philosophes, semble avoir le premier dégagée, jusqu'à, de
l'autre c√īt√©, la sagesse infinie, jusqu'√† la bont√© souveraine, la toute-puissance
créatrice et la béatitude parfaite, réunies
à la plénitude de l'être... Que peut faire le philosophe de tout cela?
Quelle définition choisira-t-il? et, d'ailleurs, peut-il raisonnablement
s'emparer d'un concept aussi dépourvu de poignée qui permettrait de le
saisir avec s√Ľret√©? Peut-il savoir, de science
certaine, que Dieu
existe et quel il est? Ou
ne doit-il pas, au mieux, se contenter d'une simple croyance,
mais naturelle encore, et dont la seule source
serait en lui-même? Nous n'avons pas de réponse, mais d'autres en ont
eu pour nous. Les voici.
L'argumentaire
traditionnel et sa critique.
La rencontre de
la foi religieuse des Chrétiens médiévaux et des notions de la philosophie
qu'ils ont progressivement hérité des anciens Grecs, les ont conduit,
sous l'impulsion initiale de saint Anselme,
à élaborer un argumentaire destiné à asseoir la foi sur des raisons
philosophique. C'est que, diront-ils, Dieu étant présent à toutes choses,
nous trouvons en nous et hors de nous l'occasion d'en concevoir l'idée.
Le spectacle de la nature nous la suggère, aussi bien que l'observation
intérieure. Toutefois, ce n'est pas de la simple expérience qu'elle peut
na√ģtre : les deux formes de d√©monstration que l'on tire de la connaissance
de soi-même et de l'étude de la nature supposent, comme élément fondamental,
une conception de la raison. Un point de départ qui est aussi l'occasion
d'une instrumentalisation de la philosophie. Rel√©gu√©e au r√īle de servante
de la th√©ologie, il lui sera assign√© (entre autres t√Ęches) de d√©gager
des conceptions de la raison, supposées communes à tous les humains,
mais aussi considérées comme confuses chez la plupart d'entre eux, afin
que l'analyse les développe, les précise et les éclaircisse. En somme,
il s'agira pour la philosophie de produire ce que l'appellera des preuves
de l'existence de Dieu.
De ces preuves, il
y en a eu de toutes sortes, que l'on a cherché à classer de diverses
manières. par exemple, on distingue souvent (et assez arbitrairement)
les preuves ou arguments a priori, comme celui qui veut que Dieu
est la cause de son idée ou qu'il est la cause de soi (preuve dite ontologique),
et les preuves ou arguments a posteriori, qui reposent sur le constat
de l'existence du monde, et parmi lesquels on range l'argument téléologique
(Dieu est la cause de l'organisation finaliste du monde) et l'argument
cosmologique (Dieu est la cause de moi et du monde). D'autres preuves
reposent sur la tradition (tous les peuples ont eu l'idée de la divinité...),
etc. On se contentera ici de mentionner celles qui ont le plus d'intérêt
philosophique :
Preuve
morale - Au dire de Socrate, initiateur de
cet argument, les humains ne purent se résigner à mourir entièrement.
Ils pensèrent que leurs ancêtres survivaient, et qu'une récompense dans
un autre monde était réservée à ceux qui l'avaient méritée. Quelques-uns
au moins, les meilleurs, devenaient ainsi, aux yeux de leurs descendants,
des bienheureux. Une idée de réparation et de justice se joignit au culte
des morts, et la conscience humaine se représenta les dieux comme les
dépositaires et les gardiens de lois non écrites, disait le philosophe,
supérieures aux législations plus ou moins imparfaites des cités.
Preuve physique
(ou téléologique) - En même temps un autre ordre, non plus moral,
mais physique, frappait les esprits. Le monde, en grec, s'appelait d'un
nom qui signifie ordre, kosmos; comment n'y pas voir l'oeuvre d'une
intelligence, no√Ľs? Anaxagore, √† qui
on peut faire remonter ce raisonnement, le dit expressément, et tous les
philosophes ensuite, à l'exception des épicuriens,
insistèrent à l'envi sur les marques d'un dessein intelligent qui se
manifeste dans les choses. La nature doit avoir ses fins comme l'humanité
a les siennes, et cette double idée d'une finalité
en nous comme hors de nous conduisit la pensée à la notion d'un Dieu,
toute sagesse et toute justice, qui en serait l'auteur.
Preuve cosmologique
- Par un effort d'abstraction, que l'on doit surtout Platon
et Aristote, on considéra ensuite tout le réel
dans sa g√©n√©ralit√© pure et simple; il appara√ģt comme chose mobile et
changeante, chose périssable, qui n'a pas en soi la raison de son existence,
ni dans un autre réel qui lui ressemble; il ne s'explique que par un principe
suprême, objet de la métaphysique, dira-t-on après Aristote. On l'appela
premier moteur, ou
cause première, ou l'être nécessaire que réclame tout être contingent,
ou l'absolu que suppose toujours le relatif.
Preuve ontologique
- La réalité concrète était toujours le point de départ et le point
d'appui. Mais un effort de plus, et l'on crut pouvoir se passer d'elle
l'idée toute seule d'un être infini ou parfait n'enveloppe-t-elle pas
l'existence de cet être? Il possède, en effet, toutes les perfections,
et l'existence en est certainement une; donc l'être parfait ne peut pas
ne pas exister. Autrement dit, il y a contradiction à poser l'être parfait
comme non existant, parce que l'attribut d'existence est contenu dans le
sujet perfection, comme l'attribut angle dans le sujet triangle. Cette
argumentation, que reprirent Descartes et Leibniz,
est de saint Anselme.
|
Preuve ontologique
de l'existence de Dieu par son idée, selon Descartes
¬ę Si de cela seul
que je puis tirer de ma pensée l'idée de quelque chose, il s'ensuit que
tout ce que je reconnais clairement et distinctement appartenir à cette
chose lui appartient en effet, ne puis je pas tirer de ceci un argument
et une preuve démonstrative de l'existence de Dieu? II est certain que
je ne trouve pas moins en moi son idée, c'est-à-dire l'idée d'un être
souverainement parfait, que celle de quelque figure ou de quelque nombre
que ce soit : et je ne cannais pas moins clairement et distinctement qu'une
actuelle et éternelle existence appartient à sa nature, que je connais
que tout ce que je puis démontre, de quelque figure ou de quelque nombre
appartient véritablement à la nature de cette figure ou de ce nombre;
et partant, encore que tout ce que j'ai conclu dans les méditations précédentes
ne se trouv√Ęt point v√©ritable, l'existence de Dieu devrait passer en
mon esprit au moins pour aussi certaine que j'ai estimé jusques ici toutes
les vérités mathématiques, qui ne regardent que les nombres et les figures
: bien qu'à la vérité cela ne paraisse pas d'abord enticèrement manifeste,
mais semble avoir quelque apparence de sophisme. Car ayant accoutumé dans
toutes les autres choses de faire distinction entre l'existence et l'essence,
je me persuade aisément que l'existence peut être séparée de l'essence
de Dieu, et qu'ainsi on peut concevoir Dieu comme n'étant pas actuellement.
Mais néanmoins, lorsque j'y pense avec plus d'attention, je trouve manifestement
que l'existence ne peut non plus être séparée de l'essence de Dieu,
que de l'essence d'un triangle rectiligne la grandeur de ses trois angles
égaux à deux droits, ou bien de l'idée d'une montagne l'idée d'une
vallée; en sorte qu'il n'y a pas moins de répugnance de concevoir un
Dieu, c'est-à-dire un être souverainement parfait, auquel manque l'existence,
c'est-à-dire auquel manque quelque perfection, que de concevoir une montagne
qui n'ait pas de vall√©e. ¬Ľ
(Descartes,
extrait des Méditations, III ).
-
Critique de l'argument
ontologique
par Kant
¬ę Si, dans un jugement
identique, je fais dispara√ģtre l'attribut et que je retienne le sujet,
il en résulte une contradiction; je dis alors que l'attribut convient
n√©cessairement au sujet. Mais si je fais dispara√ģtre le sujet en m√™me
temps que l'attribut, alors il n'y a pas de contradiction. Car il n'y a
plus rien avec quoi il puisse y avoir contradiction. Il est sans doute
contradictoire de supposer un triangle si l'on en supprime par la pensée
les trois angles; mais il n'y a pas de contradiction √† faire dispara√ģtre
le triangle en même temps que les trois angles.
Il en est exactement
de même du concept d'un être absolument nécessaire. Si vous en supprimez
aussi la chose m√™me avec tous ses attributs, o√Ļ serait alors la contradiction?
Il n'y a plus rien, extérieurement, avec quoi la contradiction soit possible,
car la chose doit ne pas être nécessaire extérieurement; rien non plus
intérieurement, car la chose elle-même étant supprimée, toute intériorité
est en même temps supprimée. Dieu est tout-puissant; c'est là un jugement
nécessaire. La toute-puissance ne peut être enlevée si vous posez d'abord
une divinité, c'est-à-dire un être infini au concept duquel elle est
identique. Mais si vous dites : Dieu n'est pas, alors il n'y a ni toute-puissance,
ni aucun autre attribut, car ils sont tous ensemble enlevés au sujet,
et il n'y a pas ombre de contradiction dans cette pensée.
Vous prétendez,
par un cas particulier que vous m'objectez comme une preuve de ce fait,
qu'il y a cependant un concept, mais un seul, √† la v√©rit√©, o√Ļ le non
√™tre, o√Ļ la suppression de l'objet de ce concept est contradictoire en
soi : tel est le cas du concept de l'être parfait. Cet être, dites-vous,
peut être toute réalité [c'est-à-dire
toute perfection], et vous avez le droit d'admettre
un tel être comme possible, ce que j'accorde à présent, quoiqu'il s'en
faille beaucoup qu'un concept non contradictoire en soi prouve la possibilité
de l'objet. Or, dans la toute-réalité est aussi comprise l'existence.
L'existence est donc renfermée dans le concept de quelque chose qui est
possible. Si donc cette chose est supprimée, la possibilité interne de
la chose l'est aussi, ce qui est contradictoire.
Je réponds : vous
êtes déjà tombé dans une contradiction lorsque, dans le concept d'une
chose que vous voulez simplement concevoir quant à sa possibilité, sous
quelque nom qu'elle se déguise, vous faites entrer le concept de son existence.
Si on vous l'accorde, vous avez alors en apparence vaincu, mais en réalité
vous n'avez rien dit, car vous n'avez fait qu'une simple tautologie. Je
vous le demande, la proposition : cette chose-ci ou celle-là (que je vous
accorde comme possible, que ce soit ce qu'on voudra) existe, est-elle une
proposition analytique ou synthétique? si elle est analytique, vous n'ajoutez
rien, par l'existence de la chose, à votre pensée de la chose; mais dans
ce cas, ou la pensée qui est en nous devrait être la chose elle-même,
ou vous avez supposé une existence comme faisant partie de la possibilité,
et alors l'existence est conclue de l'hypothèse de la possibilité interne;
ce qui n'est qu'une tautologie pitoyable. Avouez-vous, au contraire, comme
doit le faire volontiers tout homme raisonnable, que toute proposition
existentielle est synthétique mais alors comment prétendez-vous affirmer
que le prédicat de l'existence ne peut être enlevé sans contradiction,
puisque ce privilege n'appartient proprement qu'aux propositions analytiques,
dont le caractère particulier consiste précisément en cela même?
Le concept d'un être
suprême est une idée très utile à beaucoup d'égards; mais précisément
parce qu'il n'est qu'une idée, il est tout à fait incapable d'étendre
à lui seul notre connaissance par rapport à ce qui existe. Il ne peut
même pas nous instruire davantage relativement à la possibilité.
[...]
Le caractère de
la possibilité devant toujours être cherché dans l'expérience, à laquelle
l'objet d'une pure idée ne peut appartenir, il s'en faut de beaucoup que
l'illustre Leibniz ait fait ce dont il su flattait, c'est-à-dire qu'il
soit parvenu √† conna√ģtre a priori la possibilit√© d'un √™tre id√©al aussi
élevé.
Cette preuve ontologique
si vantée qui prétend démontrer par des concepts l'existence d'un Être
suprême, perd donc toute sa peine, et l'on ne deviendra pas plus riche
en connaissances avec de simples idées, qu'un marchand ne le deviendrait
en argent, si, dans la pensée d'augmenter sa fortune, il ajoutait quelques
z√©ros √† son livre de caisse. ¬Ľ
(Kant,
extrait de la Critique de la raison pure, II).
|
La faiblesse de ces
preuves, qui n'en sont donc pas à proprement parler, a été mise en lumière
par Kant. Si l'on excepte la preuve morale, qui
échappa à la critique du philosophe, le défaut commun des autres est
l'emploi illégitime qu'elles font des principes
de notre connaissance. Le principe d'identité
d'abord est simplement analytique : il ne peut servir qu'à tirer d'un
objet
ce qui s'y trouve contenu déjà, mais non pas à y rien ajouter de nouveau.
Comment donc réussira-t-on, dans la preuve ontologique, à tirer d'une
idée
une existence? Une question, avrai dire qui
n'est pas nouvelle, puisqu'elle avait déjà été posée par le moine
Gaunilon,
contemporain d'Anselme, à propos du même sujet. Mais qui trouve désormais
une réponse plus décisive.
Ou bien l'existence
de Dieu se déduit, explique Kant, de la seule idée de Dieu ; mais c'est
qu'on l'a introduite déjà et supposée dans cette idée; en ce cas, la
déduction vaut tout juste autant qu'une telle supposition qui reste à
justifier. Ou bien l'on s'en tient à l'idée seule de l'être parfait,
et, en la décomposant, on y trouve l'idée de toutes les perfections,
entre autres l'idée de l'existence, mais non pas l'existence même indépendamment
de l'idée qu'on en a.
De même, dans la
preuve cosmologique, on se sert ind√Ľment du principe de causalit√©.
Celui-ci exige que tout phénomène soit déterminé
par un autre ph√©nom√®ne. Or s'il nous permet ou plut√īt nous ordonne de
remonter d'anneau en anneau la cha√ģne des ph√©nom√®nes, il ne nous autorise
pas √† abandonner tout √† coup cette cha√ģne pour nous jeter en plein supra-sensible.
Le même lien qui rattache chaque fait à un autre fait peut-il servir
√† rattacher la s√©rie totale (qu'il ne peut m√™me nous faire conna√ģtre
entièrement) à un être qui n'est plus du tout un fait, mais qui plane
infiniment au-dessus? On se contente d'abord de la causalité scientifique,
puis subitement on lui donne une extension métaphysique,
et l'on pense aboutir par elle à un être qui, de toute façon, la contredit,
qu'il soit comme on l'affirme sans cause, ou bien
qu'il soit à lui-même sa propre cause.
Quant à la preuve
de Dieu par la finalité dans le monde physique, les reproches que lui
adressa Kant, elle les avait, ce semble, acceptés d'avance. L'intelligence
ordonnatrice, qu'elle nous am√®ne √† reconna√ģtre, n'a pas n√©cessairement
créé le monde, dit-il; et les philosophes anciens admettaient, en effet,
comme principe du monde une matière
éternelle au-dessous de l'intelligence qui devait l'ordonner. De plus,
le d√©sordre n'a-t-il pas sa place dans le monde √† c√īt√© de l'ordre,
le mal √† c√īt√© du bien? Le Dieu, qui en est l'auteur, n'est donc point
parfait? En effet, il n'est qu'un des deux principes, et l√† o√Ļ les principes
sont deux, ni l'un ni l'autre ne possède toute perfection. Enfin Kant
va jusqu'à dire qu'un accord entre plusieurs dieux expliquerait l'ordre en ce monde aussi bien qu'une divinité unique; et
l'on songe au polythéisme plus ou moins atténué qui s'exprima longtemps
au cours de l'Antiquité. Mais ce qui infirme encore davantage la preuve
de Dieu par la finalité, c'est que la finalité n'est pas un principe
scientifique. La science renonce à lui demander une certitude
égale à celle que lui fournit le principe de causalité, ou celui d'identité.
Elle étudie le monde, abstraction faite des causes
finales, et les philosophes eux-mêmes dans les temps modernes, pour
sauver la finalité, l'ont reportée à l'originedu
monde, dans un acte unique et surnaturel de Dieu qui le crée, puis laisse
les choses suivre leur cours mécaniquement et s'interdit d'en retoucher
les lois. Donc par la finalité, encore bien moins
que par les principes de causalité et d'identité, on ne peut savoir,
de science certaine c.-à-d. démontrer ou prouver, à la façon des mathématiciens
ou des physiciens, que Dieu existe.
expliquerait l'ordre en ce monde aussi bien qu'une divinité unique; et
l'on songe au polythéisme plus ou moins atténué qui s'exprima longtemps
au cours de l'Antiquité. Mais ce qui infirme encore davantage la preuve
de Dieu par la finalité, c'est que la finalité n'est pas un principe
scientifique. La science renonce à lui demander une certitude
égale à celle que lui fournit le principe de causalité, ou celui d'identité.
Elle étudie le monde, abstraction faite des causes
finales, et les philosophes eux-mêmes dans les temps modernes, pour
sauver la finalité, l'ont reportée à l'originedu
monde, dans un acte unique et surnaturel de Dieu qui le crée, puis laisse
les choses suivre leur cours mécaniquement et s'interdit d'en retoucher
les lois. Donc par la finalité, encore bien moins
que par les principes de causalité et d'identité, on ne peut savoir,
de science certaine c.-à-d. démontrer ou prouver, à la façon des mathématiciens
ou des physiciens, que Dieu existe.
De
l'idée de Dieu au sentiment divin.
Ces critiques établissent
seulement que la science a des principes qui ne valent que pour elle et
dans son domaine propre, et qu'on ne peut pas s'en servir au delà. Mais
le mauvais usage de ces principes n'entame en rien l'objet auquel on les
appliquait : celui-ci subsiste dans son intégrité, qu'on l'appelle idée
de Dieu ou sentiment du divin, et il mérite à son tour d'être examiné
en lui-même. A défaut de l'existence de Dieu hors de nous, sommes-nous
assurés au moins de son idée en nous-mêmes? Avons-nous de Dieu une idée
bien définie? Nous transportons en lui et nous lui attribuons ce qui dans
l'humain para√ģt avoir un caract√®re de perfection; nous √©cartons tout
le reste. Dieu devient comme une image agrandie et embellie de l'humanité,
une image idéalisée; mais pas un trait de cette image qui ne soit pris
à la nature humaine, et les philosophes ont vainement fait effort pour
échapper à un anthropomorphisme inévitable.
Les épicuriens,
dans l'Antiquité, pensaient que la forme humaine, étant la plus parfaite,
devait appartenir aux dieux qui possèdent toute perfection, et leur philosophie
s'accordait en cela avec le culte et avec l'art de tout le paganisme. Les
sto√Įciens
eux-mêmes, sans dire que leur Dieu avait un corps, ou du moins un corps
humain, le faisaient cependant matériel, quoique d'une matière le plus
possible épurée et spiritualisée, et tout imprégnée d'esprit.
Les péripatéticiens croyaient s'élever
réellement au-dessus de l'humain, en définissant Dieu par l'intelligence,
comme si l'intelligence n'était pas chose humaine encore, et qui supposait
d'ailleurs dualité, opposition d'un sujet et d'un objet. Enfin, par un
effort suprême, les
néo-platoniciens
en vinrent à concevoir Dieu comme supérieur et à l'intelligence et à
l'intelligible,
et comme un s√Ľr garant de la conformit√© de l'un et de l'autre, gr√Ęce
à la fusion et à l'union des deux au sein de son unité-absolue.
L'humain cette fois semblait dépassé, et on se flattait d'avoir atteint
Dieu.
-
La philosophie
moderne oscille beaucoup plus que l'ancienne
entre le même besoin de déterminer Dieu, et un sentiment autrement profond
de l'infinité de sa nature, laquelle se refuse
à toute limitation ou détermination. Au XVIIIe
siècle, par exemple, des philosophes comme Malebranche
se plaignaient qu'on enferm√Ęt toute la r√©alit√©
possible dans les deux grandes divisions de la matière et de l'esprit,
de l'étendue et de la pensée,
et ne se résignaient, faute de mieux, à appeler Dieu un esprit qu'avec
cette réserve expresse que lest un esprit infiniment plus au-dessus de
notre esprit humain que celui-ci loimême n'est au-dessus de la matière.
Autant dire qu'il nous est inaccessible.
Spinoza
plus encore eut à la fois le respect de la pure essence
de Dieu et la crainte de la ternir par quoi que ce soit d'humain; il ne
voulut voir en Dieu qu'un être infini par la somme de ses attributs,
infini par chacun d'eux. Autant dire, que chacun d'eux est incompréhensible
à notre esprit, par cette infinité même, et à plus forte raison leur
somme infinie, Descartes ne l'avait-il pas
reconnu, lorsqu'il déclarait que par notre entendement
nous ne pouvons comprendre Dieu, ce qui équivaudrait à le limiter, pas
plus qu'avec nos bras nous ne pouvons embrasser le tronc d'un gros arbre ou bien une montagne
ou bien une montagne ;
mais nous pouvons au moins toucher celle-ci du doigt, et il croyait de
même notre esprit capable de toucher Dieu. C'est ainsi qu'on s'embarrasse
dans d'inextritables difficultés. Car ou bien, à force de dépouiller
Dieu de tout attribut qui rappellerait l'humain, on se trouve finalement
en face d'un être irreprésentoble pour l'esprit humain, ou bien en qu'on
lui laisse est toujours emprunté à notre nature humaine, et, de peur
de lui communiquer quelque chose de nous, peut-être lui avons-nous refusé
ce que nous avons de meilleur, pour lui attribuer le moindre et le pire?
N'est-ce pas ce qui arrive, lorsqu'on imagine l'infini se développant
selon des lois-mathématiques,
c.-à-d. aveugles et brutales, comme si la géométrie,
après tout, n'était pas seulement un des produits de notre activité
humaine, et qui laisse place au-dessus d'elle à des choses d'un autre
ordre? Ainsi donc, au moment o√Ļ l'on pense avoir √©vit√© l'anthropomorphisme,
il repara√ģt, et sous une forme qui ne semble pas √™tre la plus haute ni
la meilleure. ;
mais nous pouvons au moins toucher celle-ci du doigt, et il croyait de
même notre esprit capable de toucher Dieu. C'est ainsi qu'on s'embarrasse
dans d'inextritables difficultés. Car ou bien, à force de dépouiller
Dieu de tout attribut qui rappellerait l'humain, on se trouve finalement
en face d'un être irreprésentoble pour l'esprit humain, ou bien en qu'on
lui laisse est toujours emprunté à notre nature humaine, et, de peur
de lui communiquer quelque chose de nous, peut-être lui avons-nous refusé
ce que nous avons de meilleur, pour lui attribuer le moindre et le pire?
N'est-ce pas ce qui arrive, lorsqu'on imagine l'infini se développant
selon des lois-mathématiques,
c.-à-d. aveugles et brutales, comme si la géométrie,
après tout, n'était pas seulement un des produits de notre activité
humaine, et qui laisse place au-dessus d'elle à des choses d'un autre
ordre? Ainsi donc, au moment o√Ļ l'on pense avoir √©vit√© l'anthropomorphisme,
il repara√ģt, et sous une forme qui ne semble pas √™tre la plus haute ni
la meilleure.
Toute conception
de la divinité vient donc de l'humain, et se trouve, par cela seul, entachée
d'un vice d'origine. Et que dire, en outre, des difficult√©s, tant√īt logiques
et tant√īt morales, de concilier en elle des attributs
comme la justice et la miséricorde, la puissance et la bonté, l'entendement
et la liberté, peut-être même la perfection
et l'existence? Dieu et l'humain semblent deux
êtres incommensurables, et toute mesure, empruntée à l'humain détruit
ou tout au moins altère la nature de Dieu en
l'humanisant. L'infini et Ie fini n'ont de ressemblance
que dans les termes; tout ce qui ressemble au fini est fini lui-même,
et l'infini se trouve véritablement avec lui hors de toute comparaison.
Leibniz,
qui faisait l'humain si semblable à Dieu et réciproquement, ajoutait
néanmoins que Dieu est comme un océan, dont nous n'avons que quelques
gouttes. L'humain, a-t-on dit depuis, n'a ni barque, ni boussole, pour
en parcourir l'étendue et en sonder la profondeur. Tout au plus peut il
le contempler du rivage o√Ļ ses pieds demeurent invinciblement attach√©s,
et encore se demande-t-il parfois avec angoisse si ce qu'il a sous les
yeux ne serait pas un sublime et vain mirage?
Oui, à moins d'emprunter
d'autres voies répondront certains philosophes d'autant moins disposés
à renoncer à l'idée de Dieu, qu'ils estimeront l'humain incapable d'en
détourner la vue, et le monde seul ne lui suffit pas. Si le problème
de l'existence de Dieu est insoluble, faute
d'un principe-rationnel
pour le résoudre, si l'idée même de Dieu que l'esprit humain se forge
soutient difficilement l'épreuve de la critique, et si, comme un ouvrier
consciencieux, il rougit de son oeuvre; toujours indigne en effet de ce
qu'il voudrait exprimer, il ne peut cependant y renoncer : pour lui le
problème se pose toujours. Nos instruments de connaissance
perdent toute leur valeur au-delà de ce monde; mais cet au-delà existe,
quoique inconnu pour nous et même inconnaissable; Et si le raisonnement
se refuse à en rien dire, nous n'en sommes que plus libres de nous fier
à ce qui n'est sans doute qu'une forme spéciale de la raison,
le sentiment.
-
|
Principales
opinions philosophiques sur Dieu
L'Athéisme
tient peu de place dans l'histoire de la philosophie.
Au contraire, tandis que les croyances et les
religions populaires de l'Antiquité s'arrêtaient, sous la forme du polythéisme,
à la divinisation des causes secondes de la nature
la philosophie, dès son berceau, s'efforça de s'élever à la conception
d'un être et d'une cause première. Du sein même
de l'école ionienne ,
encore tout engagée dans la recherche du principe
matériel de toutes choses, on vit sortir cette belle sentence d'Anaxagore
qui fait dire à Aristote que quand un humain
proclama qu'il y a dans la nature une intelligence,
cause de l'arrangement et de l'ordre universel,
cet humain parut seul jouir de sa raison au prix
des divagations de ses devanciers. Cependant il ne faut pas, avant Socrate
chercher dans la philosophie grecque un système
de théodicée régulière, à moins qu'on ne
veuille donner ce nom au panthéisme-éléatique
ou aux abstractions-pythagoriciennes
sur l'Unité primitive. A partir de Socrate, les
choses changent de face : non seulement il donne sa démonstration
de l'existence de Dieu, mais aussi de sa Providence.
Avec Platon et Aristote, la théodicée prétend
s'ériger en une science véritable. II y a même
dans Platon deux syst√®mes diff√©rents sur Dieu : tant√īt Platon consid√®re
Dieu comme l'idée, comme l'essence
suprême, qu'il appelle indifféremment l'un, l'être ou le bien; c'est
par ce c√īt√© de sa doctrine qu'il se rattache √† l'√©cole
d'√Čl√©e ,
encore tout engagée dans la recherche du principe
matériel de toutes choses, on vit sortir cette belle sentence d'Anaxagore
qui fait dire à Aristote que quand un humain
proclama qu'il y a dans la nature une intelligence,
cause de l'arrangement et de l'ordre universel,
cet humain parut seul jouir de sa raison au prix
des divagations de ses devanciers. Cependant il ne faut pas, avant Socrate
chercher dans la philosophie grecque un système
de théodicée régulière, à moins qu'on ne
veuille donner ce nom au panthéisme-éléatique
ou aux abstractions-pythagoriciennes
sur l'Unité primitive. A partir de Socrate, les
choses changent de face : non seulement il donne sa démonstration
de l'existence de Dieu, mais aussi de sa Providence.
Avec Platon et Aristote, la théodicée prétend
s'ériger en une science véritable. II y a même
dans Platon deux syst√®mes diff√©rents sur Dieu : tant√īt Platon consid√®re
Dieu comme l'idée, comme l'essence
suprême, qu'il appelle indifféremment l'un, l'être ou le bien; c'est
par ce c√īt√© de sa doctrine qu'il se rattache √† l'√©cole
d'√Čl√©e et qu'il pr√©pare le panth√©isme alexandrin
: tant√īt, par une heureuse incons√©quence, il voit en Dieu la cause du
mouvement,
l'ordonnateur de la matière (la philosophie grecque n'a jamais envisagé
l'idée d'un Dieu créateur), qu'il façonne sur le plan des Idées.
et qu'il prépare le panthéisme alexandrin
: tant√īt, par une heureuse incons√©quence, il voit en Dieu la cause du
mouvement,
l'ordonnateur de la matière (la philosophie grecque n'a jamais envisagé
l'idée d'un Dieu créateur), qu'il façonne sur le plan des Idées.
Suivant
Aristote,
Dieu est le premier moteur immobile, le souverain bien et la cause
finale vers laquelle aspirent et tendent tous les êtres, l'objet suprême
de l'intelligence (premier intelligible) et en même temps la suprême
intelligence. Comme d'ailleurs, dans ce syst√®me, la mati√®re, sans dispara√ģtre
entièrement en tant que principe indépendant et coéternel, se trouve
r√©duite au moindre r√īle possible, .celui de puissance des contraires,
Ia théodicée d'Aristote, malgré les critiques qui lui ont été adressées,
est en définitive la plus conséquente que l'Antiquité nous ait transmise.
Elle a en tout cas mieux résisté non seulement aux doctrines presque
complètement négatives des
√Čpicuriens,
qui concevaient les dieux comme des êtres doués de la forme humaine,
quoique affranchis des besoins humains et sans corps
solides, menant dans les intervalles des mondes infinis une vie paisible
et bienheureuse, mais aussi √† celles des Sto√Įciens
et des Alexandrins.
Les
Sto√Įciens,
unissant dans une alliance bizarre le naturalisme et le panthéisme, faisaient de Dieu à la
fois l'√Ęme
et le panthéisme, faisaient de Dieu à la
fois l'√Ęme et la substance du monde, en le confondant avec l'√©ther, duquel tout na√ģt,
et dans lequel tout vient s'absorber. Le Dieu des Alexandrins
est, comme celui des √Čl√©ates et de la
Dialectique-platonicienne,
l'être-absolu, l'unité
sans mélange. Mais, après Platon et Aristote, la théodicée alexandrine
e√Ľt √©t√© par trop r√©trograde, si elle n'e√Ľt tenu compte de ces autres
attributs
et la substance du monde, en le confondant avec l'√©ther, duquel tout na√ģt,
et dans lequel tout vient s'absorber. Le Dieu des Alexandrins
est, comme celui des √Čl√©ates et de la
Dialectique-platonicienne,
l'être-absolu, l'unité
sans mélange. Mais, après Platon et Aristote, la théodicée alexandrine
e√Ľt √©t√© par trop r√©trograde, si elle n'e√Ľt tenu compte de ces autres
attributs divins, l'intelligence et la puissance. Concilier ces attributs, qui impliquent
nécessairement la multiplicité (dualité du
sujet
et de l'objet de la connaissance;
dualité de la
cause et de l'effet),
avec l'unité absolue qui est le fond de la nature divine; expliquer comment
l'un se développe dans le multiple, l'infini
dans le fini, par l'émanation (
divins, l'intelligence et la puissance. Concilier ces attributs, qui impliquent
nécessairement la multiplicité (dualité du
sujet
et de l'objet de la connaissance;
dualité de la
cause et de l'effet),
avec l'unité absolue qui est le fond de la nature divine; expliquer comment
l'un se développe dans le multiple, l'infini
dans le fini, par l'émanation ( Système
de l'émanation), par les principes intermédiaires, etc.; telle fut
la t√Ęche impossible que s'impos√®rent les Alexandrins. Syst√®me
de l'émanation), par les principes intermédiaires, etc.; telle fut
la t√Ęche impossible que s'impos√®rent les Alexandrins.
La philosophie chrétienne
ne connut longtemps d'autre Dieu que le Dieu de la Bible .
Telle est, d'ailleurs l'explication de ce que, quand la philosophie
eut conquis assez d'indépendance pour se séparer de la théologie .
Telle est, d'ailleurs l'explication de ce que, quand la philosophie
eut conquis assez d'indépendance pour se séparer de la théologie ,
ce fut vers cette idée de Dieu déjà formée et profondément ancrée
que la ramenèrent constamment ses spéculations.
La philosophie moderne comptera ainsi un certain nombre de déistes,
quelques athées et un système
panthéiste
éclatant, mais peu populaire, le spinozisme.
On n'y trouve pas, cependant, sur la nature et les attributs de Dieu, ces
écarts d'imagination dont Montaigne (Essais ,
ce fut vers cette idée de Dieu déjà formée et profondément ancrée
que la ramenèrent constamment ses spéculations.
La philosophie moderne comptera ainsi un certain nombre de déistes,
quelques athées et un système
panthéiste
éclatant, mais peu populaire, le spinozisme.
On n'y trouve pas, cependant, sur la nature et les attributs de Dieu, ces
écarts d'imagination dont Montaigne (Essais ,
II, 12) a reproduit, au profit du scepticisme,
le tableau piquant que Cicéron en avait déjà
tracé dans le traité De la nature des dieux. II n'y a point de
différences essentielles entre les opinions de Descartes,
de Malebranche, de Leibniz,
de Bossuet, de Fénelon,
de Clarke, etc. Sans doute, même, Kant, ne
se démarque-t-il pas tant que cela de ses prédécesseurs.
(B-E.). ,
II, 12) a reproduit, au profit du scepticisme,
le tableau piquant que Cicéron en avait déjà
tracé dans le traité De la nature des dieux. II n'y a point de
différences essentielles entre les opinions de Descartes,
de Malebranche, de Leibniz,
de Bossuet, de Fénelon,
de Clarke, etc. Sans doute, même, Kant, ne
se démarque-t-il pas tant que cela de ses prédécesseurs.
(B-E.). |
|
|
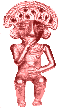
C.
Adam
1900 |
Le
monde ne suffit pas...
Le monde physique
a pu d'abord inspirer à l'humain de la terreur, et quelques philosophes
ont pensé jadis que la croyance aux dieux n'avait pas d'autre cause. Cependant tout n'est
pas terrible pour l'humain dans la nature, et
si toujours, en effet, il a à redouter d'elle la douleur et la mort, c'est
elle aussi qui assure son existence, c'est à elle qu'il est redevable
de toutes les joies de la vie. Comment ne ressentirait-il donc pas à l'égard
des dieux, pour leurs bienfaits, de la reconnaissance et de l'ardeur? La
nature lui appara√ģt comme une bonne m√®re encore plus que comme une mar√Ętre.
Mais peut-être aussi n'est-elle ni l'une ni l'autre, et l'humain a-t-il
tort de se considérer comme le centre et l'unique but de toutes choses,
et de les rapporter à son bien-être physique et à son plaisir; le sentiment
√©go√Įste
qu'il éprouve, en se plaçant à ce point de vue, est trop mêlé, et
contrarie au moins autant qu'il ne favorise son aspiration au divin.
n'avait pas d'autre cause. Cependant tout n'est
pas terrible pour l'humain dans la nature, et
si toujours, en effet, il a à redouter d'elle la douleur et la mort, c'est
elle aussi qui assure son existence, c'est à elle qu'il est redevable
de toutes les joies de la vie. Comment ne ressentirait-il donc pas à l'égard
des dieux, pour leurs bienfaits, de la reconnaissance et de l'ardeur? La
nature lui appara√ģt comme une bonne m√®re encore plus que comme une mar√Ętre.
Mais peut-être aussi n'est-elle ni l'une ni l'autre, et l'humain a-t-il
tort de se considérer comme le centre et l'unique but de toutes choses,
et de les rapporter à son bien-être physique et à son plaisir; le sentiment
√©go√Įste
qu'il éprouve, en se plaçant à ce point de vue, est trop mêlé, et
contrarie au moins autant qu'il ne favorise son aspiration au divin.
La nature d'ailleurs,
par le spectacle de l'ordre immuable qu'elle offre
aux esprits, produit bient√īt en eux l'√©tonnement, source de la sagesse,
disait Platon, c. -à-d. de la philosophie
et de la
science. Car, sous le coup de l'étonnement,
la curiosité
de l'humain s'éveille, et il se met en quête des lois
qui fondent cet ordre de l'univers. A mesure qu'il en prend connaissance,
il se lie davantage à la régularité parfaite avec laquelle tout s'accomplit,
il compte désormais sur elle et ne s'en étonne plus. Or l'harmonie qui
se trouve exister entre sa pensée et les choses
ne témoigne-t-elle pas du commun auteur qui aurait fait le monde pour
√™tre connu de l'esprit humain, et ce dernier pour conna√ģtre le monde?
A moins de prétendre que c'est lui-même encore, que c'est sa propre raison
que l'humain retrouve et recourait ainsi dans un ordre de phénomènes
qui ont leur fondement en lui bien plus que dans les choses? Mais on soutient,
par contre, que l'esprit humain a été formé peu à peu sous la seule
action des choses, et amené par elles au point qui convenait pour les
refléter fidèlement. Le monde n'aurait pas été créé pour répondre
aux besoins de l'intelligence humaine; mais
cette intelligence, produite par lui, se serait, comme les autres productions,
tant bien que mal adaptée au milieu.
Par bonheur, l'humain
éprouve un troisième ordre de sentiments à l'aspect de la nature, il
l'admire comme belle et comme sublime. Et rien ne met mieux son √Ęme
entière en harmonie et en sympathie
avec elle que cette admiration. Par une sorte de magie ,
il lui donne une √Ęme ,
il lui donne une √Ęme ;
il fait d'elle une personne dont il sent battre le coeur contre le sien,
et il s'ab√ģme avec ivresse dans l'infini des
choses, ou plut√īt il l'absorbe en lui et son √Ęme s'√©largit assez pour
le recevoir. L'art et le culte se sont dès l'origine unis, comme si l'émotion-esthétique
ne faisait qu'une avec l'émotion religieuse. Les anciens divinisaient
la nature pour sa beauté, et les modernes, contemplant la mer sans limites
ou dans l'immensité des cieux les étoiles sans nombre, sa prosternent
devant l'infinité de Dieu. ;
il fait d'elle une personne dont il sent battre le coeur contre le sien,
et il s'ab√ģme avec ivresse dans l'infini des
choses, ou plut√īt il l'absorbe en lui et son √Ęme s'√©largit assez pour
le recevoir. L'art et le culte se sont dès l'origine unis, comme si l'émotion-esthétique
ne faisait qu'une avec l'émotion religieuse. Les anciens divinisaient
la nature pour sa beauté, et les modernes, contemplant la mer sans limites
ou dans l'immensité des cieux les étoiles sans nombre, sa prosternent
devant l'infinité de Dieu.
Mais la loi morale,
a dit Kant, ne réclame pas moins notre admiration
que le ciel étoilé. Et, bien avant lui, Aristote
proclamait qu'une chose au monde est encore plus belle que l'étoile du
matin : c'est la justice. L'humain, en effet, qui se consulte lui-même, croit
entendre au fond de sa conscience un oracle plus s√Ľr en faveur de Dieu
que les r√©ponses toujours ambigu√ęs que lui fait l'univers, quand encore
l'univers ne reste pas muet. Dans l'humanité l'ordre n'est pas réalisé
comme dans la nature, et l'on ne trouve que trop le désordre et le mal.
A cette vue, si parfois la conscience humaine
sa sent prise par le doute et par le désespoir qui l'éloigne de Dieu,
d'ordinaire elle se rejette-vers lui dans l'espérance de sa justice. Elle
veut s'expliquer à elle-même le mal, en justifiant celui qui en est l'auteur.
Serait-ce l'effet mystérieux d'un destin aveugle
et barbare, auquel il faille c√©der en silence? Ou n'est-ce pas plut√īt
une punition et aussi une expiation que la justice divine envoie à des
coupables? Au moins de la sorte l'humain n'a rien à reprocher aux dieux;
il s'en prend à lui seul, il s'accuse lui-même, et se juge et se condamne,
plut√īt que de leur attribuer une m√©chancet√© gratuite. Que si l'exp√©rience
ne confirme pas cette théorie généreuse, si
l'on recherche en vain dans la vie d'un mis√©rable la faute qu'il a d√Ļ
commettre, et que, ne la trouvant pas, on remonte jusqu'à ses ancêtres,
toujours en vain, la conscience n'abandonne pas pour cela son explication;
elle suppose plut√īt, au del√† de toute vie dont on a conserv√© la m√©moire,
un premier criminel, auteur de toute l'espèce humaine et pour qui ses
descendants continuent d'√™tre ch√Ęti√©s. Mais quoi! admettra-t-elle donc
des souffrances infligées à perpétuité aux enfants pour le crime de
leur père? La conscience invente alors autre chose : souffrir est une
épreuve momentanée en vue d'un bien, au lieu d'être l'expiation d'un
mal. Il s'agit, non plus de payer la dette du passé, mais de gagner une
récompense dans l'avenir; et le regard se détache volontiers du prétendu
crime antérieur, qui pèserait toujours sur l'humanité, pour s'élancer
au-devant du bonheur futur qu'elle peut obtenir par ses mérites. Cette
seconde théorie, religieuse encore plus que la première, conduit l'humain
jusqu'à Dieu, comme au juste rémunérateur dont il a besoin; toutes deux
vont chercher hors de l'expérience la cause finale ou la raison dernière
de ce qui révolte l'humain dans l'expérience.
: c'est la justice. L'humain, en effet, qui se consulte lui-même, croit
entendre au fond de sa conscience un oracle plus s√Ľr en faveur de Dieu
que les r√©ponses toujours ambigu√ęs que lui fait l'univers, quand encore
l'univers ne reste pas muet. Dans l'humanité l'ordre n'est pas réalisé
comme dans la nature, et l'on ne trouve que trop le désordre et le mal.
A cette vue, si parfois la conscience humaine
sa sent prise par le doute et par le désespoir qui l'éloigne de Dieu,
d'ordinaire elle se rejette-vers lui dans l'espérance de sa justice. Elle
veut s'expliquer à elle-même le mal, en justifiant celui qui en est l'auteur.
Serait-ce l'effet mystérieux d'un destin aveugle
et barbare, auquel il faille c√©der en silence? Ou n'est-ce pas plut√īt
une punition et aussi une expiation que la justice divine envoie à des
coupables? Au moins de la sorte l'humain n'a rien à reprocher aux dieux;
il s'en prend à lui seul, il s'accuse lui-même, et se juge et se condamne,
plut√īt que de leur attribuer une m√©chancet√© gratuite. Que si l'exp√©rience
ne confirme pas cette théorie généreuse, si
l'on recherche en vain dans la vie d'un mis√©rable la faute qu'il a d√Ļ
commettre, et que, ne la trouvant pas, on remonte jusqu'à ses ancêtres,
toujours en vain, la conscience n'abandonne pas pour cela son explication;
elle suppose plut√īt, au del√† de toute vie dont on a conserv√© la m√©moire,
un premier criminel, auteur de toute l'espèce humaine et pour qui ses
descendants continuent d'√™tre ch√Ęti√©s. Mais quoi! admettra-t-elle donc
des souffrances infligées à perpétuité aux enfants pour le crime de
leur père? La conscience invente alors autre chose : souffrir est une
épreuve momentanée en vue d'un bien, au lieu d'être l'expiation d'un
mal. Il s'agit, non plus de payer la dette du passé, mais de gagner une
récompense dans l'avenir; et le regard se détache volontiers du prétendu
crime antérieur, qui pèserait toujours sur l'humanité, pour s'élancer
au-devant du bonheur futur qu'elle peut obtenir par ses mérites. Cette
seconde théorie, religieuse encore plus que la première, conduit l'humain
jusqu'à Dieu, comme au juste rémunérateur dont il a besoin; toutes deux
vont chercher hors de l'expérience la cause finale ou la raison dernière
de ce qui révolte l'humain dans l'expérience.
L'esprit humain
fait plus de difficulté maintenant à en appeler à Dieu tout d'abord;
il ne se décide à l'invoquer enfin qu'après avoir usé de tout le reste.
Le mal dont se plaignent les humain n'a-t-il pas en partie sa cause ici-bas,
en euxmêmes et dans la société dont ils sont membres? Celle-ci est sans
doute établie pour un bien général qu'elle réalise en effet; par elle
la vie humaine se trouve √† peu pr√®s s√Ľre du lendemain et peut se d√©velopper
et s'épanouir chez un certain nombre. Mais ce bien n'est-il pas acheté
chèrement? Tous profitent-ils, chacun selon ses mérites, de tous les
avantages sociaux? Ou n'y a-t-il pas un partage terriblement inégal, une
exploitation inique du plus grand nombre au profit de quelques-uns? Longtemps
on ne vit à ce mal d'autre remède que la pitié pour la foule des misérables,
ou la charité de tous les humains entre eux. Mais de nos jours, lassé
d'attendre les effets de cette charité et de cette pitié que la conscience
seule impose à quelques-uns comme un devoir, on s'est demandé si tous
les autres ne pouvaient rien revendiquer au nom de la justice comme un
droit. Au lieu donc de déclamer contre l'iniquité de la nature et de
Dieu, à laquelle, si elle existe, l'humain ne peut rien, on s'en prend
plut√īt √† l'injustice des soci√©t√©s humaines, qu'on peut au moins corriger.
Mais ceux qui songent à de telles réformes d'un coeur pur
et pour obéir à un sentiment d'humanité qui tout à la fois les pousse
et les guide, ceux qui s'efforcent de le faire passer dans leurs actes
et autour d'eux dans les faits eux-mêmes, ceux-là, qu'ils le veuillent
et le sachent ou non, ont véritablement foi en Dieu, à leur manière,
puisqu'ils travaillent dans la mesure de leurs forces à anticiper sur
la terre la réalisation de son règne, qui est celui de la justice.
Que cet idéal soit
réalisé et personnifié par eux dans un Etre parfait qu'ils adorent,
ou qu'ils se contentent de le croire peu à peu réalisable et de le sentir
vivant et agissant dans leur √Ęme, c'est l√†, en effet, dans l'√Ęme humaine,
qu'il a incontestablement son siège, c'est de là qu'il répand son influence
sur l'humanité. Jamais peut-être on n'a tant cru que de nos jours à
l'empire des idées, et le scepticisme lui-même,
semble-t-il, n'a pas peu contribué à mener à un tel
idéalisme.
Lorsqu'il détruit, ou seulement met en doute, la réalité supérieure
des objets auxquels certaines idées se rapportent, il ne peut faire que
ces idées au moins n'aient existé, qu'elles n'existent même encore dans
l'esprit, et avec elles leur action puissante et bienfaisante sur le monde;
or, pour le scepticisme, cette action, d'o√Ļ la tireraient-elles, que d'elles
seules, si leur objet n'existe pas? L'idéal a donc sa place tout au sommet
de l'√Ęme humaine, o√Ļ nous sommes certains de son existence, comme Descartes
avait la certitude de la vérité
de ces trois propositions Je pense, je
suis, Dieu est. Dieu, pour Descartes, est l'idée du parfait, autant
dire de la perfection, ou, si ces deux mots
disent trop encore, le sentiment et aussi le besoin de perfectionnement
pour l'humain, sentiment et besoin qui ont plus de force qu'une idée,
puisqu'ils entra√ģnent l'√Ęme tout enti√®re et en sont v√©ritablement le
premier moteur. Nous ne nous arrêtons, en effet, dans cette marche ascendante
que par notre faute ou. nos défaillances, car nous avons toujours, disait
Malebranche,
du mouvement pour aller plus loin, et nous sommes produits, selon une parole
de Pascal, pour l'infinité.
Ces pensées qu'exprimaient
les philosophes du XVIIe siècle, en songeant
surtout à l'humain intérieur et à son perfectionnement moral, ceux du
XVIIIe en firent l'application à la science
de la nature et au gouvernement des sociétés; et, ne pouvant réaliser
sur-le-champ tous leurs rêves, ils se consolaient par la théorie du progrès
indéfini de l'humanité. Bien que le XIXe
siècle se défiera de cette formule, il ne renoncera pas à la chose,
et, l'on pourrait toujours dire que tous ceux qui s'efforcent d'améliorer,
d'une façon ou d'une autre, le sort de leurs semblables, et qui croient
au succès de leurs efforts, s'élèvent par là même au-dessus de la
réalité
telle qu'elle est, jusqu'√† une hauteur o√Ļ doivent se rapprocher et s'unir,
dans la religion du bien, leur commun idéal, toutes les bonnes volontés. (C.
Adam).
du bien, leur commun idéal, toutes les bonnes volontés. (C.
Adam).
 |
En
bibliothèque - les dialogues
métaphysiques de Platon, le Phèdre, le Timée, etc.; la
Métaphysique
d'Aristote; Cicéron, De la nature des dieux; St Anselme, Ie Monologiumet
le Proslogium; St Thomas d'Aquin,
Summa theologiae; Descartes,
4e partie du Discours de la méthode, et Méditations; Malebranche,
Recherche
de la vérité, I. III, 2e partie; Leibniz, Monadologie, et
Essais sur la bonté de Dieu, l'origine du mal, etc.; Bossuet, De
la Connaissance de Dieu et de soi-même, et Elévations sur les
mystères; Fénelon, De l'Existence de Dieu; Clarke, De l'Existence
et des attributs de Dieu; spinoza, Ethique, 1re partie, et
Traité théologico-politique; Kant,
Critique de la raison pure,
3e partie; E. Saisset, Essai de Philosophie
religieuse, Paris, 1860, in-8e.
 E.
Caro, L'Idée de Dieu et ses nouveaux critiques; Paris, 1864.
- P. -M. Béraud, L'Idée de Dieu; Paris, 1875. - Guyau,
l'irréligion de l'avenir; Paris, 1887. E.
Caro, L'Idée de Dieu et ses nouveaux critiques; Paris, 1864.
- P. -M. Béraud, L'Idée de Dieu; Paris, 1875. - Guyau,
l'irréligion de l'avenir; Paris, 1887.
|
|
|