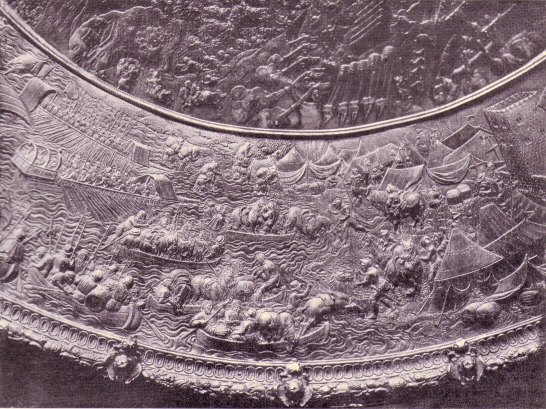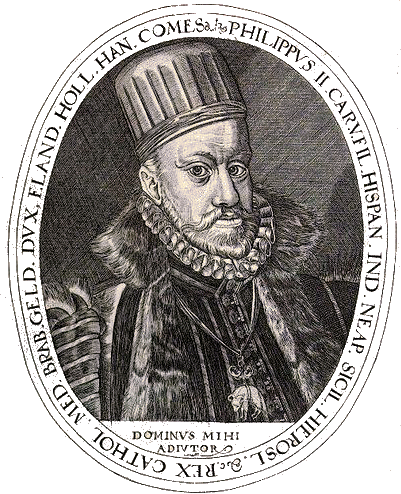|
Le
règne de Charles-Quint
Charles d'Autriche ,
souverain des Pays-Bas ,
souverain des Pays-Bas ,
qui allait ĂŞtre Carlos ler d'Espagne ,
qui allait ĂŞtre Carlos ler d'Espagne ,
puis l'empereur Charles-Quint, n'avait que
seize ans lorsque la mort de son grand-père Ferdinand lui laissa, en 1516,
les royaumes espagnols avec celui de Naples ,
puis l'empereur Charles-Quint, n'avait que
seize ans lorsque la mort de son grand-père Ferdinand lui laissa, en 1516,
les royaumes espagnols avec celui de Naples .
Le vieux cardinal Ximénès exerça la régence en attendant l'arrivée
du nouveau roi. Celui-ci vint enfin, avec son escorte de Flamands, Ă qui
il distribua les plus hautes charges. Ximénès, en dépit de ses services
et de sa grande autorité, fut brutalement écarté de la cour et mourut
sur ces entrefaites. Le jeune roi semblait ne voir que par les yeux de
ses conseillers flamands, qui subordonnaient la politique du royaume aux
intérêts des Pays-Bas et faisaient bon marché de ceux de l'Espagne dans
le traité de Noyon conclu avec François
Ier. Les
Espagnols consternés voyaient en leur roi un étranger et auguraient mal
du nouveau règne. La faveur accordée aux Flamands, leur avidité, leurs
extorsions causèrent beaucoup d'irritation. Charles ne se fit reconnaître
qu'avec peine par les Cortès de Castille .
Le vieux cardinal Ximénès exerça la régence en attendant l'arrivée
du nouveau roi. Celui-ci vint enfin, avec son escorte de Flamands, Ă qui
il distribua les plus hautes charges. Ximénès, en dépit de ses services
et de sa grande autorité, fut brutalement écarté de la cour et mourut
sur ces entrefaites. Le jeune roi semblait ne voir que par les yeux de
ses conseillers flamands, qui subordonnaient la politique du royaume aux
intérêts des Pays-Bas et faisaient bon marché de ceux de l'Espagne dans
le traité de Noyon conclu avec François
Ier. Les
Espagnols consternés voyaient en leur roi un étranger et auguraient mal
du nouveau règne. La faveur accordée aux Flamands, leur avidité, leurs
extorsions causèrent beaucoup d'irritation. Charles ne se fit reconnaître
qu'avec peine par les Cortès de Castille ;
il en eut plus encore à se faire voter un don gratuit par les Cortès
d'Aragon ;
il en eut plus encore à se faire voter un don gratuit par les Cortès
d'Aragon et il n'obtint rien de celles de Catalogne
et il n'obtint rien de celles de Catalogne .
La nouvelle de son Ă©lection Ă l'Empire en 1519
et son départ pour l'Allemagne .
La nouvelle de son Ă©lection Ă l'Empire en 1519
et son départ pour l'Allemagne mirent le comble au mécontentement.
mirent le comble au mécontentement.
Les Comuneros.
Il Ă©tait Ă peine parti qu'une insurrection
Ă©clata. Les villes de Castille ,
soulevées à l'appel de Tolède, massacrèrent les députés qui avaient
voté les subsides, formèrent une Sainte Junte et tirèrent du couvent
où elle était enfermée à Tordesillas la mère de Charles-Quint,
Jeanne la Folle, que sa faiblesse d'esprit avait fait considérer comme
incapable de régner. La révolte prenait ainsi une apparence de légitimité.
Elle s'étendit dans la Galice, l'Estrémadure, puis à Valence, où les
habitants avaient formé une hermandad, ou ligue, contre les nobles. Ce
fut la grande révolte des « Comuneros ». ,
soulevées à l'appel de Tolède, massacrèrent les députés qui avaient
voté les subsides, formèrent une Sainte Junte et tirèrent du couvent
où elle était enfermée à Tordesillas la mère de Charles-Quint,
Jeanne la Folle, que sa faiblesse d'esprit avait fait considérer comme
incapable de régner. La révolte prenait ainsi une apparence de légitimité.
Elle s'étendit dans la Galice, l'Estrémadure, puis à Valence, où les
habitants avaient formé une hermandad, ou ligue, contre les nobles. Ce
fut la grande révolte des « Comuneros ».
S'ils avaient payé
d'audace, ils pouvaient dicter des lois à l'empereur, imposer leurs volontés.
Ils se perdirent par la timidité de leurs doléances et par leurs rivalités.
Les nobles se séparèrent des villes qui prétendaient leur faire restituer
les biens enlevés à la couronne. L'empereur trouva parmi eux des troupes.
La bataille de Villalar (1521)
mit fin à l'insurrection, et son chef, l'héroïque don Juan de Padilla,
porta sa tĂŞte sur l'Ă©chafaud. Charles-Quint
ne revint qu'après la victoire. Irrité de l'affront fait à la majesté
impériale, il ne sut pas se montrer clément et il se vengea par des supplices
et des confiscations. Ce fut, en Castille au moins, le dernier effort pour la défense des vieilles libertés. Il
y eut encore la révolte des Germanias à Valence et Majorque
(1520-1522),
qui furent elles aussi étouffées dans le sang, et
Charles-Quint trouva désormais en ses sujets une soumission et une docilité
sans limite, tandis qu'il commençait contre
François
Ier cette
longue lutte, qui devait, avec de rares trêves, durer quarante années.
au moins, le dernier effort pour la défense des vieilles libertés. Il
y eut encore la révolte des Germanias à Valence et Majorque
(1520-1522),
qui furent elles aussi étouffées dans le sang, et
Charles-Quint trouva désormais en ses sujets une soumission et une docilité
sans limite, tandis qu'il commençait contre
François
Ier cette
longue lutte, qui devait, avec de rares trêves, durer quarante années.
L'Espagne n'était plus désormais qu'une partie de son vaste empire et il la sacrifia
en toute occasion Ă ses grandes combinaisons politiques.
n'était plus désormais qu'une partie de son vaste empire et il la sacrifia
en toute occasion Ă ses grandes combinaisons politiques.
Elle
« ne comptait que par son dévouement, ses réserves d'hommes, ses ressources
financières. Elle fournissait le levier pour soulever le monde; elle était
un moyen, non un but. Il l'Ă©puisait pour soumettre le monde, sans rien
lui donner en échange qu'une gloire ruineuse ».
Son gouvernement intérieur
fut détestable : il ne sut faire aucune réforme, corriger aucun abus;
il n'eut jamais le moindre souci d'alléger les charges de ses sujets.
Il ne chercha presque jamais en Espagne ses conseillers et ses généraux. Son principal ministre, Granvelle, qui
eut sur lui une très grande et très durable influence, était un Franc-Comtois
ses conseillers et ses généraux. Son principal ministre, Granvelle, qui
eut sur lui une très grande et très durable influence, était un Franc-Comtois .
Cependant il confia Ă un Espagnol, Los Covos, la chancellerie d'Espagne,
mais ce fut tout. Du reste, il se réservait la direction suprême et prenait
lui-même toutes les décisions. Les réclamations des Cortès, leur insistance
Ă exprimer les griefs de la nation n'avaient sur lui aucune prise; il
prodiguait les promesses et ne les tenait pas. Il ne fit rien pour débarrasser
l'Espagne du mal qui déjà la rongeait et la ruinait, l'accaparement de
la terre par le clergé.
Il ménagea au contraire ce clergé qui jouissait de très grands privilèges
et qui faisait au profit du roi un trafic lucratif de dispenses et de grâces
spirituelles. Comme il en tirait lui-mĂŞme de grosses ressources, il le
laissa s'engraisser aux dépens de la nation. Les Cortès ne pouvaient
rien et s'inclinaient devant la volonté royale. Une fois seulement, en
1538,
quand Charles-Quint, criblé de dettes et
sans ressources, essaya de s'attaquer aux privilèges financiers de la
noblesse et de la soumettre Ă l'impĂ´t, celle-ci fit, au nom de la nation,
une opposition très vive et qui ne fut pas sans grandeur. Ce fut la dernière
fois : on s'abstint désormais de la convoquer. L'Espagne dut se résoudre
à subir sans protestation la volonté du maître, à payer le luxe d'une
cour oĂą dominaient les Ă©trangers, Ă faire les frais d'une politique
qu'elle n'approuvait pas et où ses propres intérêts étaient sans cesse
sacrifiés. .
Cependant il confia Ă un Espagnol, Los Covos, la chancellerie d'Espagne,
mais ce fut tout. Du reste, il se réservait la direction suprême et prenait
lui-même toutes les décisions. Les réclamations des Cortès, leur insistance
Ă exprimer les griefs de la nation n'avaient sur lui aucune prise; il
prodiguait les promesses et ne les tenait pas. Il ne fit rien pour débarrasser
l'Espagne du mal qui déjà la rongeait et la ruinait, l'accaparement de
la terre par le clergé.
Il ménagea au contraire ce clergé qui jouissait de très grands privilèges
et qui faisait au profit du roi un trafic lucratif de dispenses et de grâces
spirituelles. Comme il en tirait lui-mĂŞme de grosses ressources, il le
laissa s'engraisser aux dépens de la nation. Les Cortès ne pouvaient
rien et s'inclinaient devant la volonté royale. Une fois seulement, en
1538,
quand Charles-Quint, criblé de dettes et
sans ressources, essaya de s'attaquer aux privilèges financiers de la
noblesse et de la soumettre Ă l'impĂ´t, celle-ci fit, au nom de la nation,
une opposition très vive et qui ne fut pas sans grandeur. Ce fut la dernière
fois : on s'abstint désormais de la convoquer. L'Espagne dut se résoudre
à subir sans protestation la volonté du maître, à payer le luxe d'une
cour oĂą dominaient les Ă©trangers, Ă faire les frais d'une politique
qu'elle n'approuvait pas et où ses propres intérêts étaient sans cesse
sacrifiés.
Est-ce Ă dire cependant
que Charles-Quint ait été pour elle un
Ă©tranger, qu'elle n'ait pas vu en lui un souverain national? Il s'en faut
: le fils de Jeanne la Folle, s'il était né en Flandre ,
Ă©tait bien un Espagnol. Du moins il en Ă©tait une caricature, par son
orgueil, par sa piété ardente et fanatique ,
Ă©tait bien un Espagnol. Du moins il en Ă©tait une caricature, par son
orgueil, par sa piété ardente et fanatique ,
son intolérance, sa haine de tout ce qui n'était pas catholique ,
son intolérance, sa haine de tout ce qui n'était pas catholique .
Pour cette raison les Espagnols se sont reconnus en lui et ils lui ont
beaucoup pardonné. Ce peuple s'est laissé sacrifier sans regrets à des
rĂŞves de grandeur. Charles-Quint, s'il a peu fait pour lui, a su du moins
ménager et flatter son orgueil. Il a peu séjourné en Espagne .
Pour cette raison les Espagnols se sont reconnus en lui et ils lui ont
beaucoup pardonné. Ce peuple s'est laissé sacrifier sans regrets à des
rĂŞves de grandeur. Charles-Quint, s'il a peu fait pour lui, a su du moins
ménager et flatter son orgueil. Il a peu séjourné en Espagne ,
mais il affectait de parler presque exclusivement la langue espagnole,
il s'était fait Espagnol d'allures et de caractère. Qu'aurait pu reprocher
un Espagnol Ă un souverain qui rĂŞvait de mettre l'Espagne Ă la tĂŞte
des nations et de relever par elle le catholicisme ébranlé? Ne pouvait-on
payer de quelques misères une telle gloire? Son intolérance religieuse
lui fit exterminer les Maures de Valence qu'on avait poussés à la révolte
en prétendant les obliger à se convertir et ruina pour longtemps les
riches campagnes de ce pays, mais qu'importaient les ruines? Le premier
devoir n'était-il pas d'exterminer les hérétiques? Quand on découvrit,
en Espagne quelques groupes protestants ,
mais il affectait de parler presque exclusivement la langue espagnole,
il s'était fait Espagnol d'allures et de caractère. Qu'aurait pu reprocher
un Espagnol Ă un souverain qui rĂŞvait de mettre l'Espagne Ă la tĂŞte
des nations et de relever par elle le catholicisme ébranlé? Ne pouvait-on
payer de quelques misères une telle gloire? Son intolérance religieuse
lui fit exterminer les Maures de Valence qu'on avait poussés à la révolte
en prétendant les obliger à se convertir et ruina pour longtemps les
riches campagnes de ce pays, mais qu'importaient les ruines? Le premier
devoir n'était-il pas d'exterminer les hérétiques? Quand on découvrit,
en Espagne quelques groupes protestants ,
il sévit cruellement dans ses États des Pays-Bas ,
il sévit cruellement dans ses États des Pays-Bas ,
il déracina le luthéranisme ,
il déracina le luthéranisme à force de persécutions, et le peuple espagnol applaudissait à ses fureurs.
Il s'était attaché à ce souverain en qui il retrouvait ses propres passions.
à force de persécutions, et le peuple espagnol applaudissait à ses fureurs.
Il s'était attaché à ce souverain en qui il retrouvait ses propres passions.
En même temps, se faisant le défenseur
de la catholicité et à vaincre la Réforme, Charles-Quint
chercha à conquérir l'Afrique ;
dans ces diverses entreprises, en dépit de sa puissance et de nombreuses
victoires, il échoua; il fut obligé de signer avec les Protestants ;
dans ces diverses entreprises, en dépit de sa puissance et de nombreuses
victoires, il échoua; il fut obligé de signer avec les Protestants la paix d'Augsbourg
la paix d'Augsbourg (1555), avec la France
(1555), avec la France la trêve de Vaucelles (1555); après
avoir éprouvé un grand échec devant Alger
(1541), il vit dans ses dernières
années les Turcs
la trêve de Vaucelles (1555); après
avoir éprouvé un grand échec devant Alger
(1541), il vit dans ses dernières
années les Turcs lui reprendre Tlemcen, Bougie
lui reprendre Tlemcen, Bougie ,
Tripoli,
sur la cĂ´te barbaresque ,
Tripoli,
sur la cĂ´te barbaresque ,
et continuer à piller les rivages de ses États; une seule compensation
lui venait, la conquĂŞte du Mexique ,
et continuer à piller les rivages de ses États; une seule compensation
lui venait, la conquĂŞte du Mexique ,
du PĂ©rou, du Chili ,
du Pérou, du Chili et d'une grande partie de l'Amérique
et d'une grande partie de l'Amérique par quelques-uns de ses sujets qu'il ne connaissait pas et dont il savait
à peine reconnaître les mérites.
par quelques-uns de ses sujets qu'il ne connaissait pas et dont il savait
à peine reconnaître les mérites.
Lorsque, après la
mort de sa mère, en 1555,
le vieil empereur, épuisé par les fatigues du pouvoir et par la maladie,
dégoûté de ses tentatives avortées, las de tant d'efforts stériles
et guéri peut-être de l'ambition démesurée de ses jeunes années, il
abdiqua ses nombreux États (l'Allemagne en faveur de son frère Ferdinand, l'Espagne
en faveur de son frère Ferdinand, l'Espagne ,
les Pays-Bas ,
les Pays-Bas ,
l'Italie ,
l'Italie ,
l'Amérique en faveur de son fils Philippe)
et ce ne fut pas Ă la Flandre ,
l'Amérique en faveur de son fils Philippe)
et ce ne fut pas Ă la Flandre ,
son pays natal, qu'il demanda d'abriter ses derniers jours. Il avait choisi
Ă l'avance en Espagne ,
son pays natal, qu'il demanda d'abriter ses derniers jours. Il avait choisi
Ă l'avance en Espagne ,
dans une vallée de l'Estrémadure, le lieu de sa retraite et il s'y était
fait construire, à côté du monastère ,
dans une vallée de l'Estrémadure, le lieu de sa retraite et il s'y était
fait construire, à côté du monastère de Yuste, un palais où il vint se confiner au mois d'avril
1556.
Charles-Quint y vécut encore deux
ans, se consacrant surtout à des exercices de piété, mais ayant autour
de lui une petite cour et toujours consulté avec respect par son fils
sur les grandes affaires de l'État. Il y mourut en 1558.
L'éclat de son règne ne doit pas faire oublier qu'avec lui a commencé
la décadence espagnole. Le despotisme qu'il a achevé d'établir n'a pas
été, comme sous Ferdinand, un instrument de progrès; il n'a pas donné
à l'Espagne l'ordre et la prospérité intérieure tout en la privant
de ses libertés; il l'a mise au service d'une politique qui devait la
conduire à la ruine. Il laissait ainsi l'Espagne épuisée par
la perte de tant d'hommes tués sur les champs de bataille ou émigrés,
le trésor vide malgré les millions venus des Indes occidentales, la noblesse
réduite à mendier les faveurs de la cour, les Cortès obéissantes, le
peuple ébloui de tant de grandeur et à la fois fier et misérable.
de Yuste, un palais oĂą il vint se confiner au mois d'avril
1556.
Charles-Quint y vécut encore deux
ans, se consacrant surtout à des exercices de piété, mais ayant autour
de lui une petite cour et toujours consulté avec respect par son fils
sur les grandes affaires de l'État. Il y mourut en 1558.
L'éclat de son règne ne doit pas faire oublier qu'avec lui a commencé
la décadence espagnole. Le despotisme qu'il a achevé d'établir n'a pas
été, comme sous Ferdinand, un instrument de progrès; il n'a pas donné
à l'Espagne l'ordre et la prospérité intérieure tout en la privant
de ses libertés; il l'a mise au service d'une politique qui devait la
conduire à la ruine. Il laissait ainsi l'Espagne épuisée par
la perte de tant d'hommes tués sur les champs de bataille ou émigrés,
le trésor vide malgré les millions venus des Indes occidentales, la noblesse
réduite à mendier les faveurs de la cour, les Cortès obéissantes, le
peuple ébloui de tant de grandeur et à la fois fier et misérable.
-
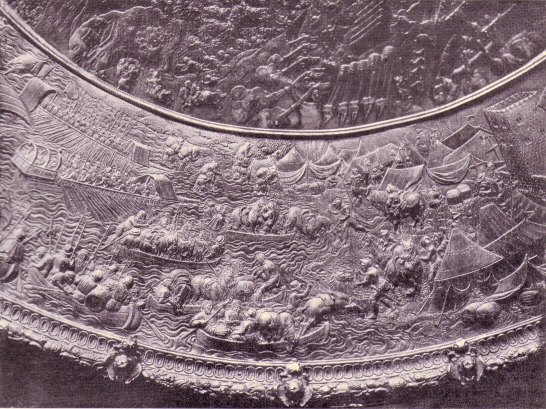
Charles-Quint
débarque à la Goulette. - Episode de la lutte soutenue par Charles-Quint
contre
les corsaires
barbaresques. Partie d'un bassin en vermeil (XVIe s.). (Musée
du Louvre).
Le
règne de Philippe II
A son avènement, Philippe
II est en apparence moins puissant que son père : il n'a pas les domaines
autrichiens ni la couronne impériale, mais il se trouve, par là même, délivré
des embarras qui ont paralysé Charles-Quint.
En outre, marié depuis 1554, en secondes
noces, Ă Marie Tudor, il peut disposer, jusqu'en
1558, de toutes les forces de l'Angleterre
ni la couronne impériale, mais il se trouve, par là même, délivré
des embarras qui ont paralysé Charles-Quint.
En outre, marié depuis 1554, en secondes
noces, Ă Marie Tudor, il peut disposer, jusqu'en
1558, de toutes les forces de l'Angleterre .
Au moment oĂą cette ressource lui manque par la mort de sa femme, la paix
de Cateau-Cambrésis .
Au moment oĂą cette ressource lui manque par la mort de sa femme, la paix
de Cateau-Cambrésis met fin en 1559 à la longue rivalité
avec la France
met fin en 1559 à la longue rivalité
avec la France et lui laisse les mains libres en Italie
et lui laisse les mains libres en Italie et en Europe
et en Europe .
Maître d'un empire immense, servi par d'habiles ministres : le cardinal
Granvelle, don Ruy Gomez de Silva, prince d'Eboli, Antonio PĂ©rez, par
de bons généraux : Philibert-Emmanuel de Savoie .
Maître d'un empire immense, servi par d'habiles ministres : le cardinal
Granvelle, don Ruy Gomez de Silva, prince d'Eboli, Antonio PĂ©rez, par
de bons généraux : Philibert-Emmanuel de Savoie ,
le duc d'Albe, le comte d'Egmont, plus tard Alexandre
Farnèse, ayant une excellente armée, possédant aux Pays-Bas ,
le duc d'Albe, le comte d'Egmont, plus tard Alexandre
Farnèse, ayant une excellente armée, possédant aux Pays-Bas les villes les plus riches de l'Europe, disposant des trésors d'Amérique
les villes les plus riches de l'Europe, disposant des trésors d'Amérique ,
Philippe II a des moyens d'action illimités; toutes les ambitions lui
semblent permises. Il va mettre toutes ses forces au service de la religion
catholique ,
Philippe II a des moyens d'action illimités; toutes les ambitions lui
semblent permises. Il va mettre toutes ses forces au service de la religion
catholique ,
mais il ne distingue pas entre les intérêts de sa religion et ceux de
sa propre grandeur : il faut qu'il triomphe et que l'Espagne ,
mais il ne distingue pas entre les intérêts de sa religion et ceux de
sa propre grandeur : il faut qu'il triomphe et que l'Espagne domine pour que le catholicisme triomphe aussi, et ainsi, dans toutes les
entreprises de Philippe II, le but politique et le but religieux semblent
se confondre.
domine pour que le catholicisme triomphe aussi, et ainsi, dans toutes les
entreprises de Philippe II, le but politique et le but religieux semblent
se confondre.
Espagne et Portugal.
Dans la péninsule ibérique ,
Philippe
II complète l'oeuvre de Ferdinand
et de Charles-Quint; il achève la destruction
des libertés publiques, maintient par la force l'unité religieuse, réalise
enfin l'unité territoriale par la conquête du Portugal ,
Philippe
II complète l'oeuvre de Ferdinand
et de Charles-Quint; il achève la destruction
des libertés publiques, maintient par la force l'unité religieuse, réalise
enfin l'unité territoriale par la conquête du Portugal .
Absolutiste par tempĂ©rament, il ne veut supporter aucune limitation Ă
son pouvoir. L'Aragon .
Absolutiste par tempĂ©rament, il ne veut supporter aucune limitation Ă
son pouvoir. L'Aragon avait gardé son autonomie administrative et certaines institutions protectrices,
comme celle du Justicia, magistrat suprĂŞme qui devait couvrir de
sa protection tout prévenu se recommandant à lui. La disgrâce, après
plusieurs années d'éclatante faveur, d'un de ses secrétaires, Antonio
Pérez, fut pour Philippe II l'occasion de briser ces derniers privilèges.
Celui-ci, arrêté à la suite d'un meurtre, qu'il avait commis, du reste,
sur l'ordre de son maître, trouva moyen de se sauver en Aragon, où, couvert
par la protection du Justicia, il prouva que le meurtre lui avait été
ordonné. Le roi essaya en vain de se le faire livrer. Il réussit bien
Ă le faire ensuite saisir par l'Inquisition
avait gardé son autonomie administrative et certaines institutions protectrices,
comme celle du Justicia, magistrat suprĂŞme qui devait couvrir de
sa protection tout prévenu se recommandant à lui. La disgrâce, après
plusieurs années d'éclatante faveur, d'un de ses secrétaires, Antonio
Pérez, fut pour Philippe II l'occasion de briser ces derniers privilèges.
Celui-ci, arrêté à la suite d'un meurtre, qu'il avait commis, du reste,
sur l'ordre de son maître, trouva moyen de se sauver en Aragon, où, couvert
par la protection du Justicia, il prouva que le meurtre lui avait été
ordonné. Le roi essaya en vain de se le faire livrer. Il réussit bien
Ă le faire ensuite saisir par l'Inquisition ,
mais Pérez avait si bien su gagner les sympathies et intéresser à sa
cause l'opinion publique qu'une émeute éclata et qu'on dut le relâcher.
Il put s'Ă©chapper. Furieux d'ĂŞtre ainsi tenu en Ă©chec, Philippe II fit
entrer des troupes en Aragon; le Justicia, don Juan de Lanuza, fit un timide
essai de résistance, puis se soumit. Philippe fit attendre quelques jours
sa sentence : tout à coup des ordres de mort arrivèrent et la tête du
Justicia tomba sur l'échafaud. D'autres exécutions suivirent. L'Inquisition,
instrument des vengeances royales, sévit cruellement. Philippe II laissa
à l'Aragon son administration particulière et des Cortès désormais
sans influence, et il fit du Justicia un fonctionnaire du roi, révocable
à sa volonté. Il n'avait pas poussé jusqu'au bout sa victoire ni détruit
complètement les franchises aragonaises, mais l'union des deux royaumes
était désormais plus étroite et l'obéissance de l'Aragon assurée. ,
mais Pérez avait si bien su gagner les sympathies et intéresser à sa
cause l'opinion publique qu'une émeute éclata et qu'on dut le relâcher.
Il put s'Ă©chapper. Furieux d'ĂŞtre ainsi tenu en Ă©chec, Philippe II fit
entrer des troupes en Aragon; le Justicia, don Juan de Lanuza, fit un timide
essai de résistance, puis se soumit. Philippe fit attendre quelques jours
sa sentence : tout à coup des ordres de mort arrivèrent et la tête du
Justicia tomba sur l'échafaud. D'autres exécutions suivirent. L'Inquisition,
instrument des vengeances royales, sévit cruellement. Philippe II laissa
à l'Aragon son administration particulière et des Cortès désormais
sans influence, et il fit du Justicia un fonctionnaire du roi, révocable
à sa volonté. Il n'avait pas poussé jusqu'au bout sa victoire ni détruit
complètement les franchises aragonaises, mais l'union des deux royaumes
était désormais plus étroite et l'obéissance de l'Aragon assurée.
S'il exigeait de ses sujets une soumission
absolue, Philippe II sut du moins leur
faire un douloureux sacrifice. Il avait eu de son premier mariage avec
une princesse portugaise, un fils, don Carlos,
de santé débile et de raison très faible. Il avait reconnu, après quelques
tentatives, l'impossibilité de l'initier aux affaires de l'État et il
en vint bientôt à craindre de laisser, en cas de mort, son héritage
aux mains d'un fou. Il ne voulut pas faire courir ce risque Ă son peuple.
Il enferma lui-mĂŞme son fils dans un appartement dont il fit clouer les
fenêtres et le séquestra étroitement. Le pauvre prince y mourut bientôt,
peut-être à la suite d'excès de nourriture (1568).
Sans doute Philippe II a montré à l'égard de ce fils dont il se savait
haï, mais qui n'était guère responsable, une révoltante insensibilité,
mais, du moins, il a sacrifié ses sentiments de famille à son devoir
de roi.
Catholique intransigeant, Philippe II avait déclaré
qu'il aimerait mieux « ne pas régner que de régner sur des hérétiques
». L'Inquisition
intransigeant, Philippe II avait déclaré
qu'il aimerait mieux « ne pas régner que de régner sur des hérétiques
». L'Inquisition continua Ă exercer une rigoureuse surveillance. Quand on dĂ©couvrit Ă
Séville, à Valladolid, à Tolède, quelques groupes de réformés, on
fit des arrestations en masse et bientôt commencèrent les autodafés
continua Ă exercer une rigoureuse surveillance. Quand on dĂ©couvrit Ă
Séville, à Valladolid, à Tolède, quelques groupes de réformés, on
fit des arrestations en masse et bientôt commencèrent les autodafés .
Le premier eut lieu Ă Valladolid en 1559
et ce fut la première cérémonie .
Le premier eut lieu Ă Valladolid en 1559
et ce fut la première cérémonie à laquelle le roi assista en ramenant de France
à laquelle le roi assista en ramenant de France sa jeune femme, Élisabeth de Valois. Quatorze hérétiques y périrent
dans les flammes. Chaque année, les mêmes spectacles se renouvelaient
dans toutes les provinces de l'Espagne
sa jeune femme, Élisabeth de Valois. Quatorze hérétiques y périrent
dans les flammes. Chaque année, les mêmes spectacles se renouvelaient
dans toutes les provinces de l'Espagne .
Philippe montrait un acharnement inouï. Il était intraitable et ne tolérait
aucune nouveauté en matière de foi. Pour mieux préserver son peuple
de toute contagion, il défendit à ses sujets d'aller s'instruire ou enseigner
au dehors et ainsi il ferma complètement l'Espagne à toute influence
étrangère. Il la préserva du moins, au prix de cette lourde intolérance,
des troubles religieux et des guerres civiles, mais elle ne reçut pas
le souffle vivifiant et régénérateur de la Réforme. .
Philippe montrait un acharnement inouï. Il était intraitable et ne tolérait
aucune nouveauté en matière de foi. Pour mieux préserver son peuple
de toute contagion, il défendit à ses sujets d'aller s'instruire ou enseigner
au dehors et ainsi il ferma complètement l'Espagne à toute influence
étrangère. Il la préserva du moins, au prix de cette lourde intolérance,
des troubles religieux et des guerres civiles, mais elle ne reçut pas
le souffle vivifiant et régénérateur de la Réforme.
Du reste, son fanatisme engendra aussi des guerres. Les Maures de Grenade
avaient déjà été contraints par Ferdinand
à se convertir, au mépris de la capitulation de 1492
(
engendra aussi des guerres. Les Maures de Grenade
avaient déjà été contraints par Ferdinand
à se convertir, au mépris de la capitulation de 1492
( L'Espagne musulmane L'Espagne musulmane ;
La Reconquista ;
La Reconquista )
: du moins ils avaient pu garder leurs moeurs, leurs usages, leur langue,
et ils continuaient Ă pratiquer en secret leur religion. Par un Ă©dit
de 1567, Philippe
II leur défendit de porter le costume national et de parler la langue
arabe, de prendre des bains chauds, leur ordonna de célébrer publiquement
leurs cérémonies )
: du moins ils avaient pu garder leurs moeurs, leurs usages, leur langue,
et ils continuaient Ă pratiquer en secret leur religion. Par un Ă©dit
de 1567, Philippe
II leur défendit de porter le costume national et de parler la langue
arabe, de prendre des bains chauds, leur ordonna de célébrer publiquement
leurs cérémonies de famille et d'apprendre en trois ans la langue castillane. Ces exigences
provoquèrent un vaste soulèvement : il fut dompté en deux ans, mais
les rigueurs de l'Inquisition le ranimèrent. Philippe II dut envoyer contre
les révoltés son frère naturel, don Juan
d'Autriche. Celui-ci les traqua dans les montagnes des Alpujaras, les
massacra par milliers. Le roi les bannit du pays, les fit transporter en
Castille
de famille et d'apprendre en trois ans la langue castillane. Ces exigences
provoquèrent un vaste soulèvement : il fut dompté en deux ans, mais
les rigueurs de l'Inquisition le ranimèrent. Philippe II dut envoyer contre
les révoltés son frère naturel, don Juan
d'Autriche. Celui-ci les traqua dans les montagnes des Alpujaras, les
massacra par milliers. Le roi les bannit du pays, les fit transporter en
Castille et en Galice ou vendre comme esclaves. Ainsi disparut une population industrieuse
qui faisait la richesse de l'Espagne
et en Galice ou vendre comme esclaves. Ainsi disparut une population industrieuse
qui faisait la richesse de l'Espagne .
La prospérité du royaume reçut alors un coup dont elle ne s'est jamais
relevée. Il se trouva des prélats espagnols pour accuser Philippe de
tiédeur parce qu'il n'avait pas exterminé tous les infidèles! .
La prospérité du royaume reçut alors un coup dont elle ne s'est jamais
relevée. Il se trouva des prélats espagnols pour accuser Philippe de
tiédeur parce qu'il n'avait pas exterminé tous les infidèles!
Philippe
II les poursuivait cependant avec un zèle infatigable et faisait contre
eux la police de la Méditerranée. Après quelques expéditions malheureuses
contre les Barbaresques de la cĂ´te africaine, il prit part Ă une croisade organisĂ©e Ă
frais communs contre les Turcs
de la cĂ´te africaine, il prit part Ă une croisade organisĂ©e Ă
frais communs contre les Turcs avec le Pape et Venise. Don
Juan d'Autriche, avec une flotte de 300 vaisseaux et 80 000 hommes,
détruisit à Lépante, dans une formidable bataille, la flotte ottomane
(1571). Mais don Juan Ă©choua ensuite
devant Tunis et les VĂ©nitiens ne purent reprendre
Chypre
avec le Pape et Venise. Don
Juan d'Autriche, avec une flotte de 300 vaisseaux et 80 000 hommes,
détruisit à Lépante, dans une formidable bataille, la flotte ottomane
(1571). Mais don Juan Ă©choua ensuite
devant Tunis et les VĂ©nitiens ne purent reprendre
Chypre  .
NĂ©anmoins, la puissance turque Ă©tait affaiblie pour longtemps et le roi
d'Espagne .
NĂ©anmoins, la puissance turque Ă©tait affaiblie pour longtemps et le roi
d'Espagne apparaissait toujours comme le vrai défenseur de la chrétienté.
apparaissait toujours comme le vrai défenseur de la chrétienté.
Philippe
II aurait pu s'assurer une gloire plus solide encore s'il avait su
rendre définitive une grande oeuvre qu'un hasard heureux, préparé par
de nombreux mariages, lui permit de réaliser, l'achèvement de l'unité
territoriale de la péninsule. Fils et mari d'infantes portugaises, il
put, en 1580, après la disparition de don Sébastien, tué dans une expédition
au Maroc ,
et la mort de son oncle et successeur, le vieux cardinal
Henri, poser sa candidature Ă la couronne de Portugal ,
et la mort de son oncle et successeur, le vieux cardinal
Henri, poser sa candidature Ă la couronne de Portugal .
Mais il se forma un parti national portugais, hostile Ă l'union avec l'Espagne .
Mais il se forma un parti national portugais, hostile Ă l'union avec l'Espagne ,
qui essaya de porter au trône le prieur Antonio de Crato, allié de la
famille royale. Philippe II envoya une armée commandée par le duc
d'Albe. Antonio, battu au pont d'Alcantara ,
qui essaya de porter au trône le prieur Antonio de Crato, allié de la
famille royale. Philippe II envoya une armée commandée par le duc
d'Albe. Antonio, battu au pont d'Alcantara ,
s'enfuit et Philippe II fut reconnu roi par les Cortès de Tomar. Il était
venu recevoir l'hommage de ses nouveaux sujets et il promit de respecter
leur autonomie, de résider souvent à Lisbonne.
De fait, après quelques rigueurs contre les partisans de son rival, il
s'efforça de gagner les sympathies, il combla de faveurs la noblesse et
le clergé, puis bientôt, absorbé par d'autres tâches, il délaissa
cette oeuvre qui aurait pu et dû être l'oeuvre capitale de son règne.
En 1583, il quitta le Portugal pour
n'y plus revenir, et il le fit gouverner de loin par les agents souvent
tyranniques, sans aucun souci des revendications des Portugais ni de leur
amour-propre national. Il ne sut pas défendre du démembrement leur immense
empire colonial menacé par les convoitises des Anglais ,
s'enfuit et Philippe II fut reconnu roi par les Cortès de Tomar. Il était
venu recevoir l'hommage de ses nouveaux sujets et il promit de respecter
leur autonomie, de résider souvent à Lisbonne.
De fait, après quelques rigueurs contre les partisans de son rival, il
s'efforça de gagner les sympathies, il combla de faveurs la noblesse et
le clergé, puis bientôt, absorbé par d'autres tâches, il délaissa
cette oeuvre qui aurait pu et dû être l'oeuvre capitale de son règne.
En 1583, il quitta le Portugal pour
n'y plus revenir, et il le fit gouverner de loin par les agents souvent
tyranniques, sans aucun souci des revendications des Portugais ni de leur
amour-propre national. Il ne sut pas défendre du démembrement leur immense
empire colonial menacé par les convoitises des Anglais et des Hollandais
et des Hollandais ;
il n'eut mĂŞme pas, semble-t-il, l'intuition du grand rĂ´le qu'il aurait
pu jouer en fixant sa capitale Ă Lisbonne et en limitant son effort Ă
assurer Ă l'Espagne et au Portugal unis la domination des mers et des
mondes nouveaux; il ne fit rien de ce qui aurait rendu l'union féconde
et durable. Le Portugal, rattachĂ© Ă l'Espagne malgrĂ© lui, n'aspira qu'Ă
s'en séparer et attendit l'occasion favorable qui ne devait se présenter
que soixante ans plus tard. ;
il n'eut mĂŞme pas, semble-t-il, l'intuition du grand rĂ´le qu'il aurait
pu jouer en fixant sa capitale Ă Lisbonne et en limitant son effort Ă
assurer Ă l'Espagne et au Portugal unis la domination des mers et des
mondes nouveaux; il ne fit rien de ce qui aurait rendu l'union féconde
et durable. Le Portugal, rattachĂ© Ă l'Espagne malgrĂ© lui, n'aspira qu'Ă
s'en séparer et attendit l'occasion favorable qui ne devait se présenter
que soixante ans plus tard.
Ainsi Philippe
II avait complĂ©tĂ© l'unitĂ© de la pĂ©ninsule ibĂ©rique et donnĂ© Ă
sa monarchie une puissance formidable en apparence.
Il pouvait, semblait-il, tout oser et tout entreprendre. La suite du règne
allait montrer combien cette puissance était précaire.
L'indépendance
des Pays-Bas.
Philippe
II ne put même en effet maintenir l'intégrité de son empire. Au
moment où il conquérait le Portugal ,
il venait de perdre une partie de ses États des Pays-Bas ,
il venait de perdre une partie de ses États des Pays-Bas .
Les divers duchés, comtés, seigneuries et villes libres des Pays-Bas,
que les Habsbourg d'Espagne .
Les divers duchés, comtés, seigneuries et villes libres des Pays-Bas,
que les Habsbourg d'Espagne tenaient de leurs ancĂŞtres les ducs de Bourgogne
tenaient de leurs ancĂŞtres les ducs de Bourgogne ,
avaient été enfin, sous Charles-Quint,
après de longs efforts, amalgamés en un État unique et indivisible par
la pragmatique sanction de Bruxelles ,
avaient été enfin, sous Charles-Quint,
après de longs efforts, amalgamés en un État unique et indivisible par
la pragmatique sanction de Bruxelles de 1549. Les sept provinces du Nord,
oĂą se parlait le hollandais, s'Ă©taient enrichies par la pĂŞche et le
commerce; les dix provinces du Sud, de langue flamande et française, la
Belgique
de 1549. Les sept provinces du Nord,
oĂą se parlait le hollandais, s'Ă©taient enrichies par la pĂŞche et le
commerce; les dix provinces du Sud, de langue flamande et française, la
Belgique d'aujourd'hui, prospéraient surtout par l'agriculture et l'industrie;
leurs villes, très peuplées, tiraient d'énormes ressources du tissage
des draps et des toiles. Anvers
d'aujourd'hui, prospéraient surtout par l'agriculture et l'industrie;
leurs villes, très peuplées, tiraient d'énormes ressources du tissage
des draps et des toiles. Anvers Ă©tait de beaucoup le plus grand port de l'Europe
Ă©tait de beaucoup le plus grand port de l'Europe . .
Il y avait dans ces provinces une bourgeoisie
opulente et cultivée, une noblesse respectée, jalouse de son indépendance,
mais très loyaliste. La Réforme trouva dans ces riches provinces voisines
de l'Allemagne un terrain favorable. Charles-Quint essaya
en vain de l'en extirper : l'Inquisition
un terrain favorable. Charles-Quint essaya
en vain de l'en extirper : l'Inquisition ,
introduite par lui, y fit environ 50 000 victimes, et le vieil empereur
en abdiquant ordonna Ă son fils d'achever son oeuvre. Celui-ci n'y Ă©tait
que trop disposé. Il avait laissé la régence des Pays-Bas ,
introduite par lui, y fit environ 50 000 victimes, et le vieil empereur
en abdiquant ordonna Ă son fils d'achever son oeuvre. Celui-ci n'y Ă©tait
que trop disposé. Il avait laissé la régence des Pays-Bas à sa soeur naturelle, Marguerite de Parme
Ă sa soeur naturelle, Marguerite de Parme ,
qui montrait beaucoup de modération, mais le cardinal Granvelle, nommé
par lui archevêque-primat de Malines, présida de 1560
à 1564 à une violente persécution.
La noblesse se fit l'interprète du mécontentement public et protesta
auprès de Philippe II. Elle avait
Ă sa tĂŞte un personnage de grande famille, Guillaume de Nassau, prince
d'Orange, élevé aux plus hautes dignités par la faveur de Charles-Quint,
riche, habile, énergique; sa naissance, sa générosité, ses manières
séduisantes, lui avaient valu une grande popularité. Il avait l'âme
assez haute pour se dévouer entièrement, en lui sacrifiant sa fortune
et ses ambitions personnelles, à la cause qu'il défendait. Il était
de ceux qu'aucun échec ne rebute et ne décourage. On l'a appelé le
Taciturne (et il a gardé ce surnom dans l'histoire), non qu'il fût
d'humeur sombre et sévère, mais parce qu'il savait garder un secret.
Ce grand seigneur, qui penchait secrètement pour le calvinisme ,
qui montrait beaucoup de modération, mais le cardinal Granvelle, nommé
par lui archevêque-primat de Malines, présida de 1560
à 1564 à une violente persécution.
La noblesse se fit l'interprète du mécontentement public et protesta
auprès de Philippe II. Elle avait
Ă sa tĂŞte un personnage de grande famille, Guillaume de Nassau, prince
d'Orange, élevé aux plus hautes dignités par la faveur de Charles-Quint,
riche, habile, énergique; sa naissance, sa générosité, ses manières
séduisantes, lui avaient valu une grande popularité. Il avait l'âme
assez haute pour se dévouer entièrement, en lui sacrifiant sa fortune
et ses ambitions personnelles, à la cause qu'il défendait. Il était
de ceux qu'aucun échec ne rebute et ne décourage. On l'a appelé le
Taciturne (et il a gardé ce surnom dans l'histoire), non qu'il fût
d'humeur sombre et sévère, mais parce qu'il savait garder un secret.
Ce grand seigneur, qui penchait secrètement pour le calvinisme ,
mais qui ne songeait nullement Ă une rupture avec l'Espagne ,
mais qui ne songeait nullement Ă une rupture avec l'Espagne ,
allait être, un peu malgré lui, le chef d'une révolution, le créateur
d'un nouvel État et l'ancêtre d'une dynastie. ,
allait être, un peu malgré lui, le chef d'une révolution, le créateur
d'un nouvel État et l'ancêtre d'une dynastie.
Deux autres personnages, le chevaleresque
comte d'Egmont et le comte de Horn, de la famille française des Montmorency,
Ă©taient avec lui les membres les plus influents du Conseil de la RĂ©gente.
Ce furent les premiers défenseurs de la liberté religieuse aux Pays-Bas .
Il faut joindre à leurs noms ceux de Henri de Bréderode, de Louis de
Nassau, frère du Taciturne, et surtout de Philippe
de Marnix de Sainte-Aldegonde, qui a été l'un des plus actifs propagateurs
de la réforme calviniste .
Il faut joindre à leurs noms ceux de Henri de Bréderode, de Louis de
Nassau, frère du Taciturne, et surtout de Philippe
de Marnix de Sainte-Aldegonde, qui a été l'un des plus actifs propagateurs
de la réforme calviniste et a combattu par la plume comme par l'épée. Les nobles réussirent bien
Ă obtenir en 1564 le rappel de Granvelle,
mais, Ă la suite d'un voyage d'Egmont Ă Madrid,
Philippe
II, au lieu de faire droit aux dolĂ©ances, ordonna des poursuites Ă
outrance contre l'hérésie (1565).
Guillaume déclara que « c'était le commencement d'une belle tragédie
». Quelques jeunes nobles prirent aussitôt l'initiative d'une protestation
que rédigea Marnix : ce fut le Compromis de Bréda
et a combattu par la plume comme par l'épée. Les nobles réussirent bien
Ă obtenir en 1564 le rappel de Granvelle,
mais, Ă la suite d'un voyage d'Egmont Ă Madrid,
Philippe
II, au lieu de faire droit aux dolĂ©ances, ordonna des poursuites Ă
outrance contre l'hérésie (1565).
Guillaume déclara que « c'était le commencement d'une belle tragédie
». Quelques jeunes nobles prirent aussitôt l'initiative d'une protestation
que rédigea Marnix : ce fut le Compromis de Bréda ,
qui demandait la suppression de l'Inquisition ,
qui demandait la suppression de l'Inquisition .
Plus de 2000 gentilshommes y adhérèrent, et 400 d'entre eux allèrent
le présenter solennellement à la Régente. Celle-ci, sans leur faire
mauvais accueil, répondit de façon assez vague. Une tradition veut qu'un
des membres de son Conseil ait traité de gueux les protestataires.
On n'en est pas sûr : en tout cas, c'est dans un banquet qui suivit cette
réception que Henri de Brederode proposa à ses amis de se parer de ce
nom qu'on leur donnait par dérision et de prendre comme signes de ralliement
la besace de cuir et l'Ă©cuelle de bois des mendiants. Le nom resta : Gueux
de terre et Gueux de mer vont faire dès lors une rude guerre
aux Espagnols .
Plus de 2000 gentilshommes y adhérèrent, et 400 d'entre eux allèrent
le présenter solennellement à la Régente. Celle-ci, sans leur faire
mauvais accueil, répondit de façon assez vague. Une tradition veut qu'un
des membres de son Conseil ait traité de gueux les protestataires.
On n'en est pas sûr : en tout cas, c'est dans un banquet qui suivit cette
réception que Henri de Brederode proposa à ses amis de se parer de ce
nom qu'on leur donnait par dérision et de prendre comme signes de ralliement
la besace de cuir et l'Ă©cuelle de bois des mendiants. Le nom resta : Gueux
de terre et Gueux de mer vont faire dès lors une rude guerre
aux Espagnols jusqu'à expulsion complète. Philippe
II n'ayant répondu qu'en désavouant sa soeur, les calvinistes
jusqu'à expulsion complète. Philippe
II n'ayant répondu qu'en désavouant sa soeur, les calvinistes coururent partout aux armes. Au milieu de l'effervescence générale, ils
saccagèrent et dévastèrent les églises
dans nombre de villes. Orange et Egmont étaient entraînés, dépassés
: ils désapprouvaient ces tristes exploits « des briseurs d'images ».
La Régente était impuissante à les réprimer.
coururent partout aux armes. Au milieu de l'effervescence générale, ils
saccagèrent et dévastèrent les églises
dans nombre de villes. Orange et Egmont étaient entraînés, dépassés
: ils désapprouvaient ces tristes exploits « des briseurs d'images ».
La Régente était impuissante à les réprimer.
Philippe II, profondément indigné des
profanations commises, envoya aux Pays-Bas le terrible duc d'Albe avec une armée. Son nom
seul Ă©tait un programme de gouvernement. Albe Ă©tait un soldat fanatique
et impitoyable, résolu à mater les hérétiques. A son arrivée, plus
de 100 000 personnes s'enfuirent et Marguerite de Parme se hâta de donner
sa démission (1567). Egmont et Horn,
partisans de la conciliation, avaient refusé de fuir avec le Taciturne
: « Adieu, prince sans terres », lui avait dit Egmont en le quittant.
- « Adieu, comte sans tête », lui avait répliqué celui-ci. Tous deux
avaient dit vrai. Les biens de Guillaume furent confisqués, mais Egmont
et Horn, arrêtés presque aussitôt par ordre du duc d'Albe, furent, bien
que restés catholiques
le terrible duc d'Albe avec une armée. Son nom
seul Ă©tait un programme de gouvernement. Albe Ă©tait un soldat fanatique
et impitoyable, résolu à mater les hérétiques. A son arrivée, plus
de 100 000 personnes s'enfuirent et Marguerite de Parme se hâta de donner
sa démission (1567). Egmont et Horn,
partisans de la conciliation, avaient refusé de fuir avec le Taciturne
: « Adieu, prince sans terres », lui avait dit Egmont en le quittant.
- « Adieu, comte sans tête », lui avait répliqué celui-ci. Tous deux
avaient dit vrai. Les biens de Guillaume furent confisqués, mais Egmont
et Horn, arrêtés presque aussitôt par ordre du duc d'Albe, furent, bien
que restés catholiques ,
décapités sur la grande place de Bruxelles ,
décapités sur la grande place de Bruxelles .
Ce furent les premières victimes. .
Ce furent les premières victimes.
Le duc d'Albe créa,
pour poursuivre les rebelles, un Conseil des Troubles, que les habitants
ont appelé le Tribunal de Sang, qui prononça par milliers les
sentences de mort et de confiscation et qui fit plus de 20 000 victimes.
Les Pays-Bas se couvrirent d'échafauds, de potences et de bûchers : la population
était terrifiée. Guillaume d'Orange, qui s'était enfin prononcé ouvertement,
pour le calvinisme
se couvrirent d'échafauds, de potences et de bûchers : la population
était terrifiée. Guillaume d'Orange, qui s'était enfin prononcé ouvertement,
pour le calvinisme ,
ayant pris l'offensive avec quelques troupes allemandes ,
ayant pris l'offensive avec quelques troupes allemandes ,
Albe le battit sur les bords de l'Ems et le força à s'enfuir en France ,
Albe le battit sur les bords de l'Ems et le força à s'enfuir en France .
Il rentra victorieux Ă Anvers .
Il rentra victorieux Ă Anvers et s'y fit dresser une statue de bronze oĂą
il était représenté foulant aux pieds les Pays-Bas enchaînés. II pouvait
annoncer superbement Ă Philippe Il
que la révolte était domptée. En même temps le duc écrasait d'impôts
tout le pays : le terrible impôt de l'alcavala (impôt du dixième
sur le produit de toutes les ventes) ruinait les commerçants, aussi bien
les catholiques que les calvinistes, et provoquait un nouveau mouvement
d'Ă©migration. Partout les affaires s'arrĂŞtaient.
et s'y fit dresser une statue de bronze oĂą
il était représenté foulant aux pieds les Pays-Bas enchaînés. II pouvait
annoncer superbement Ă Philippe Il
que la révolte était domptée. En même temps le duc écrasait d'impôts
tout le pays : le terrible impôt de l'alcavala (impôt du dixième
sur le produit de toutes les ventes) ruinait les commerçants, aussi bien
les catholiques que les calvinistes, et provoquait un nouveau mouvement
d'Ă©migration. Partout les affaires s'arrĂŞtaient.
Les
Gueux.
Subitement une nouvelle foudroyante releva
les courages : en 1572, par un hardi
coup de main, une bande de 250 Gueux de mer avait enlevé la petite place
de Brielle à l'embouchure de la Meuse. Aussitôt la Zélande puis la Hollande se soulèvent; le synode de Dordrecht proclame Guillaume
d'Orange lieutenant du roi, dont on ne songeait pas encore à se séparer;
de proche en proche le mouvement gagne les provinces du Nord. Orange reprend
l'offensive, mais la Saint-Barthélemy
lui Ă´te Ă ce moment tout espoir d'ĂŞtre secouru par la France
puis la Hollande se soulèvent; le synode de Dordrecht proclame Guillaume
d'Orange lieutenant du roi, dont on ne songeait pas encore à se séparer;
de proche en proche le mouvement gagne les provinces du Nord. Orange reprend
l'offensive, mais la Saint-Barthélemy
lui Ă´te Ă ce moment tout espoir d'ĂŞtre secouru par la France .
Mons est reprise par le duc d'Albe et cruellement
traitée; Malines est abandonnée trois jours à la soldatesque espagnole;
Harlem enfin, qui a dû capituler après un siège héroïque où les femmes
elles-mêmes ont contribué à la défense, voit sa garnison massacrée
au mépris de la capitulation signée et 1200 de ses citoyens décapités
ou noyés dans le lac. Philippe II
lui-même fut effrayé de tant d'horreurs; il craignit de ne plus avoir
à régner que sur un désert. Une défaite navale des Espagnols sur le
Zuiderzee le décida à rappeler le duc d'Albe (1573). .
Mons est reprise par le duc d'Albe et cruellement
traitée; Malines est abandonnée trois jours à la soldatesque espagnole;
Harlem enfin, qui a dû capituler après un siège héroïque où les femmes
elles-mêmes ont contribué à la défense, voit sa garnison massacrée
au mépris de la capitulation signée et 1200 de ses citoyens décapités
ou noyés dans le lac. Philippe II
lui-même fut effrayé de tant d'horreurs; il craignit de ne plus avoir
à régner que sur un désert. Une défaite navale des Espagnols sur le
Zuiderzee le décida à rappeler le duc d'Albe (1573).
Il envoya Ă sa place don Luis de Requesens,
avec des instructions plus conciliantes, mais la proclamation d'une amnistie,
dont 300 personnes étaient exceptées, et l'abolition du Conseil des Troubles
ne suffirent pas à rétablir la paix. La guerre continua dans le Nord,
où Louis de Nassau fut tué et où Leyde résista victorieusement, et
en Zélande, où Requesens mourut bientôt. Leyde, dégagée par la flotte
des Gueux de mer, eut à choisir, en récompense de sa belle défense,
entre une exemption d'impôts et une université calviniste .
Elle choisit l'université, qui fut installée en pleine guerre et devint
bientôt une des plus célèbres de l'Europe .
Elle choisit l'université, qui fut installée en pleine guerre et devint
bientôt une des plus célèbres de l'Europe (1575). Pendant l'intérim entre la
mort de Requesens et l'arrivée de son successeur, don Juan
d'Autriche, un rapprochement se fit entre les provinces du Sud restées
catholiques
(1575). Pendant l'intérim entre la
mort de Requesens et l'arrivée de son successeur, don Juan
d'Autriche, un rapprochement se fit entre les provinces du Sud restées
catholiques et celles du Nord. Une véritable constitution fut rédigée : la Pacification
de Gand faisait des Pays-Bas
et celles du Nord. Une véritable constitution fut rédigée : la Pacification
de Gand faisait des Pays-Bas une sorte d'État autonome, où chaque province garderait son administration
particulière et où régnerait la liberté de conscience; une amnistie
générale était promise; catholiques et protestants
une sorte d'État autonome, où chaque province garderait son administration
particulière et où régnerait la liberté de conscience; une amnistie
générale était promise; catholiques et protestants devaient s'allier pour éloigner les soldats espagnols (8 novembre
1576).
Mais ces troupes qu'on voulait licencier résistèrent et recommencèrent
leurs ravages. La belle ville d'Anvers
devaient s'allier pour Ă©loigner les soldats espagnols (8 novembre
1576).
Mais ces troupes qu'on voulait licencier résistèrent et recommencèrent
leurs ravages. La belle ville d'Anvers ,
tombée entre leurs mains, fut abominablement saccagée 8000 personnes
furent égorgées, les églises et les riches
maisons pillées, une partie de la ville dévorée par l'incendie. Les
catholiques, exaspérés, étaient prêts à faire cause commune avec Guillaume
d'Orange. ,
tombée entre leurs mains, fut abominablement saccagée 8000 personnes
furent égorgées, les églises et les riches
maisons pillées, une partie de la ville dévorée par l'incendie. Les
catholiques, exaspérés, étaient prêts à faire cause commune avec Guillaume
d'Orange.
Philippe
II avait compté, pour arranger les choses, sur le prestige personnel
de son frère don Juan d'Autriche, le vainqueur
de LĂ©pante ( L'Empire ottoman au
XVIe siècle L'Empire ottoman au
XVIe siècle ).
Celui-ci ne put empêcher le prince d'Orange, nommé gouverneur de Brabant ).
Celui-ci ne put empêcher le prince d'Orange, nommé gouverneur de Brabant et de Flandre
et de Flandre ,
de faire Ă Bruxelles ,
de faire à Bruxelles une entrée triomphale. Il recommença la guerre et fut victorieux à Gembloux
(1577), mais il ne put reprendre Bruxelles.
Il ne sut pas non plus profiter des divisions qui recommençaient entre
calvinistes
une entrée triomphale. Il recommença la guerre et fut victorieux à Gembloux
(1577), mais il ne put reprendre Bruxelles.
Il ne sut pas non plus profiter des divisions qui recommençaient entre
calvinistes et catholiques
et catholiques et auxquelles le prince d'Orange essaya vainement de mettre fin par son
admirable projet de « Paix de Religion », qui lui fait le plus grand
honneur. Des deux parts cette pensée de tolérance fut repoussée. La
situation Ă©tait des plus troubles quand don Juan mourut, tout Ă fait
découragé (1578).
et auxquelles le prince d'Orange essaya vainement de mettre fin par son
admirable projet de « Paix de Religion », qui lui fait le plus grand
honneur. Des deux parts cette pensée de tolérance fut repoussée. La
situation Ă©tait des plus troubles quand don Juan mourut, tout Ă fait
découragé (1578).
Alexandre
Farnèse et Maurice de Nassau.
Le successeur de don
Juan, Alexandre Farnèse, le fils de Marguerite de Parme, était un
homme d'État et un général de premier ordre. Il sut exploiter habilement
les divisions de ses adversaires et rattacher fortement Ă l'Espagne les provinces du sud, qui venaient de se grouper par l'Union d'Arras.
Celles du nord, Hollande, ZĂ©lande, Gueldre, Utrecht, Groningue, Over-Yssel
et Frise, formèrent par l'Union d'Utrecht
les provinces du sud, qui venaient de se grouper par l'Union d'Arras.
Celles du nord, Hollande, ZĂ©lande, Gueldre, Utrecht, Groningue, Over-Yssel
et Frise, formèrent par l'Union d'Utrecht un véritable État séparé, où, chaque province conservant son autonomie,
les questions communes seraient réglées par des États Généraux. Un
stathouder aurait le pouvoir exécutif et la direction des forces de terre
et de mer (1579). Guillaume d'Orange
fut nommé stathouder et son autorité imposa l'union aux provinces. Un
nouvel État était né, mais ce ne fut qu'un peu plus tard, quand Philippe
II eut mis à prix la tête du prince d'Orange, que les États Généraux
rompirent ouvertement avec lui, prononcèrent sa déchéance et proclamèrent
l'indépendance de la République des sept « Provinces Unies » (1581).
un véritable État séparé, où, chaque province conservant son autonomie,
les questions communes seraient réglées par des États Généraux. Un
stathouder aurait le pouvoir exécutif et la direction des forces de terre
et de mer (1579). Guillaume d'Orange
fut nommé stathouder et son autorité imposa l'union aux provinces. Un
nouvel État était né, mais ce ne fut qu'un peu plus tard, quand Philippe
II eut mis à prix la tête du prince d'Orange, que les États Généraux
rompirent ouvertement avec lui, prononcèrent sa déchéance et proclamèrent
l'indépendance de la République des sept « Provinces Unies » (1581).
Guillaume essaya d'opposer à Farnèse
le duc d'Anjou ,
frère de Henri III, auquel il offrit, pour
avoir l'alliance de la France ,
frère de Henri III, auquel il offrit, pour
avoir l'alliance de la France ,
la souveraineté des Pays-Bas ,
la souveraineté des Pays-Bas .
Celui-ci ne sut pas se rendre populaire; après quelques succès, il se
compromit par une sorte de coup d'État catholique à Anvers .
Celui-ci ne sut pas se rendre populaire; après quelques succès, il se
compromit par une sorte de coup d'État catholique à Anvers et dut rentrer en France (1584). A
ce moment, Guillaume d'Orange, le libérateur, le père de la patrie, après
avoir échappé à huit tentatives d'assassinat ourdies contre lui par
l'Espagne
et dut rentrer en France (1584). A
ce moment, Guillaume d'Orange, le libérateur, le père de la patrie, après
avoir échappé à huit tentatives d'assassinat ourdies contre lui par
l'Espagne et par les jésuites
et par les jésuites ,
tombait Ă Delft sous les coups d'un fanatique, Balthazar GĂ©rard, qu'il
avait admis dans sa familiarité. Farnèse profita de ce crime pour poursuivre
ses succès : il avait repris les places de la Flandre ,
tombait Ă Delft sous les coups d'un fanatique, Balthazar GĂ©rard, qu'il
avait admis dans sa familiarité. Farnèse profita de ce crime pour poursuivre
ses succès : il avait repris les places de la Flandre et du Brabant
et du Brabant ,
était rentré à Bruxelles ,
était rentré à Bruxelles .
Enfin, après un siège de quatorze mois, il s'empara d'Anvers, où Marnix
avait fait une admirable défense. Les Gueux de mer fermèrent aussitôt
l'Escaut, et les ports de Hollande héritèrent du commerce d'Anvers, dont
la prospérité fut ruinée pour deux siècles, mais les provinces du Sud
restaient Ă l'Espagne (1585). .
Enfin, après un siège de quatorze mois, il s'empara d'Anvers, où Marnix
avait fait une admirable défense. Les Gueux de mer fermèrent aussitôt
l'Escaut, et les ports de Hollande héritèrent du commerce d'Anvers, dont
la prospérité fut ruinée pour deux siècles, mais les provinces du Sud
restaient Ă l'Espagne (1585).
Celles du Nord traversèrent encore une
période de crise où leur indépendance courut de sérieux dangers. Elles
voulurent se donner d'abord Ă Henri III, qui
refusa, puis à Élisabeth Ire,
qui leur envoya son favori Leicester; celui-ci échoua complètement. Elles
se décidèrent enfin à confier le stathoudérat au second fils du Taciturne,
Maurice de Nassau, qui se trouva ĂŞtre aussi un
très habile homme de guerre. Celui-ci arrêta les succès de Farnèse,
que Philippe II, du reste, détournait
de sa tâche aux Pays-Bas pour le faire coopérer à ses entreprises contre l'Angleterre
pour le faire coopérer à ses entreprises contre l'Angleterre et contre la France
et contre la France .
La mort de Farnèse délivra bientôt les Provinces Unies de leur plus
redoutable ennemi, et leur alliance avec la France .
La mort de Farnèse délivra bientôt les Provinces Unies de leur plus
redoutable ennemi, et leur alliance avec la France ,
oĂą Henri IV avait enfin conquis son trĂ´ne,
assura leur existence. Toutefois le nouvel État faillit encore porter
la peine de ses divisions. Il s'y était formé un parti républicain et
bourgeois, favorable Ă la paix, hostile au parti militaire qui aurait
désiré une dictature
héréditaire aux mains de la maison d'Orange. Philippe II, après la paix
de Vervins ,
oĂą Henri IV avait enfin conquis son trĂ´ne,
assura leur existence. Toutefois le nouvel État faillit encore porter
la peine de ses divisions. Il s'y était formé un parti républicain et
bourgeois, favorable Ă la paix, hostile au parti militaire qui aurait
désiré une dictature
héréditaire aux mains de la maison d'Orange. Philippe II, après la paix
de Vervins ,
avait transmis les Pays-Bas à sa fille Isabelle-Claire-Eugénie qu'il
maria Ă son cousin, l'archiduc Albert d'Autriche. ,
avait transmis les Pays-Bas à sa fille Isabelle-Claire-Eugénie qu'il
maria Ă son cousin, l'archiduc Albert d'Autriche.
Philippe
II mourut sur ces entrefaites (1598),
mais l'infante et son mari reprirent la guerre. Maurice
de Nassau remporta une grande victoire Ă Nieuport, mais l'archiduc
s'empara d'Ostende après un siège de trois ans, où il sacrifia 8000
hommes. Maurice, cependant, reprenait l'offensive; les Hollandais, maîtres
de la mer, commençaient à enlever les colonies espagnoles et portugaises.
Henri IV s'entremit : sa médiation aboutit en
1609 Ă la conclusion d'une trĂŞve
de douze ans, dont les deux partis avaient un égal besoin. L'Espagne reconnaissait implicitement l'indépendance des Provinces Unies
reconnaissait implicitement l'indépendance des Provinces Unies .
Ainsi cette longue guerre, provoquée par l'intolérance de Phlippe II,
aboutissait à la création, aux dépens de l'Espagne, d'une république
protestante .
Ainsi cette longue guerre, provoquée par l'intolérance de Phlippe II,
aboutissait à la création, aux dépens de l'Espagne, d'une république
protestante ,
déjà riche et puissante, qui, au cours même de la lutte, avait commencé
Ă accaparer le commerce des mers et des colonies. Les provinces du Sud,
que leur attachement au catholicisme ,
déjà riche et puissante, qui, au cours même de la lutte, avait commencé
Ă accaparer le commerce des mers et des colonies. Les provinces du Sud,
que leur attachement au catholicisme avait fait rester aux mains de l'Espagne, étaient dépeuplées et ruinées.
Un peuple, résolu à défendre sa liberté religieuse et son indépendance,
avait tenu en Ă©chec pendant plus de quarante ans la monarchie
espagnole et lui avait enlevé sept de ses plus riches provinces. C'est
à cette constatation d'impuissance dans ses propres États qu'avait abouti
la politique de Philippe II.
avait fait rester aux mains de l'Espagne, étaient dépeuplées et ruinées.
Un peuple, résolu à défendre sa liberté religieuse et son indépendance,
avait tenu en Ă©chec pendant plus de quarante ans la monarchie
espagnole et lui avait enlevé sept de ses plus riches provinces. C'est
à cette constatation d'impuissance dans ses propres États qu'avait abouti
la politique de Philippe II.
-
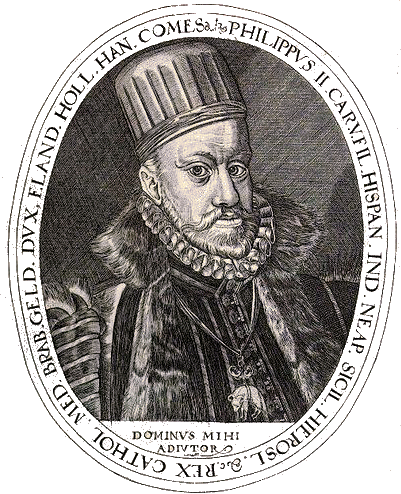
"Philippe
II, d'Espagne et des Indes, etc., roi catholique"
(Portrait
dĂ» Ă D. Custos).
Politique de Philippe
II en Europe.
Philippe
II avait été amené, au cours de son règne, par ses sentiments personnels,
par la logique même des circonstances, par l'entraînement de ses premiers
succès, à se poser en adversaire résolu du protestantisme en
Europe en
Europe .
L'idée de la suprématie universelle lui vint avec celle de l'extermination
de la Réforme et elles furent inséparables
dans son esprit. Aussi, Ă partir de 1580,
on le voit agir en Europe comme chef de la chrétienté et protecteur,
parfois hautain et redoutĂ©, des papes. Il allait ĂŞtre conduit ainsi Ă
intervenir dans les affaires intérieures des pays voisins qu'il espéra
dominer ou soumettre. Ce rôle lui valut encore d'amers déboires. Dans
le Nord, il chercha à s'entendre avec les rois de Suède .
L'idée de la suprématie universelle lui vint avec celle de l'extermination
de la Réforme et elles furent inséparables
dans son esprit. Aussi, Ă partir de 1580,
on le voit agir en Europe comme chef de la chrétienté et protecteur,
parfois hautain et redoutĂ©, des papes. Il allait ĂŞtre conduit ainsi Ă
intervenir dans les affaires intérieures des pays voisins qu'il espéra
dominer ou soumettre. Ce rôle lui valut encore d'amers déboires. Dans
le Nord, il chercha à s'entendre avec les rois de Suède et de Pologne
et de Pologne en vue d'un partage du Danemark
en vue d'un partage du Danemark ,
mais le roi de Suède Jean III, à la suite d'un nouveau mariage avec une
princesse protestante, renonça à l'alliance espagnole et le projet fut
abandonné. ,
mais le roi de Suède Jean III, à la suite d'un nouveau mariage avec une
princesse protestante, renonça à l'alliance espagnole et le projet fut
abandonné.
Philippe
II et l'Angleterre.
De toutes ses entreprises,
celle pour laquelle il fit l'effort le plus formidable fut son expédition
contre l'Angleterre : aucune n'Ă©choua plus piteusement.
L'expédition contre
l'Angleterre eut d'abord pour cause
le fanatisme religieux de Philippe Il. Élisabeth,
soutenait les Huguenots de France, faisait
passer des secours Ă ceux des Pays-Bas; elle apparaissait en Europe comme
la protectrice du protestantisme, et, de fait Ă©tait elle-mĂŞme le plus
puissant des souverains protestants. Par ailleurs, la reine d'Angleterre
tenait captive depuis près de dix-neuf ans sa cousine, la catholique
Marie
Stuart, reine d'Écosse. Philippe II, qui lui était le plus puissant
des souverains catholiques, se fit le champion de cette dernière. Or,
eEn 1587, Elisabeth, sous prétexte que Marie Stuart complotait contre
elle, la faisait décapiter. Le supplice de Marie Stuart, considérée
par les Catholiques comme une martyre du fanatisme protestant, fut un nouveau
prétexte de guerre pour Philippe II.
Mais la guerre eut
en outre des causes politiques et Ă©conomiques. Elisabeth, on l'a dit,
fournissait ouvertement des secours aux insurgés des Pays-Bas. Enfin la
marine anglaise commençait à se développer. Comme les Espagnols ne permettaient
pas aux navires Ă©trangers de venir commercer dans leurs colonies, les
marins anglais se livraient Ă la piraterie, ils faisaient la traite esclavagiste
dans les colonies espagnoles, arrêtaient au passage les galions d'Amérique,
venaient mĂŞme s'attaquer aux ports espagnols.
En 1588, Philippe,
pour en finir avec l'Angleterre protestante et y et rétablir le
catholicisme,
prépara la plus colossale expédition que l'on eût vue depuis les Croisades.
Le 22 juillet 1588 une flotte de 135 navires, armés de plus de deux mille
canons, montés par 16 000 marins, et transportant une seconde armée de
20 000 soldats, partit sous le commandement du duc de Medina Sidona. Elle
devait aller chercher en Flandre, pour la
transporter en Angleterre, l'armée de 30 000 hommes commandée par Alexandre
Farnèse. Il semblait que rien ne pût résister à de pareilles
forces. Aussi appela-t-on l'expédition à son départ l' «-Invincible
Armada », c'est-à -dire la flotte invincible.
Élisabeth
n'avait pas vu venir le danger; elle n'avait rien préparé pour la défense
du pays. Le patriotisme national suppléa à tout, fournit des marins,
de petits vaisseaux; des troupes furent réunies au camp de Tilbury, près
Londres, oĂą la reine vint elle-mĂŞme enflammer
les courages. L'amiral Howard avait le commandement suprĂŞme de la flotte.
Ses vaisseaux légers, commandés par d'héroïques corsaires, comme Francis
Drake et Frobisher, assaillirent dans la
Manche les lourds vaisseaux espagnols. La tempĂŞte fit le reste.
L'Invincible Armada
fut assaillie par les mauvais temps. Dans la mer de la Manche, les
lourds navires qui la composaient furent être harcelés par les légers
navires des Anglais. Des brûlots, c'est-à -dire des bateaux chargés de
matières enflammées, lancés par l'ennemi au milieu de la flotte, y jetèrent
l'épouvante et provoquèrent une véritable déroute. Les vents poussèrent
les fugitifs dans la mer du Nord.
Le duc de MĂ©dina
Sidonia, pour échapper à une destruction complète, dut faire le tour
des îles Britanniques avec les débris
de sa flotte; il perdit encore, dans les dangereux parages des Orcades,
une cinquantaine de vaisseaux. Il en ramena Ă peine cinquante, avec une
dizaine de mille hommes. Plus de vingt mille hommes avaient péri. Pas
un soldat espagnol n'avait mis le pied sur le sol de l'Angleterre (juillet
1588).
La marine espagnole étai ruinée, les
côtes livrées sans défense aux insultes anglaises. En 1596,
une flotte anglaise, commandée par Drake, vint prendre Cadix,
piller et brûler la ville, et elle emporta un immense butin. Philippe
II ne put tirer aucune vengeance de toutes ces attaques; il ne réussit
même pas à provoquer un soulèvement dans l'Irlande
catholique et il perdit encore une escadre dans cette entreprise.
Philippe
II et la France.
Philippe
II espérait du moins trouver en France une compensation à tous ces
Ă©checs. Il cherchait, Ă la faveur des troubles religieux, Ă y Ă©tablir
solidement son influence, comptant bien exploiter ces troubles Ă son profit.
Catherine de MĂ©dicis, dont il Ă©tait
le gendre, recherchait souvent son appui; parfois aussi elle lui suscitait
des embarras : le gouvernement français favorisait des agressions contre
les colonies espagnoles ou montrait des sympathies pour les révoltés
des Pays-Bas .
La Saint -Barthélemy même, à laquelle
il avait applaudi, ne modifia pas la politique française qui restait en
somme anti-espagnole. Alors Philippe II se tourna du côté de la Ligue,
qu'il soutint de ses subsides, et encouragea les entreprises de Henri de
Guise contre Henri III. Sous couleur de défendre
l'intérêt de la religion, il rêva de dominer la France, d'en faire une
dépendance espagnole ou de la donner à sa fille. La mort du duc d'Alençon,
qui faisait du protestant Henri de Navarre l'héritier légitime du trône,
encouragea d'abord ses ambitions; celle de Henri III lui fit croire le
succès prochain. Ses agents entretenaient la guerre civile et l'exaltation
fanatique du peuple de Paris; celui-ci acclamait
les Espagnols comme des protecteurs, accueillait mĂŞme avec joie une garnison
espagnole. Philippe pensa qu'il lui serait aisé de faire élire sa fille
ou de faire donner la couronne Ă l'archiduc qu'il lui aurait choisi pour
mari. Les États Généraux de 1593
le détrompèrent : ses prétentions provoquèrent une révolte du sentiment
national; les Politiques, la Satire Ménippée .
La Saint -Barthélemy même, à laquelle
il avait applaudi, ne modifia pas la politique française qui restait en
somme anti-espagnole. Alors Philippe II se tourna du côté de la Ligue,
qu'il soutint de ses subsides, et encouragea les entreprises de Henri de
Guise contre Henri III. Sous couleur de défendre
l'intérêt de la religion, il rêva de dominer la France, d'en faire une
dépendance espagnole ou de la donner à sa fille. La mort du duc d'Alençon,
qui faisait du protestant Henri de Navarre l'héritier légitime du trône,
encouragea d'abord ses ambitions; celle de Henri III lui fit croire le
succès prochain. Ses agents entretenaient la guerre civile et l'exaltation
fanatique du peuple de Paris; celui-ci acclamait
les Espagnols comme des protecteurs, accueillait mĂŞme avec joie une garnison
espagnole. Philippe pensa qu'il lui serait aisé de faire élire sa fille
ou de faire donner la couronne Ă l'archiduc qu'il lui aurait choisi pour
mari. Les États Généraux de 1593
le détrompèrent : ses prétentions provoquèrent une révolte du sentiment
national; les Politiques, la Satire Ménippée ,
la conversion de Henri IV achevèrent la déroute
des projets espagnols. Philippe II essaya en vain de continuer la lutte;
battu à Fontaine-Française, il traita à Vervins en 1598
et renonça à la France. ,
la conversion de Henri IV achevèrent la déroute
des projets espagnols. Philippe II essaya en vain de continuer la lutte;
battu à Fontaine-Française, il traita à Vervins en 1598
et renonça à la France.
Ainsi partout il avait échoué : le règne
se terminait par un effondrement général de la puissance espagnole. Sans
doute l'Espagne Ă©tait grande encore : elle Ă©tait encore Ă la tĂŞte des nations catholiques
Ă©tait grande encore : elle Ă©tait encore Ă la tĂŞte des nations catholiques et elle Ă©tait sur le point d'exercer en Europe
et elle était sur le point d'exercer en Europe une véritable primauté littéraire et artistique, qui a été comme un
prolongement brillant de sa prépondérance politique, mais l'heure des
hautes ambitions était passée pour elle. L'or d'Amérique
une véritable primauté littéraire et artistique, qui a été comme un
prolongement brillant de sa prépondérance politique, mais l'heure des
hautes ambitions était passée pour elle. L'or d'Amérique et le fanatisme religieux avaient fait leur oeuvre. La nation espagnole
s'était déshabituée du travail et elle avait usé toutes ses ressources
à une impossible croisade. L'expulsion des Maures avait ruiné l'Espagne;
elle se dépeuplait; une grande partie du pays était en friche, il n'y
avait plus de commerce ni d'industrie; une armée de moines parasites vivait
oisive aux dépens de cette nation qui commençait à mourir de faim. Pour
subvenir Ă ses folles entreprises, Philippe
Il avait épuisé tous les expédients financiers; depuis le début
de son règne, ce roi, qui avait eu à sa disposition les trésors d'Amérique,
se débattait dans des embarras pécuniaires : il dut faire des emprunts
forcés, écraser son peuple d'impôts, contracter des engagements ruineux,
sans pouvoir Ă©viter la banqueroute finale. L'Espagne cependant ne lui
tenait pas rancune de tant de misères; elle se drapait dans sa pauvreté,
reconnaissante à son roi de la grandeur qu'il avait rêvée pour elle,
du zèle qu'il avait déployé contre l'hérésie. Philippe II, malgré
ses échecs, resta jusqu'à son dernier jour inébranlable dans sa foi
au triomphe final du catholicisme, mais plein d'angoisses sur son oeuvre
propre et d'inquiétudes pour l'avenir. Sa fin fut triste; une répugnante
maladie, qui l'inonda de vermine, lui fit endurer de vives souffrances;
il les supporta avec résignation et mourut en recommandant à son fils
la guerre contre les infidèles et la paix avec la France
(1598).
et le fanatisme religieux avaient fait leur oeuvre. La nation espagnole
s'était déshabituée du travail et elle avait usé toutes ses ressources
à une impossible croisade. L'expulsion des Maures avait ruiné l'Espagne;
elle se dépeuplait; une grande partie du pays était en friche, il n'y
avait plus de commerce ni d'industrie; une armée de moines parasites vivait
oisive aux dépens de cette nation qui commençait à mourir de faim. Pour
subvenir Ă ses folles entreprises, Philippe
Il avait épuisé tous les expédients financiers; depuis le début
de son règne, ce roi, qui avait eu à sa disposition les trésors d'Amérique,
se débattait dans des embarras pécuniaires : il dut faire des emprunts
forcés, écraser son peuple d'impôts, contracter des engagements ruineux,
sans pouvoir Ă©viter la banqueroute finale. L'Espagne cependant ne lui
tenait pas rancune de tant de misères; elle se drapait dans sa pauvreté,
reconnaissante à son roi de la grandeur qu'il avait rêvée pour elle,
du zèle qu'il avait déployé contre l'hérésie. Philippe II, malgré
ses échecs, resta jusqu'à son dernier jour inébranlable dans sa foi
au triomphe final du catholicisme, mais plein d'angoisses sur son oeuvre
propre et d'inquiétudes pour l'avenir. Sa fin fut triste; une répugnante
maladie, qui l'inonda de vermine, lui fit endurer de vives souffrances;
il les supporta avec résignation et mourut en recommandant à son fils
la guerre contre les infidèles et la paix avec la France
(1598).
La
Renaissance en Espagne : el Siglo de Oro
Ainsi se termina le XVIe
siècle, qui en Espagne avait pris le nom de Siècle d'Or (Siglo de Oro). Depuis
Charles-Quint,
le pays, parvenu à son apogée politique, avait connu un grand florissement
artistique et intellectuel. De fait, l'orgueilleuse Espagne de Charles-Quint
et de
Philippe II, souvent mêlée
aux affaires italiennes
avait pris le nom de Siècle d'Or (Siglo de Oro). Depuis
Charles-Quint,
le pays, parvenu à son apogée politique, avait connu un grand florissement
artistique et intellectuel. De fait, l'orgueilleuse Espagne de Charles-Quint
et de
Philippe II, souvent mêlée
aux affaires italiennes ,
a dĂ» Ă la Renaissance ,
a dû à la Renaissance un art brillant et riche, un peu clinquant, qui convenait à ses goûts
fastueux et Ă ses conceptions grandioses, digne image aussi de sa richesse
peu solide. Cet art a été le produit d'un mélange d'éléments italiens
avec les formes gothiques et les fantaisies de l'art mauresque; aussi il
est d'une grande variété décorative, exubérant, fouillé, dentelé.
On lui a donné un nom particulier: c'est le style plateresque (du mot
plata
= argent), ainsi nommé parce qu'il emprunte tous ses motifs d'ornementation
à l'orfèvrerie. Dans les édifices du temps, à Salamanque, à Burgos,
à Séville, les ordres grecs sont mariés aux pinacles
gothiques; la décoration est partout d'une abondance fastueuse.
Berruguete
(1480-1561),
le plus grand artiste espagnol de ce temps, peintre, sculpteur et architecte,
Ă©leva pour Charles-Quint le palais de Grenade et l'Alcazar
un art brillant et riche, un peu clinquant, qui convenait à ses goûts
fastueux et Ă ses conceptions grandioses, digne image aussi de sa richesse
peu solide. Cet art a été le produit d'un mélange d'éléments italiens
avec les formes gothiques et les fantaisies de l'art mauresque; aussi il
est d'une grande variété décorative, exubérant, fouillé, dentelé.
On lui a donné un nom particulier: c'est le style plateresque (du mot
plata
= argent), ainsi nommé parce qu'il emprunte tous ses motifs d'ornementation
à l'orfèvrerie. Dans les édifices du temps, à Salamanque, à Burgos,
à Séville, les ordres grecs sont mariés aux pinacles
gothiques; la décoration est partout d'une abondance fastueuse.
Berruguete
(1480-1561),
le plus grand artiste espagnol de ce temps, peintre, sculpteur et architecte,
éleva pour Charles-Quint le palais de Grenade et l'Alcazar de Tolède. En sculpture
de Tolède. En sculpture ,
les tombeaux de Ferdinand et d'Isabelle,
de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle,
dans la cathédrale ,
les tombeaux de Ferdinand et d'Isabelle,
de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle,
dans la cathédrale de Grenade, sont les plus riches spécimens de cet art surchargé et prodigue.
Philippe II s'Ă©carta du style national quand il fit construire, dans une
solitude voisine de Madrid, le grandiose,
mais austère et monotone palais de l'Escurial
de Grenade, sont les plus riches spécimens de cet art surchargé et prodigue.
Philippe II s'Ă©carta du style national quand il fit construire, dans une
solitude voisine de Madrid, le grandiose,
mais austère et monotone palais de l'Escurial ,
aux lignes sévères, auquel il donna la forme d'un gril, instrument du
supplice de saint Laurent, parce qu'il avait remporté sa victoire de Saint-Quentin
le jour de la fĂŞte de ce saint. ,
aux lignes sévères, auquel il donna la forme d'un gril, instrument du
supplice de saint Laurent, parce qu'il avait remporté sa victoire de Saint-Quentin
le jour de la fĂŞte de ce saint.
(

L'Escurial.
Dans la peinture ,
l'Espagne ,
l'Espagne subit Ă la fois l'influence de la Flandre
subit Ă la fois l'influence de la Flandre et de l'Italie
et de l'Italie .
Elle n'a guère, au XVIe
siècle, qu'un seul peintre de très grande valeur,
Navarrete,
surnommé el Mudo ( = le Sourd-muet), qui fut un disciple de Titien.
Il commence la gloire de l'Ă©cole de SĂ©ville. Mais c'est un peu plus tard,
quand déjà aura commencé la décadence politique, que l'art et la littérature
s'épanouiront en Espagne et jetteront leur brillant éclat avant le déclin
final. En littérature, c'est tout à fait à la fin du siècle que l'Espagne
ruinée et chancelante de Philippe II
trouvera son peintre inimitable, Michel Cervantès,
l'immortel auteur du Don Quichotte .
Elle n'a guère, au XVIe
siècle, qu'un seul peintre de très grande valeur,
Navarrete,
surnommé el Mudo ( = le Sourd-muet), qui fut un disciple de Titien.
Il commence la gloire de l'Ă©cole de SĂ©ville. Mais c'est un peu plus tard,
quand déjà aura commencé la décadence politique, que l'art et la littérature
s'épanouiront en Espagne et jetteront leur brillant éclat avant le déclin
final. En littérature, c'est tout à fait à la fin du siècle que l'Espagne
ruinée et chancelante de Philippe II
trouvera son peintre inimitable, Michel Cervantès,
l'immortel auteur du Don Quichotte ,
et l'on doit aussi nommer Lope de Vega. L'Ă©poque
est encore celle de fondations des universités de Salamanque et d'Alcala
de Henares ,
et l'on doit aussi nommer Lope de Vega. L'Ă©poque
est encore celle de fondations des universités de Salamanque et d'Alcala
de Henares .
Mais le règne de Philippe II avait
été marqué par la ruine des derniers vestiges de liberté, par un appauvrissement
de plus en plus grand du pays, par une exagération de l'intolérance et
un redoublement des fureurs de l'Inquisition .
Mais le règne de Philippe II avait
été marqué par la ruine des derniers vestiges de liberté, par un appauvrissement
de plus en plus grand du pays, par une exagération de l'intolérance et
un redoublement des fureurs de l'Inquisition .
Des tragédies domestiques, épouvantables comme la condamnation à mort
de son fils don Carlos, et peut-ĂŞtre l'empoisonnement de sa femme Isabelle
de Valois et de son frère Juan d'Autriche,
assombrissent l'histoire de ce règne despotique qui, pour l'Espagne se
termina en naufrage. (G. Pawlowski / HUP). .
Des tragédies domestiques, épouvantables comme la condamnation à mort
de son fils don Carlos, et peut-ĂŞtre l'empoisonnement de sa femme Isabelle
de Valois et de son frère Juan d'Autriche,
assombrissent l'histoire de ce règne despotique qui, pour l'Espagne se
termina en naufrage. (G. Pawlowski / HUP).
 |
 Bartolomé
Bennassar, Bernard Vincent, Le temps de l'Espagne : XVIe-XVIIe siècles,
Hachette , 2010. - L'Espagne du long Siècle
d'or a su construire un empire improbable, multiple et éclaté, sur lequel
"le Soleil ne se couchait pas". Un grand dessein politique s'est formé,
qu'une dynastie chanceuse et avisée a pu conduire grâce au dynamisme
d'un peuple. En dépit de grandes distances et disparités, la monarchie
hispanique a établi et maintenu une maîtrise que les puissances rivales
(France, Angleterre,
Empire
ottoman et plus tard Pays-Bas) ont
longtemps dû admettre. En deux siècles, les Habsbourg
d'Espagne, de Charles Quint Ă Philippe
IV, ont réalisé un double modèle, politique et culturel, dont Bartolomé
Bennassar et Bernard Vincent soulignent l'originalité, l'ingéniosité
et la force. (couv.). Bartolomé
Bennassar, Bernard Vincent, Le temps de l'Espagne : XVIe-XVIIe siècles,
Hachette , 2010. - L'Espagne du long Siècle
d'or a su construire un empire improbable, multiple et éclaté, sur lequel
"le Soleil ne se couchait pas". Un grand dessein politique s'est formé,
qu'une dynastie chanceuse et avisée a pu conduire grâce au dynamisme
d'un peuple. En dépit de grandes distances et disparités, la monarchie
hispanique a établi et maintenu une maîtrise que les puissances rivales
(France, Angleterre,
Empire
ottoman et plus tard Pays-Bas) ont
longtemps dû admettre. En deux siècles, les Habsbourg
d'Espagne, de Charles Quint Ă Philippe
IV, ont réalisé un double modèle, politique et culturel, dont Bartolomé
Bennassar et Bernard Vincent soulignent l'originalité, l'ingéniosité
et la force. (couv.). |
|
|