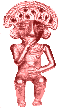 La Harpe
1820. | Toute la suite des triangles étant terminée au sud de Quito , au mois d'août 1739, il fallut mesurer une seconde base pour vérifier la justesse des opérations et des calculs; et de plus il fallut vaquer à l'observation astronomique, à cette même extrémité de la méridienne , au mois d'août 1739, il fallut mesurer une seconde base pour vérifier la justesse des opérations et des calculs; et de plus il fallut vaquer à l'observation astronomique, à cette même extrémité de la méridienne . Mais, les instruments ne s'étant pas trouvés aussi parfaits que l'exigeait une observation si délicate, on fut obligé de retourner à Quito pour en construire d'autres. Ce travail dura jusqu'au mois d'août de l'année suivante 1740; alors nos infatigables mathématiciens se rendirent à Cuença, où leurs observations les retinrent jusqu'à la fin de septembre, parce que l'atmosphère de ce pays est peu favorable aux astronomes. Si les nuages dont ils étaient environnés sur les montagnes les avaient empêchés de voir les signaux, ceux qui se rassemblent au-dessus de cette ville forment un pavillon qui ne leur permettait pas d'apercevoir les étoiles lorsqu'elles passaient par le méridien; mais une extrême patience ayant fait surmonter tous les obstacles, ils se disposaient à retourner à Quito pour les observations astronomiques qu'il fallait faire à l'autre bout de la méridienne vers le nord, et qui devaient terminer l'ouvrage, lorsque George Juan et Ulloa furent appelés à Lima pour veiller à la défense des côtes contre les escadres d'Angleterre. Les observations furent achevées, dans leur absence, par les académiciens français. Le récit de ceux-ci, concernant les opérations antérieures, va succéder à celui des mathématiciens espagnols. . Mais, les instruments ne s'étant pas trouvés aussi parfaits que l'exigeait une observation si délicate, on fut obligé de retourner à Quito pour en construire d'autres. Ce travail dura jusqu'au mois d'août de l'année suivante 1740; alors nos infatigables mathématiciens se rendirent à Cuença, où leurs observations les retinrent jusqu'à la fin de septembre, parce que l'atmosphère de ce pays est peu favorable aux astronomes. Si les nuages dont ils étaient environnés sur les montagnes les avaient empêchés de voir les signaux, ceux qui se rassemblent au-dessus de cette ville forment un pavillon qui ne leur permettait pas d'apercevoir les étoiles lorsqu'elles passaient par le méridien; mais une extrême patience ayant fait surmonter tous les obstacles, ils se disposaient à retourner à Quito pour les observations astronomiques qu'il fallait faire à l'autre bout de la méridienne vers le nord, et qui devaient terminer l'ouvrage, lorsque George Juan et Ulloa furent appelés à Lima pour veiller à la défense des côtes contre les escadres d'Angleterre. Les observations furent achevées, dans leur absence, par les académiciens français. Le récit de ceux-ci, concernant les opérations antérieures, va succéder à celui des mathématiciens espagnols. "Nous partîmes de Quito , dit La Condamine, le 14 août 1737, pour travailler sérieusement à la mesure des triangles de la méridienne , dit La Condamine, le 14 août 1737, pour travailler sérieusement à la mesure des triangles de la méridienne . Nous montâmes d'abord sur le Pichincha, M. Bouguer et moi, et nous allâmes nous établir près du signal que j'y avais placé depuis près d'un an, 971 toises au-dessus de Quito. Le sol de cette ville est déjà élevé sur le niveau de la mer de 1460 toises, c'est-à-dire plus que le Canigou et le Pic du midi, les plus hautes montagnes des Pyrénées. La hauteur absolue de notre poste était donc 2430 toises, ou d'une bonne lieue; c'est-à-dire, pour donner une idée sensible de cette prodigieuse élévation, que, si la pente du terrain était distribuée en marches d'un demi-pied chacune, il y aurait 29160 marches à monter depuis la mer jusqu'au sommet du Pichincha. Don Antoine d'Ulloa, en montant avec nous, tomba en faiblesse, et fut obligé de se faire porter dans une grotte voisine où il passa la nuit. . Nous montâmes d'abord sur le Pichincha, M. Bouguer et moi, et nous allâmes nous établir près du signal que j'y avais placé depuis près d'un an, 971 toises au-dessus de Quito. Le sol de cette ville est déjà élevé sur le niveau de la mer de 1460 toises, c'est-à-dire plus que le Canigou et le Pic du midi, les plus hautes montagnes des Pyrénées. La hauteur absolue de notre poste était donc 2430 toises, ou d'une bonne lieue; c'est-à-dire, pour donner une idée sensible de cette prodigieuse élévation, que, si la pente du terrain était distribuée en marches d'un demi-pied chacune, il y aurait 29160 marches à monter depuis la mer jusqu'au sommet du Pichincha. Don Antoine d'Ulloa, en montant avec nous, tomba en faiblesse, et fut obligé de se faire porter dans une grotte voisine où il passa la nuit. Notre habitation était une hutte, dont le faîte, soutenu par deux fourchons, avait un peu plus de six pieds de hauteur. Quelques perches inclinées à droite et à gauche, et dont une des extrémités portait à terre tandis que l'autre était appuyée, sur le comble, composaient la charpente du toit, et servaient en même temps de murailles. Le tout était couvert d'une espèce de jonc délié, qui croît sur la plupart des montagnes du pays. Tel fut notre premier observatoire et notre première habitation sur le Pichincha. Comme je prévoyais les difficultés de la construction, toute simple qu'elle devait être, je m'y étais pris de longue main : mais je ne m'attendais pas que, cinq mois après avoir payé les matériaux et la main-d'oeuvre, je ne trouverais encore rien de commencé, et que je me verrais obligé de contraindre judiciairement les gens avec qui j'avais fait le marché. Notre baraque occupait toute la largeur de l'espace qu'on avait pu lui ménager, en aplanissant une crête sablonneuse qui se terminait à mon signal : le terrain était si escarpé de part et d'autre, qu'à peine avait-on pu conserver un étroit sentier d'un seul côté pour passser derrière notre case. Sans entrer dans le détail des incommodités que nous éprouvâmes dans ce poste, je me contenterai de faire les remarques suivantes. Notre toit, presque toutes les nuits, était enseveli sous les neiges. Nous y ressentîmes un froid extrême; nous le jugions même plus grand par ses effets qu'il ne nous était indiqué par un thermomètre de M. de Réaumur, que j'avais porté, et que je ne manquais pas de consulter tous les jours matin et soir. Je ne le vis jamais, au lever du soleil descendre tout à fait jusqu'à cinq degrés au-dessous du terme de la glace : il est vrai qu'il était à l'abri de la neige et du vent, et adossé à notre cabane; que celle-ci était continuellement échauffée par la présence de quatre, quelquefois cinq où six personnes, et que nous avions des brasiers allumés. Rarement cette partie du sommet du Pichincha, plus orientale que la bouche, du volcan, est tout à fait dépouillée de neige. Aussi sa hauteur est-elle à peu près celle où la neige ne fond jamais dans les autres montagnes plus élevées, ce qui rend leurs sommets inaccessibles. Personne, que je sache, n'avait vu avant nous le mercure, dans le baromètre, au-dessous de seize pouces, c'est-à-dire douze pouces plus bas qu'au niveau de la mer; en sorte que l'air que nous respirions était dilaté près de moitié plus que n'est celui de France quand le baromètre y monte à vingt-neuf pouces. Cependant je ne ressentis en mon particulier aucune difficulté de respiration. Quant aux affections scorbutiques dont M. Bouguer fait mention, et qui désignent apparemment la disposition prochaine à saigner des gencives, dont je fus alors incommodé, je ne crois pas devoir l'attribuer au froid du Pichincha, n'ayant rien éprouvé de pareil en d'autres postes aussi élevés, et le même accident m'ayant repris cinq ans après au Cochesqui dont le climat est tempéré.
J'avais porté une pendule, et fait faire les piliers qui soutenaient la case, surtout celui du fond, assez solides pour y suspendre cette horloge. Nous parvînmes à la régler, et par ce moyen à faire l'expérience du pendule simple, à la plus grande hauteur où jamais elle eût été faite. Nous passâmes en ce lieu trois semaines, sans pouvoir achever d'y prendre nos angles, parce qu'un signal qu'on avait voulu porter trop loin du côté du sud ne put être aperçu, et qu'il arriva quelques accidents à d'autres. La montagne de Pichincha, comme la plupart de celles dont l'accès est fort difficile, passe dans le pays pour être riche en mines d'or; et de plus, suivant une tradition fort accréditée, les Américains, sujets d'Atahualpa, roi de Quito , au temps de la conquête, y enfouirent une grande partie des trésors qu'ils apportaient de toutes parts pour la rançon de leur maître, lorsqu'ils apprirent sa fin tragique. Pendant que nous étions campés dans ce lieu, deux particuliers de Quito, de la connaissance de don Antoine d'Ulloa, qui partageait notre travail, eurent la curiosité, peut-être au nom de toute la ville, de savoir ce que nous faisions si longtemps dans la moyenne région de l'air. Leurs mules les conduisirent au pied du rocher où nous avions élu notre domicile; mais il leur restait à franchir 200 toises de hauteur perpendiculaire, que l'on ne pouvait monter qu'en s'aidant des pieds et des mains, et même, en quelques endroits, qu'avec danger. Une partie du chemin était un sable mouvant qui s'éboulait sous les pieds, et où l'on reculait souvent au lieu d'avancer; heureusement pour eux, il ne faisait ni pluie ni brouillard. Cependant nous les vîmes plusieurs fois abandonner la partie. Enfin, à l'envi l'un de l'autre, aidés par nos Péruviens, ils firent de nouveaux efforts et parvinrent à notre poste après avoir mis plus de deux heures à l'escalader. Nous les reçûmes agréablement; nous leur fîmes part de toutes nos richesses. Ils nous trouvèrent mieux pourvus de neige que d'eau. On fit grand feu pour les faire boire à la glace. Ils passèrent avec nous une partie de la journée, et reprirent au soir le chemin de Quito, où nous avons depuis conservé la réputation d'hommes fort extraordinaires. , au temps de la conquête, y enfouirent une grande partie des trésors qu'ils apportaient de toutes parts pour la rançon de leur maître, lorsqu'ils apprirent sa fin tragique. Pendant que nous étions campés dans ce lieu, deux particuliers de Quito, de la connaissance de don Antoine d'Ulloa, qui partageait notre travail, eurent la curiosité, peut-être au nom de toute la ville, de savoir ce que nous faisions si longtemps dans la moyenne région de l'air. Leurs mules les conduisirent au pied du rocher où nous avions élu notre domicile; mais il leur restait à franchir 200 toises de hauteur perpendiculaire, que l'on ne pouvait monter qu'en s'aidant des pieds et des mains, et même, en quelques endroits, qu'avec danger. Une partie du chemin était un sable mouvant qui s'éboulait sous les pieds, et où l'on reculait souvent au lieu d'avancer; heureusement pour eux, il ne faisait ni pluie ni brouillard. Cependant nous les vîmes plusieurs fois abandonner la partie. Enfin, à l'envi l'un de l'autre, aidés par nos Péruviens, ils firent de nouveaux efforts et parvinrent à notre poste après avoir mis plus de deux heures à l'escalader. Nous les reçûmes agréablement; nous leur fîmes part de toutes nos richesses. Ils nous trouvèrent mieux pourvus de neige que d'eau. On fit grand feu pour les faire boire à la glace. Ils passèrent avec nous une partie de la journée, et reprirent au soir le chemin de Quito, où nous avons depuis conservé la réputation d'hommes fort extraordinaires. Tandis que nous observions au Pichincha, M. Godin et don Juan étaient à huit lieues de nous sur une montagne moins haute nommée Pambamarca. Nous pouvions nous voir distinctement avec de longues lunettes, et même avec celles de nos quarts de cercle; mais il fallait deux jours au moins à un exprès pour porter une lettre d'un poste à l'autre. M. Godin essaya vainement de faire au Pambamarca l'expérience du son; il ne put entendre le bruit d'un canon de neuf livres de balle qu'il avait fait placer sur une petite montagne voisine de Quito , dont il était éloigné de 1000 toises. , dont il était éloigné de 1000 toises. La santé de M. Bouguer était altérée : il avait besoin de repos. Nous descendîmes le 6 septembre à Quito, où M. Godin se rendit aussi. Nous y observâmes tous ensemble l'éclipse du 8 du même mois. Avant de retourner à notre première tâche du Pinchincha, j'allai faire une course à quelques lieues au sud-est de Quito, pour chercher un endroit propre à placer un signal qui devait être aperçu de fort loin. Je réussis à le rendre visible en le faisant blanchir de chaux. Le lieu se nomme Changailli, et ce signal est le seul, hors ceux qui ont terminé nos bases, qui ait été placé en rase campagne. Le 12 septembre, en revenant de reconnaître le terrain sur le volcan nommé Sinchoulagoa, je fus surpris, en pleine campagne d'un violent orage, mêlé de tonnerre et d'éclairs, accompagné d'une grêle la plus grosse que j'aie vue de ma vie. On juge bien que je n'eus pas la commodité d'en mesurer le diamètre; je n'étais occupé qu'à trouver le moyen de garantir ma tête; un grand chapeau à l'espagnol n'eût pas suffi, sans un mouchoir que je mis dessous pour amortir l'impression des coups que, je recevais. Les grains, dont plusieurs approchaient de la grosseur d'une noix, me causaient de la douleur à travers des gants fort épais. J'avais le vent en face, et la vitesse de ma mule augmentait la force du choc. Je fus obligé plusieurs fois de tourner bride. L'instinct de cet animal le portait à présenter le dos au vent, et à suivre sa direction comme un vaisseau fuit vent arrière en cédant à l'orage. Nous remontâmes quelques jours après sur le Pichincha, M. Bouguer et moi, non à notre premier poste, mais à un autre beaucoup moins élevé, d'où l'on voyait Quito , que nous liâmes à nos triangles. Le mauvais temps y rendit inutile notre troisième tentative pour observer l'équinoxe , que nous liâmes à nos triangles. Le mauvais temps y rendit inutile notre troisième tentative pour observer l'équinoxe par la méthode de M. Bouguer. Rebutés des incommodités de notre aucien signal de Pichincha, nous en plaçames un autre dans un endroit plus commode, 110 toises plus bas que le premier. Ce fut là que nous reçumes, le 13 septembre, la première nouvelle des ordres du roi, par lesquels nous étions dispensés de la mesure de l'équateur, qui jusqu'alors avait fait partie de notre projet, ainsi que celle du méridien. par la méthode de M. Bouguer. Rebutés des incommodités de notre aucien signal de Pichincha, nous en plaçames un autre dans un endroit plus commode, 110 toises plus bas que le premier. Ce fut là que nous reçumes, le 13 septembre, la première nouvelle des ordres du roi, par lesquels nous étions dispensés de la mesure de l'équateur, qui jusqu'alors avait fait partie de notre projet, ainsi que celle du méridien. Le changement du signal de Pichincha nous obligeait à reprendre de nouveaux angles. Les difficultés que nous rencontrâmes à placer sur la montagne de Cota-Catché, vers le nord, un signal qui devint inutile, durèrent presque tout le mois d'octobre. Il en naquit d'autres que le cours du temps multiplia. On ne peut les concevoir sans connaître la nature du pays de Quito . Le terrain peuplé et cultivé dans son étendue est un vallon situé entre deux chaînes parallèles de hautes montagnes qui font partie de la cordillère. Leurs cimes se perdent dans les nues, et presque toutes sont couvertes de masses énormes d'une neige aussi ancienne que le monde. De plusieurs de ces sommets en partie écroulés, on voit sortir encore des tourbillons de fumée et de flamme du sein même de la neige. Tels sont les sommets tronqués du Cotopaxi, de Tongouragua, et du Sangaï. La plupart des autres ont été des volcans autrefois; ou vraisemblablement le deviendront. L'histoire ne nous a conservé l'époque de leurs éruptions que depuis la découverte de l'Amérique; mais les pierres ponces; les matières calcinées qui les parsèment, et les traces visibles de la flamme sont des témoignages authentiques de leur embrasement. Quant à leur prodigieuse élévation, ce n'est pas sans raison qu'un auteur espagnol avance que les montagnes d'Amérique sont à l'égard de celles de l'Europe ce que sont les clochers de nos villes comparés aux maisons ordinaires. . Le terrain peuplé et cultivé dans son étendue est un vallon situé entre deux chaînes parallèles de hautes montagnes qui font partie de la cordillère. Leurs cimes se perdent dans les nues, et presque toutes sont couvertes de masses énormes d'une neige aussi ancienne que le monde. De plusieurs de ces sommets en partie écroulés, on voit sortir encore des tourbillons de fumée et de flamme du sein même de la neige. Tels sont les sommets tronqués du Cotopaxi, de Tongouragua, et du Sangaï. La plupart des autres ont été des volcans autrefois; ou vraisemblablement le deviendront. L'histoire ne nous a conservé l'époque de leurs éruptions que depuis la découverte de l'Amérique; mais les pierres ponces; les matières calcinées qui les parsèment, et les traces visibles de la flamme sont des témoignages authentiques de leur embrasement. Quant à leur prodigieuse élévation, ce n'est pas sans raison qu'un auteur espagnol avance que les montagnes d'Amérique sont à l'égard de celles de l'Europe ce que sont les clochers de nos villes comparés aux maisons ordinaires. La hauteur moyenne du vallon où sont situées les villes de Quito, Cuença, Riobamba, Latacunga, la ville d'Ibarra, et quantité de bourgades et de villages, est de 1500 à 1600 toises au-dessus de la mer; c'est-à-dire quelle excède celle des plus hautes montagnes des Pyrénées; et ce sol sert de base à des montagnes une fois aussi élevées. Le Cayamburo, situé sous l'équateur même, l'Antisana, qui n'en est éloigné que de cinq lieues vers le sud, ont plus de 3000 toises à compter du niveau de la mer; et le Chimboraço, haut de 3 220 toises, surpasse de plus d'un tiers le pic de Ténériffe, la plus haute montagne de l'ancien hémisphère. La seule partie du Chimboraço, toujours couverte de neige, a 800 toises de hauteur perpendiculaire. Le Pichincha et le Coraçon, sur le sommet desquels nous avons porté des baromètres, n'ont que 2430 et 2470 toises de hauteur absolue, et c' est la plus grande où l'on ait jamais monté. La neige permanente a rendu jusqu'ici les plus hauts sommets inaccessibles. Depuis ce terme, qui est celui où la neige ne fond plus, même dans la zone torride, on ne voit guère, en descendant jusqu'à 100 ou 150 toises, que des rochers nus ou des sables arides. Plus bas, on commence à voir quelques mousses qui tapissent les rochers; diverses espèces de bruyères, qui, bien que vertes et mouillées, font un feu clair, et nous ont été souvent d'un grand secours; des mottes arrondies de terre spongieuse, où sont plaquées de petites plantes radiées et étoilées, dont les pétales sont semblables aux feuilles de l'if; et quelques autres plantes. Dans tout cet espace, la neige n'est que passagère; maïs elle s'y conserve quelquefois des semaines et des mois entiers. Plus bas encore, et dans une autre zone d'environ 300 toises de hauteur, le terrain est communément couvert d'une sorte de gramen délié, qui s'élève jusqu'à un pied et demi ou deux pieds, et qui se nomme outchouc (uchuc) en langue péruvienne. Cette espèce de foin ou de paille, comme on la nomme dans le pays, est le caractère propre qui distingue les montagnes que les Espagnols nomment paramos. Enfin, descendant encore plus bas, jusqu'à la hauteur d'environ 2000 toises au-dessus du niveau de la mer, j'ai vu neiger quelquefois, et d'autres fois pleuvoir. On sent bien que la diverse nature du sol, sa différente exposition, les vents la saison, et plusieurs circonstances physiques doivent faire varier plus ou moins les limites qu'on vient d'assigner à ces différents étages. Si l'on continue de descendre, après le terme qu'on vient d'indiquer, il se trouve des arbustes : et plus bas on ne rencontre plus que des bois dans les terrains non défrichés, tels que les deux côtés extérieurs de la double chaîne de montagnes entre lesquelles serpente le vallon qui fait la partie habitée et cultivée de la province de Quito . Au-dehors, de part et d'autre de la cordillère, tout est couvert de vastes forêts qui s'étendent vers l'ouest jusqu'à la mer du Sud, à quarante lieues de distance, et vers l'est, dans tout l'intérieur d'un continent de sept à huit cents lieues, le long de la rivière des Amazones jusqu'à la Guyane et au Brésil. . Au-dehors, de part et d'autre de la cordillère, tout est couvert de vastes forêts qui s'étendent vers l'ouest jusqu'à la mer du Sud, à quarante lieues de distance, et vers l'est, dans tout l'intérieur d'un continent de sept à huit cents lieues, le long de la rivière des Amazones jusqu'à la Guyane et au Brésil. La hauteur du sol de Quito est celle où la température de l'air est la plus agréable. Le thermomètre y marque communément 14 à 15 degrés au-dessus du terme de la glace, comme à Paris dans les beaux jours du printemps, et ne varie que fort peu. En montant ou descendant, on est sûr de faire descendre ou monter le thermomètre, et de rencontrer successivement la température de tous les divers climats depuis 5 degrés au-dessous de la congélation, ou plus, jusqu'à 28 ou 29 au-dessus. Quant au baromètre, sa hauteur moyenne à Quito est de vingt pouces une ligne, et ses plus grandes variations ne vont point â une ligne et demie : elles sont ordinairement d'une ligne un quart par jour, et se font assez régulièrement à des heures réglées. est celle où la température de l'air est la plus agréable. Le thermomètre y marque communément 14 à 15 degrés au-dessus du terme de la glace, comme à Paris dans les beaux jours du printemps, et ne varie que fort peu. En montant ou descendant, on est sûr de faire descendre ou monter le thermomètre, et de rencontrer successivement la température de tous les divers climats depuis 5 degrés au-dessous de la congélation, ou plus, jusqu'à 28 ou 29 au-dessus. Quant au baromètre, sa hauteur moyenne à Quito est de vingt pouces une ligne, et ses plus grandes variations ne vont point â une ligne et demie : elles sont ordinairement d'une ligne un quart par jour, et se font assez régulièrement à des heures réglées. Les deux chaînes de montagnes qui bordent le vallon de Quito s'étendent à peu près du nord au sud : cette situation était favorable pour la mesure de la méridienne : elle offrait alternativement, sur l'une et l'autre chaîne, des points d'appui pour terminer les triangles. La plus grande difficulté consistait à choisir les lieux commodes pour y placer des signaux. Les pointes les plus élevées étaient ensevelies, les unes sous la neige, les autres souvent plongées dans les nuages qui en dérobaient la vue. Plus bas, les signaux, vus de loin, se projetaient sur le terrain, et devenaient très difficiles à reconnaître de loin. D'ailleurs, non seulement il n'y avait point de chemin tracé qui conduisît d'un signal à l'autre, mais il fallait souvent traverser par de longs détours des ravines formées par les torrents de pluies et de neige fondue, creusées quelquefois de 60 ou 80 toises de profondeur. On conçoit les difficultés et la lenteur de la marche quand il fallait transporter d'une station à l'autre des quarts de cercle de deux ou trois pieds de rayon, avec tout ce qui était nécessaire pour s'établir dans, des lieux d'un accès difficile, et quelquefois y séjourner des mois entiers. Souvent les guides américains prenaient la fuite en chemin, ou sur le sommet de la montagne où l'on était campé, et plusieurs jours se passaient avant qu'ils pussent être remplacés. L'autorité des gouverneurs espagnols, celle des curés et des caciques, enfin un salaire double, triple, quadruple, ne suffisaient pas pour faire trouver des guides, des muletiers et des porte faix, ni même pour retenir ceux qui s'étaient offerts volontairement. s'étendent à peu près du nord au sud : cette situation était favorable pour la mesure de la méridienne : elle offrait alternativement, sur l'une et l'autre chaîne, des points d'appui pour terminer les triangles. La plus grande difficulté consistait à choisir les lieux commodes pour y placer des signaux. Les pointes les plus élevées étaient ensevelies, les unes sous la neige, les autres souvent plongées dans les nuages qui en dérobaient la vue. Plus bas, les signaux, vus de loin, se projetaient sur le terrain, et devenaient très difficiles à reconnaître de loin. D'ailleurs, non seulement il n'y avait point de chemin tracé qui conduisît d'un signal à l'autre, mais il fallait souvent traverser par de longs détours des ravines formées par les torrents de pluies et de neige fondue, creusées quelquefois de 60 ou 80 toises de profondeur. On conçoit les difficultés et la lenteur de la marche quand il fallait transporter d'une station à l'autre des quarts de cercle de deux ou trois pieds de rayon, avec tout ce qui était nécessaire pour s'établir dans, des lieux d'un accès difficile, et quelquefois y séjourner des mois entiers. Souvent les guides américains prenaient la fuite en chemin, ou sur le sommet de la montagne où l'on était campé, et plusieurs jours se passaient avant qu'ils pussent être remplacés. L'autorité des gouverneurs espagnols, celle des curés et des caciques, enfin un salaire double, triple, quadruple, ne suffisaient pas pour faire trouver des guides, des muletiers et des porte faix, ni même pour retenir ceux qui s'étaient offerts volontairement. Un des obstacles les plus rebutants était la chute fréquente et l'enlèvement des signaux qui terminaient les triangles. En France , les clochers, les moulins, les tours, les châteaux, les arbres isolés et placés dans un lieu remarquable offrent aux observateurs une infinité de points dont ils ont le choix; mais, dans un pays si différent de l'Europe, et sans aucun point précis, on était obligé de créer en quelque sorte des objets distincts pour former les triangles. D'abord on posa des pyramides de trois ou quatre longues tiges d'une espèce d'aloës, dont le bois était fort léger, et cependant d'une assez grande résistance. On faisait garnir de paille ou de nattes la partie supérieure de ces pyramides, quelquefois d'une toile de coton fort claire, qui se fabrique dans le pays, et d'autres fois d'une couche de chaux au-dessous de cette espèce de pavillon, on laissait assez d'espace pour placer et manier un quart de cercle; mais, après plusieurs jours, et quelquefois plusieurs semaines de pluie et de brouillard, lorsque l'horizon s'éclaircissait, et que les sommets des montagnes, se montrant à découvert, semblaient inviter à prendre les angles, souvent, à l'instant même où l'on était près de recueillir le fruit d'une longue attente, on avait le déplaisir de voir disparaître les signaux, tantôt enlevés par les ouragans, et plus souvent volés : des pâtres indiens s'emparaient furtivement des perches, des cordes, des piquets, dont le transport avait coûté beaucoup de temps et de peine. II se passait. quelquefois huit ou quinze jours avant que le dommage pût être réparé; ensuite il fallait attendre des semaines entières, dans la neige et dans les frimas, un autre moment favorable pour les opérations. Le seul signal de Pambamarca fut réparé jusqu'à sept fois. , les clochers, les moulins, les tours, les châteaux, les arbres isolés et placés dans un lieu remarquable offrent aux observateurs une infinité de points dont ils ont le choix; mais, dans un pays si différent de l'Europe, et sans aucun point précis, on était obligé de créer en quelque sorte des objets distincts pour former les triangles. D'abord on posa des pyramides de trois ou quatre longues tiges d'une espèce d'aloës, dont le bois était fort léger, et cependant d'une assez grande résistance. On faisait garnir de paille ou de nattes la partie supérieure de ces pyramides, quelquefois d'une toile de coton fort claire, qui se fabrique dans le pays, et d'autres fois d'une couche de chaux au-dessous de cette espèce de pavillon, on laissait assez d'espace pour placer et manier un quart de cercle; mais, après plusieurs jours, et quelquefois plusieurs semaines de pluie et de brouillard, lorsque l'horizon s'éclaircissait, et que les sommets des montagnes, se montrant à découvert, semblaient inviter à prendre les angles, souvent, à l'instant même où l'on était près de recueillir le fruit d'une longue attente, on avait le déplaisir de voir disparaître les signaux, tantôt enlevés par les ouragans, et plus souvent volés : des pâtres indiens s'emparaient furtivement des perches, des cordes, des piquets, dont le transport avait coûté beaucoup de temps et de peine. II se passait. quelquefois huit ou quinze jours avant que le dommage pût être réparé; ensuite il fallait attendre des semaines entières, dans la neige et dans les frimas, un autre moment favorable pour les opérations. Le seul signal de Pambamarca fut réparé jusqu'à sept fois. Vers le commencement de cette année 1738, M. Godin imagina le premier un expédient simple et commode pour rendre tout à la fois les signaux faciles à construire, et très aisés à distinguer dans l'éloignement: ce fut de prendre pour signaux les tentes mêmes, ou d'autres pareilles à celles sous lesquelles nous campions. Chaque académicien avait une grande tente, et les mathématiciens espagnols avaient aussi les leurs : on avait d'ailleurs trois canonnières. MM. Verguin et des Odonnais précédaient, et faisaient placer celles-ci alternativement sur les deux chaînes de la cordillère aux points désignés, conformément au projet des triangles : ils laissaient un Américain pour les garder. On était dans la saison des pluies : ce temps avait été employé, l'année précédente, à reconnaître le terrain de la méridienne, et, suivant le conseil des gens mêmes du pays, on ne pouvait penser alors à monter sur les montagnes; mais on avait appris par l'expérience que, dans la province de Quito, les beaux jours étaient seulement plus rares pendant la saison qu'on y nomme l'hiver; depuis novembre jusqu'en mai, et que, dans le reste de l'année,, qu'on appelle l'été, il ne laissait pas de pleuvoir quelquefois plusieurs jours de suite. Lorsqu'on s'en fut aperçu, toutes les saisons furent égales, et la diversité des temps n'interrompit plus le cours des opérations. | |